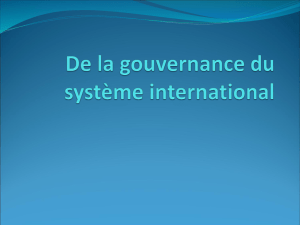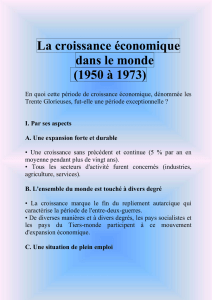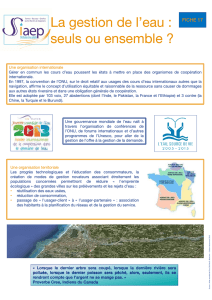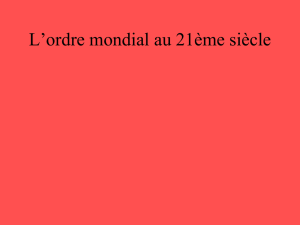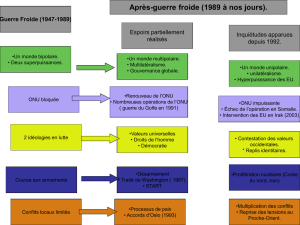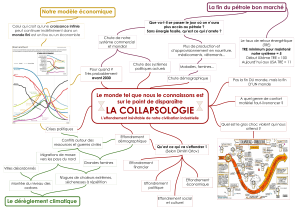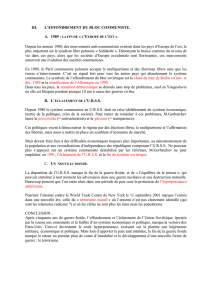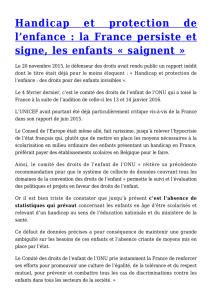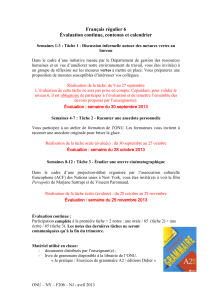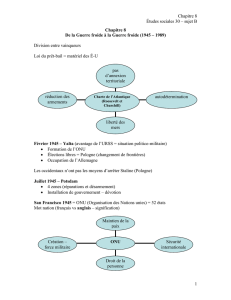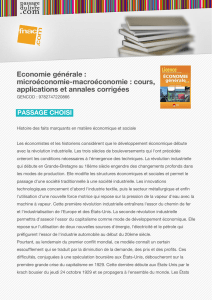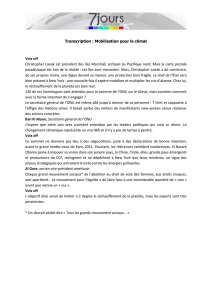Explication d`un document : 1993 dans le monde Depuis 1985, la

Explication d’un document : 1993 dans le monde
Depuis 1985, la différenciation du Tiers-monde
s’est accentuée, l’écart se creusant entre les pays à fort
taux de croissance, de plus en plus intégrés à l’économie
mondiale, et les pays à la dérive. Tandis que les
premiers commencent à surmonter leurs difficultés
d’endettement et accueillent de nouveaux
investissements étrangers, les seconds voient de plus en
plus guerres civiles et sous-développement déboucher
sur l’effondrement de l’Etat : Libéria, Somalie, Zaïre,
Pérou…, posant à la communauté internationale des
problèmes nouveaux.(…)
Bien que la croissance globale des sept plus
grandes économies nationales n’ait été négative sur
aucun des trimestres des dernières années, l’atonie
économique a amplifié l’inquiétude sourde que la
mondialisation commençait à engendrer dans une partie
de la population de la planète. L’heure est au réveil des
nationalismes, et au rejet de l’autre : en Europe de l’Est,
dans la partie orientale de l’Allemagne, en Yougoslavie,
en Inde pour ne citer que quelques exemples (…). Cette
recherche des racines prend aussi une autre forme, celle
de la renaissance de l’intégrisme religieux. (…).
L’humanité se cherche, plus consciente que
jamais de son unicité et de l’intensité de la toile tissée
entre les peuples, et pourtant traumatisée par la crainte
d’une dilution de ses repères ethniques et par
l’apparition de menaces nouvelles comme la
prolifération nucléaire.
Au duopôle américano-soviétique a succédé une
unique puissance dominante, les Etats-Unis, mais, en
dépit de leur capacité d’action, ils ne disposent plus de
l’excès de ressources leur permettant d’être le régulateur
politique et économique du monde. Le rôle des Etats est
en pleine transformation. D’une part, ils se retrouvent en
concurrence sur une sorte de marché mondial des
services publics offerts aux firmes et aux nouveaux
acteurs multinationaux. D’autre part, ils deviennent de
plus en plus souverains, contraints de régler pas
coopération multilatérale un nombre croissant de
questions. C’est ainsi qu’au niveau mondial, l’ONU fait
son chemin, cahin-caha, certes avec inefficacité et
lenteur mais en faisant reconnaître son patronage.
J. Lesourne, « 1993 et le futur », Le Monde, 7 janvier
1993.
Consignes officielles concernant cet
exercice :
« Le candidat répond à des questions. Il doit
manifester une compréhension générale du
document et faire preuve de sa capacité à
identifier des informations et à les éclairer à
partir de ses connaissances personnelles. »
BO du 7 au 12 févier 2004
Questions :
1. Quelle est la situation économique du
monde en 1993 ?
2. Quel nouvel ordre international
(mondial) se met en place ?
3. Quelle est la place des états dans ce
nouvel ordre international?
4. Quelles en sont les limites ?
5. Dans quelle mesure ce tableau est-il
encore valable aujourd’hui ?

Correction de l’explication d’un document en Histoire.
1993 dans le monde
Rappel : Consignes officielles concernant cet exercice :
« Le candidat répond à des questions. Il doit manifester une compréhension générale du document et faire
preuve de sa capacité à identifier des informations et à les éclairer à partir de ses connaissances
personnelles. »
BO du 7 au 12 févier 2004
- Pas de limitation de longueur mais les explications doivent être concises. Cet exercice doit être fait sur
une heure (plus court que précédemment) pour garder plus de temps pour la première partie de l’épreuve
qui elle est plus approfondie.
Questions :
1. Quelle est la situation économique du monde en 1993 ?
Pays du nord :
- PDEM connaissent une croissance continue même si peu importante (atonie).Pays de la triade,
moteurs de l’économie mondiale.
- Anciens pays soviétiques en transition : passage d’une économie communiste à une économie
capitaliste : début du processus engagé depuis l’effondrement du bloc soviétique en 1991.
Pays du sud : Des suds :
- NPI d’Asie : Croissance forte, bénéficiant des IDE et des délocalisations
- Pays intermédiaires
- PMA : qui ont tendance à s’effondrer économiquement ce qui engendre des conflits localisés, fort
endettement, marginalisation
- Pays producteurs de pétrole
=>Des suds très divers (notion de Tiers-monde n’est plus appropriée)
Mondialisation en marche.
2. Quel nouvel ordre international (mondial) se met en place ?
Depuis effondrement du bloc soviétique fin du duopôle américano-soviétique. Les Etats-Unis sont la seule super
puissance (éco, militaire,technologique, politique et culturelle). Volonté de diffuser le modèle américain à travers
le monde
Multilatéralisme privilégié : rôle renforcé de l’ONU (inexistant pendant la guerre froide)
3. Quelle est la place des états dans ce nouvel ordre international?
- Les états sont en concurrence pour attirer les investissements étrangers (multinationales) : aides à
l’implantation des entreprises, législations sociales plus ou moins favorables…
- Rôle renforcé des états dans la gestion de affaires du monde au sein de l’ONU
4. Quelles sont les limites à ce nouvel ordre mondial ?
Ce que l’on pourrait qualifier de désordre :
- Montée des nationalismes : Europe centrale : multiplication des frontières liées aux mouvements
nationalistes après l’effondrement du bloc soviétique : Tchécoslovaquie…
- « Renaissance » des fondamentalismes religieux : Renaissance car existaient déjà (voir
Révolution iranienne…)
- Multiplication des conflits et menace nucléaire : 1ere guerre du Golfe (90-91), conflits souvent
assymétriques…
- Pax américana : Multilatéralisme mais qui se fait au profit des Etats-Unis depuis Bush père.
5. Dans quelle mesure ce tableau est-il encore valable aujourd’hui ?
- Tableau valable pour ce qui concerne les désordres mondiaux, islamisme (11 septembre 2001),
creusements des inégalités à l’échelle mondiale. Super, voir hyper puissance des Etats-Unis,
mondialisation…
- Mais : Unilatéralisme renforcé depuis Bush fils, guerre d’Irak sans prendre en compte l’ONU.
Enjeu sur les pays producteurs de pétrole.
1
/
2
100%