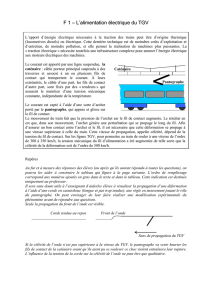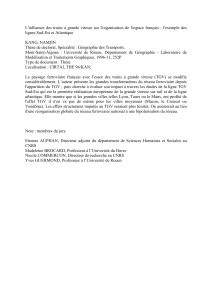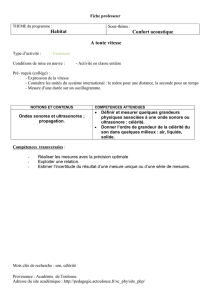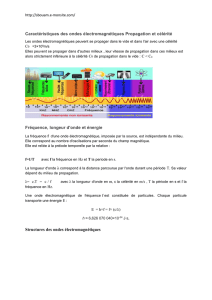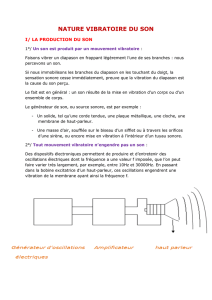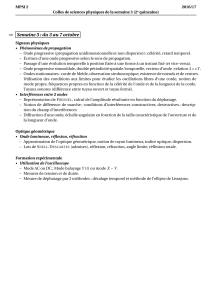L`alimentation électrique du T.G.V.

F
F
1
1
-
-
L
L’
’a
al
li
im
me
en
nt
ta
at
ti
io
on
n
é
él
le
ec
ct
tr
ri
iq
qu
ue
e
d
du
u
T
TG
GV
V
L’apport d’énergie électrique nécessaire à la traction des trains peut être d’origine thermique
(locomotives diesels) ou électrique. Cette dernière technique est de moindre coût d’exploitation et
d’entretien, de moindre pollution et elle permet la réalisation de machines plus puissantes. La
« traction électrique » nécessite toutefois une infrastructure complexe pour amener l’énergie électrique
aux moteurs électriques des machines.
Le courant est apporté par une ligne suspendue la
caténaire : câble porteur principal suspendu à des
traverses et associé à un ou plusieurs fils de
contact qui transportent le courant. À leurs
extrémités, le câble d’une part, les fils de contact
d’autre part, sont fixés par des « tendeurs » qui
assurent le maintien tension d’une mécanique
constante, indépendante de la température.
Le courant est capté à l’aide d’une sorte d’archet
porté par le pantographe, qui appuie et glisse sur
le fil de contact.
Le mouvement du train fait que la pression de l’archet sur le fil de contact augmente. Le résultat en
est que, dans son mouvement, l’archet génère une perturbation qui se propage le long du fil. Afin
d’assurer un bon contact entre l’archet et le fil, il est nécessaire que cette déformation se propage à
une vitesse supérieure à celle du train. Cette vitesse de propagation, appelée célérité, dépend de la
tension du fil de contact. Sur les lignes TGV, pour permettre au train de rouler à une vitesse de l’ordre
de 300 à 350 km/h, la tension mécanique du fil d’alimentation a été augmentée de telle sorte que la
célérité de la déformation soit de l’ordre de 500 km/h.
Repères
Au fur et à mesure des réponses des élèves (ou après qu’ils auront répondu à toutes les questions), on
pourra les aider à construire le tableau qui figure à la page suivante et à remplir ses cases. L’ordre de
remplissage correspond aux numéros ajoutés en gras dans le texte et dans le tableau. Cette indication
est destinée uniquement au professeur.
Il sera sans doute utile de les aider à visualiser la propagation d’une déformation à l’aide d’une corde
en caoutchouc (longue et pas trop tendue), une règle en mouvement jouant le rôle du pantographe. On
peut envisager de leur faire réaliser une modélisation expérimentale du phénomène avant de
répondre aux questions.
Seule la propagation du front de l’onde est visible.
Corde tendue au repos Front de l’onde
Sens de propagation du TGV
Si la célérité de l’onde n’est pas supérieure à la vitesse du TGV, le pantographe va venir heurter les
fils de contact de la caténaire avant qu’ils aient pu se soulever et ce choc violent va entraîner leur
rupture.
L’influence de la tension de la corde sur la célérité de l’onde ne peut être que qualitative.
Pantographe
Caténaire

Exemples de questions :
1° Vitesse et célérité
Dans ce texte on parle de la vitesse du TGV et de la célérité de la déformation du fil de contact.
Pourquoi employer deux termes différents ? Pour répondre différencier les deux phénomènes en
quelques mots. (1)
2° La variable temps t
Les deux phénomènes évoluent dans le temps. Quelles sont les grandeurs pertinentes dont les
variations témoignent de l’évolution temporelle des systèmes (2) ? Donner des exemples dans les
deux cas. (3)
3° La vitesse du TGV
3.1 Quels sont les paramètres qui peuvent influer sur la valeur de la vitesse du TGV ? (4) (5)
3.2 Pourquoi la vitesse du TGV doit-elle être inférieure à la célérité de la déformation du fil ?
4° La célérité de la déformation
4.1 D’après le texte comment fait-on varier cette célérité ? (6)
4.2 Proposez un protocole expérimental permettant de valider la solution proposée.
5° Les conditions initiales
5.1. La déformation : si le pantographe appuie d’avantage sur le fil que peut-il se passer ? (7)
5.2. Citer des conditions initiales pour le mouvement du TGV (8)
La célérité est une grandeur spécifique du phénomène de propagation de la déformation (9)
Repères pour l’enseignant
Phénomène étudié
Déplacement du TGV (1)
Propagation de la
déformation du fil(1)
Grandeurs dépendant du
temps (2)
- position (abscisse) x(t) (3)
- vitesse (éventuellement) v(t)
(3)
- élongation de la
déformation y(t) (3)
Paramètres qui interviennent
dans l’évolution temporelle du
phénomène (4)
- masse
- dimensions et forme
- frottements dans l’air et au
niveau des rails
- force motrice (5)
- tension du fil (6)
Conditions initiales (7)
- position initiale
- vitesse initiale (8)
- amplitude et forme de la
déformation initiale (7)
Autres paramètres (9)
- la célérité (9)
1
/
2
100%