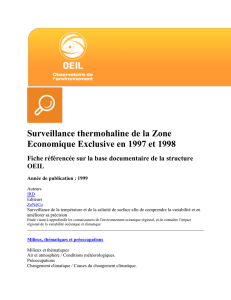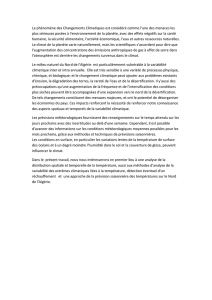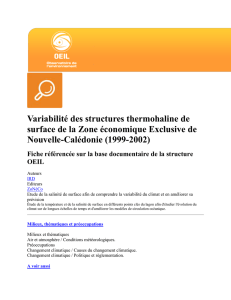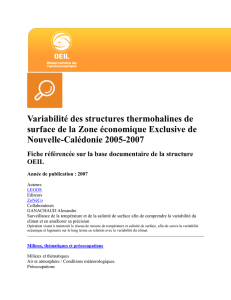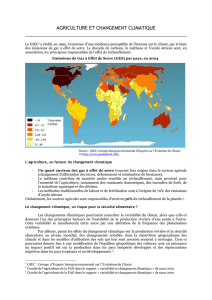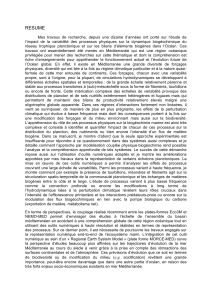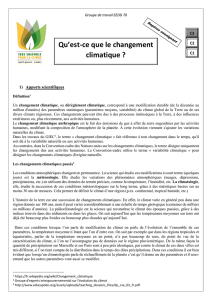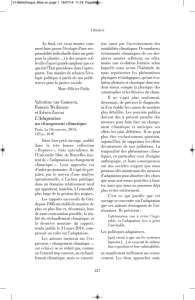Programme National d`Etude Du Climat

Programme National d'Etude Du Climat
Le PNEDC a pour vocation de coordonner les activités françaises de recherche sur
le climat et d'encourager la fédération des efforts sur ce thème. Le programme arrive
à mi-parcours et le CS attend des proposants un bilan succinct mais précis des
actions entreprises, ainsi qu’une explicitation des succès et difficultés rencontrées.
Projets reformulés et nouveaux projets sont priés de tenir compte explicitement, dans
le fond et dans la forme, des recommandations exprimées dans le présent appel
d'offre (voir partie IV).
L'appel d'offre 2003 a conduit au financement partiel ou total de 22 dossiers sur 26,
avec des notifications s'échelonnant de 2 à 80 Keuros. Le budget global notifié a été
de 550 Keuros, en tenant compte de toutes les sources de financement disponibles.
Les moyens humains associés aux projets représentaient de 0,8 à 20 hommes x an,
allant d’un seul laboratoire jusqu’à huit laboratoires. Le PNEDC a ainsi répondu à
une double demande de la communauté : soutenir des actions ponctuelles ainsi que
des actions fédératrices demandant des moyens substantiels (dont la coordination
du projet). A l'avenir, le CS tendra à accroître les moyens alloués aux actions
fédératrices, qui répondent au principe même d'une programmation nationale. Les
actions ponctuelles sont fortement encouragées à s’insérer dans des actions
fédératrices et devront impérativement se faire connaître aux coordinateurs.
Bilan de l’appel d’offre 2003
Analyse des dossiers
A l’issue de l’examen des dossiers soumis en réponse à l’appel d’offre 2003, le CS
considère que nombre de dossiers souffrent de problèmes de forme qui révèlent une
lecture peu attentive de l’appel d’offre.
a- Difficultés de coordination
Outre la qualité scientifique, le CS est particulièrement sensible à l’émergence
d’actions assurant une visibilité de l’effort national : l’effort de coordination entre
laboratoires ne se résume pas à une juxtaposition d’activités scientifiques mais
correspond à un travail approfondi d’échanges scientifiques. Un chapeau de
coordination, explicitant les coûts induits par cette activité, est indispensable pour
mettre en évidence la complémentarité de certains projets.
b- Implication des chercheurs
Le CS a constaté que les indications données sur le personnel impliqué dans les
projets restaient peu fiables. Le CS analyse la participation du personnel au projet en
ne retenant que les participations supérieures à un jour par semaine au projet (20%).
Les personnels consacrant moins de temps seront considérés comme consultants.
Ces informations seront à l’avenir croisées entre les proposition et les programmes.
c- Planification
Un aspect souvent critiqué des dossiers concerne la planification des différentes
activités (que ce soit dans la définition des analyses, des personnels, ou du

calendrier). Le CS encourage à dégager action par action, une planification
raisonnable, tenant compte de la disponibilité des analyses ou données, des aléas
de personnel et du calendrier.
d- Insertion dans le contexte international
Le CS regrette que le contexte international, et en particulier européen, ne soit pas
toujours bien présenté dans les dossiers. Il souhaite connaître le contexte complet
des projets, et en quoi la demande qui lui est proposée développe des aspects
complémentaires aux projets européens engagés par ailleurs. Le détail des
financements européens ou nationaux obtenus par ailleurs sera un élément
d’appréciation du sérieux du dossier (montant, échéances, objectifs associés).
e- Contenu des dossiers
Enfin, le CS insiste sur la nécessité de fournir un dossier complet, sur la durée du
projet, et incluant des indications claires sur les ressources complémentaires
demandées par ailleurs (joindre en particulier la demande de temps bateau, la
demande de soutien à la DT INSU, et fournir les indications sur les autres demandes
annexes -mi-lourds, temps calcul, projet spatial…).
Appel d’offre 2004
I - Cadre général
Le PNEDC répond à la nécessité de développer une compréhension intégrée du
système climatique et de ses changements en tenant compte des différentes
composantes (atmosphère, océan, cryosphère, biosphère, ...) et de leurs interactions
depuis l’échelle globale jusqu’à l’échelle régionale. Son activité scientifique s'oriente
suivant les axes suivants :
1) Changement du climat global et de sa variabilité depuis le début de l’ère
industrielle et sur les 100 prochaines années (suivi des sources et puits des gaz à
effet de serre et des aérosols et intégration dans des scénarios, interaction entre
chimie et climat à l’échelle globale, identification des mécanismes de retroactions et
réduction des incertitudes...)
2) Nature et mécanismes de la variabilité climatique (depuis l’échelle de temps
saisonnière /interannuelle jusqu’au millier d’années pour le climat récent et les
derniers cycles climatiques), sensibilité du système climatique et détection des
phénomènes abrupts ou irréversibles (transitions rapides, processus à seuil,
événements extrêmes ...)
3) Etude du potentiel de prévision depuis l’échelle saisonnière jusqu’à l’échelle
décennale, caractérisation des composantes prévisibles ou imprévisibles, impacts
régionaux du changement climatique et de sa variabilité (mise au point et évaluation
des systèmes de prévision, étude de prévisibilité, pertinence des diagnostics ...)
Ce programme contribue à la visibilité de l’effort national des différents organismes
français dans le cadre de CLIVAR. Il apporte des éléments d’expertise pour dialoguer

avec le secteur des impacts environnementaux et socio-économiques dans le
domaine de la prévision à longue échéance ou celui des modifications du climat
d’origine anthropique (en coordination avec le programme GICC du MATE). Il
s’appuie sur des études de processus de petites et moyennes échelles effectuées au
sein des programmes complémentaires (PNCA, PATOM, PROOF) avec lesquels il
collabore.
Le PNEDC sera également un partenaire national indispensable pour la réalisation
des projets répondant à l’appel d’offre EUROCLIMATE. Le CS doit être informé des
dossiers de demande et des retours, ainsi que des participations nationales
souhaitées. Il faudra que le CS dispose de tous les éléments nécessaires pour
pouvoir discuter le niveau de financement des projets classés prioritaires par
EUROCLIMATE.
Enfin, le CS devra également être informé des projets soumis à l’appel d’offre ACI
« Risques et changement climatique », et de leurs articulations avec les projets qui
lui sont soumis.
Le PNEDC souhaite renforcer son rôle d’animation de la communauté nationale. Il
propose de développer des interactions scientifiques plus importantes entre les
études du climat du passé, de la variabilité actuelle, et du changement climatique et
pour cela, en parallèle d’une réflexion scientifique sur le changement global, une
animation scientifique est mise en place sur trois thèmes : le climat de l’Europe et du
bassin Méditerranéen et leurs liens avec l’Atlantique nord et le bassin arctique
(Laurent Terray et Anne-Marie Tréguier), les mécanismes de variabilité du climat en
régions tropicales et leurs impact sur le climat global (Thierry Delcroix et Serge
Janicot), la dynamique du système couplé océan/glace/atmosphère aux latitudes
australes et son rôle dans le climat (Sabrina Speich et Christophe Genthon). Cette
animation par thème a pour objectif de renforcer les liens entre les observations, le
développement de méthodes d’analyse, et les interprétations diagnostiques des
modèles dans des régions clés du système climatique. Elle aura pour objectif de
renforcer l’évaluation critique des modèles et des données et de mettre l’accent sur
la régionalisation. En parallèle se maintient une activité de modélisation et d’analyse
à l’échelle globale qui donne un cadre intégrateur à l’ensemble des activités.
II - Thèmes de recherche
Le contexte global
Comprendre et quantifier les mécanismes d'ajustement climatique et les
modifications du climat moyen et de sa variabilité sont d'une importance majeure et
de la responsabilité de la communauté scientifique du PNEDC. Des réponses solides
et efficaces demandent d'améliorer la coordination nationale et européenne, en
tenant compte d’une analyse de nos forces et faiblesses dans un contexte
international. Une des richesses de notre communauté est certainement de pouvoir
rassembler des compétences diverses sur une même thématique; cette richesse de
compétence s’est aussi avérée une faiblesse dans certains domaines (comme la
modélisation) puisqu’elle a entraîné une multiplicité des outils dispersant le potentiel
de la communauté. Un effort structurant est indispensable pour maintenir une

capacité de mobilisation sur le thème du changement climatique au niveau
international.
Les études des mécanismes d’ajustement climatique sont indispensables pour
réduire la marge d’incertitude dans les simulations de scénario, elles permettent
d’identifier les processus responsables des rétroactions positives ou négatives à
l’œuvre dans le système climatique, de mieux comprendre et d’améliorer la
représentation du comportement du système climatique.
La stratégie pour mener à bien ce type d’études s’appuie sur deux axes. Le premier
utilise la synergie entre le secteur spatial et la simulation numérique. La recherche va
bénéficier de différentes missions spatiales qui devraient permettre de mieux cerner
le rôle d’un certain nombre de mécanismes clés comme par exemple, les nuages et
les aérosols (missions CALIPSO, AQUA-train), processus de surface et salinité
(SMOS), variation du niveau des mers (JASON, GOCE). Ces nouvelles observations
devraient permettre un meilleur contrôle des performances des modèles et une
amélioration de leur paramétrisation.
Dans un second axe, la sensibilité des modèles qui sera estimée et évaluée sur le
climat présent sera évaluée sous des conditions de forçage externe du passé pour
identifier les liens formels d’interactions entre les composantes. La robustesse des
mécanismes qui contrôlent les rétroactions climatiques reste une des questions
majeures pour s'assurer de la capacité de ces modèles à prévoir le climat du futur.
Comprendre l’évolution du climat sous l’impact des émissions anthropiques et à
quel niveau il faudrait réduire les émissions pour atteindre un objectif climatique
donné est l’objectif des études d’interaction entre climat et chimie. Les retroactions
entre le cycle des gaz à effet de serre (CO2, méthane, et autres gaz) doivent être
étudiées par une stratégie incrémentale sur le système intégré. Différents éléments
doivent progressivement être mis en évidence (impact de la ventilation océanique
des hautes latitudes, prise en compte de la spéciation biologique, rôle de la
biosphère terrestre…). A l’échelle locale, les modifications de l’usage des sols
(déforestation, irrigation, érosion) jouent un rôle essentiel – en particulier sur les
ressources en eau. La prise en compte des échanges entre surfaces continentales,
hydrologie, biosphère et atmosphère permettra d’introduire de nouveaux processus
dans l’évolution du changement climatique.
L’histoire de la Terre montre que son évolution passée a été marquée d’événements
rapides qui ont conduit à de nouveaux états du système climatique. Y-a-t-il un risque
d’évolution irréversible du climat lors du prochain siècle ? De nombreuses
interrogations sont posées par le changement de la cryosphère, des sols gelés, et
des instabilités des calottes et de la circulation océanique profonde. Pour aborder
ces problématiques, une approche interdisciplinaire s’impose pour prendre en
compte les composantes lentes du climat telles que les glaciers, la circulation
océanique profonde, la dynamique de la végétation où peuvent se produire des
processus irréversibles. L’étude des données paléoclimatiques sera intensifiée pour
chercher ce genre de comportement dans les climats du passé. Ce domaine
également devrait bénéficier de la collaboration entre les équipes de modélisation et
les observateurs.
Il est très difficile, sur les enregistrements actuels de faire la part des choses entre
les variations naturelles, les variations liées à l’impact grandissant des activités

humaines, et dans ce dernier cas, d’identifier l’origine et la nature de la pollution. Ce
thème de la détection des changements climatiques devrait se développer au
niveau national en utilisant mieux les bases de données qui nous sont particulières
tout en veillant à leur intercalibration avec les autres base de données; d’autres
études sont également possibles en exploitant les données satellitaires disponibles
sur une durée de plus de 20 ans, ou à travers les archives disponibles à résolution
annuelle (dendrochronologie, glaciers, sédiments varvés, coraux, spéléothèmes…). Il
sera fructueux de stimuler une collaboration avec les historiens pour compiler les
archives historiques d’événements climatiques et les mesures instrumentales
anciennes (collaboration avec le programme ECLIPSE).
Pour aborder pleinement ce sujet , il sera nécessaire de quantifier les facteurs de
variabilité tels que les fluctuations de l’irradiance solaire, le volcanisme, le
changement de la composition chimique de l’atmosphère, ou les modifications de
l’usage des sols et d’évaluer l’impact des forçages externes et des rétroactions
internes du système climatique à la fois sur le climat moyen (optimum médiéval, petit
âge glaciaire) et sur sa variabilité (stabilité des modes de grande échelle). De
multiples simulations de longue durée seront nécessaires pour évaluer et étudier le
comportement du système climatique sur ces périodes.
En parallèle, un effort doit être fait autour de l’utilisation et de l'interprétation des
proxies en terme de variables climatiques à partir d’une meilleure compréhension
de l’enregistrement sédimentaire de la variabilité annuelle et interannuelle sur des
périodes instrumentées et à l’actuel. Une approche « multi-proxy » sera privilégiée
car la confrontation de signaux variés et complémentaires permet une interprétation
plus robuste. La constitution de bases de données permet à la fois de rassembler (et
donc de sauvegarder) les informations disponibles et de faciliter leur combinaison.
Enfin un effort majeur de méthodologie reste à poursuivre pour synchroniser les
différents enregistrements, qu’ils soient marins ou continentaux.
La comparaison puis le raccordement des mesures satellitaires aux mesures
instrumentales puis isotopiques sur des archives diverses (coraux, sédiments marins
et continentaux, glaces…) à haute résolution temporelle est un défi majeur.
Régionalisation
Pour caractériser le climat moyen et sa variabilité dont celle liée aux événements
extrêmes à l’échelle de la centaine de km, pour déterminer et comprendre les
mécanismes à l’origine de cette variabilité, pour définir des scénarios d’évolution en
réponse à des forçages locaux ou provenant d’autres régions, pour explorer la
possibilité de détection et d’attribution du changement climatique à cette échelle,
l'approche doit passer de l'échelle globale à l'échelle régionale. Les scénarios
d’évolution peuvent ensuite servir de base aux études d’impact dans le cadre du
GICC, ou des projets européens.
Comprendre le climat et sa variabilité à l'échelle régionale soulève des questions
spécifiques :
Quelles sont les caractéristiques du climat moyen et de sa variabilité sur les
régions d’intérêt de l’échelle intrasaisonnière à l’échelle séculaire ? Cette
caractérisation est utile à la mise en perspective du changement climatique, pour
permettre l’interprétation de données anciennes ne couvrant qu’un domaine restreint
de l’espace et du temps.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%