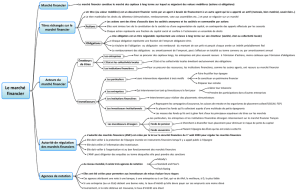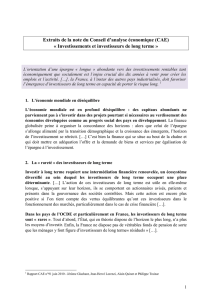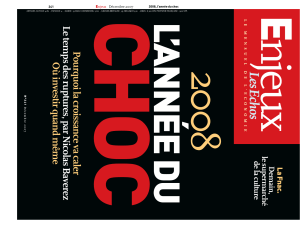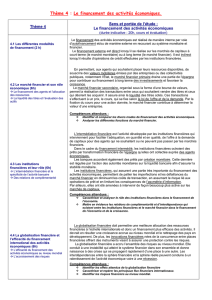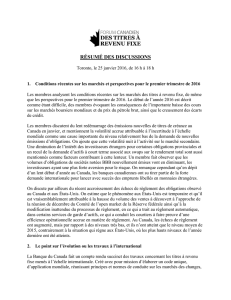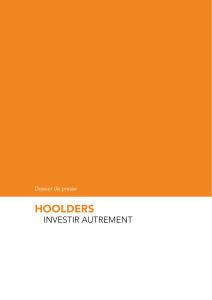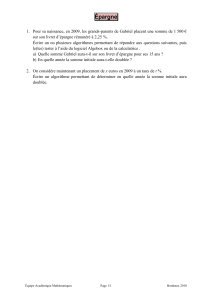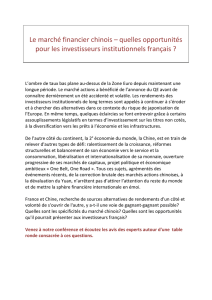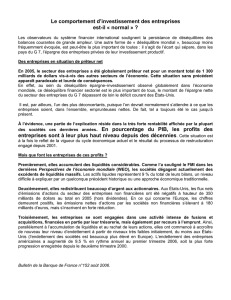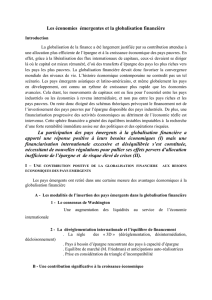livre de P. Artus et MP Virard

Extraits de :
Globalisation : Le pire est à venir
Patrick Artus et Marie Paule Virard
La découverte (2008)
Introduction
L’urgence d’agir
Le propos de cet ouvrage est de décortiquer les ressorts
de cet engrenage à travers cinq thèmes intimement liés.
La globalisation est tout à la fois une machine inégalitaire
qui mine les tissus sociaux et attise les tentations
protectionnistes, un chaudron qui va épuiser les
ressources rares, inciter aux politiques d'accaparement et
accélérer le réchauffement de la planète et les dérives
environnementales, une sorte de casino prompt à
fabriquer du risque financier et de l'irresponsabilité
bancaire, un moteur à implosion pour le système
monétaire international et une centrifugeuse qui peut faire
exploser l'Europe.
Que se passera-t-il si nous restons les bras croisés ? Que
se passera-t-il si les acteurs ne prennent pas conscience
de l'urgence de désarmer les conflits de toutes sortes qui
sont en germe dans l'évolution spontanée du monde ?
Que se passera-t-il, si, non pas dans vingt ans, mais dans
cinq ans, les inégalités continuent à se creuser, la liquidité
mondiale à galoper, la consommation des matières
premières à exploser, la course au rendement à se
poursuivre, les bulles à succéder aux bulles, l'Union
européenne à diverger ?
Notre conviction et que nous avons mangé notre pain
blanc. Avec la baisse des taux d'intérêt et, d'une certaine
manière, avec la baisse des prix pour le consommateur
occidental. Qu'un nouvel âge de la globalisation a
commencé. Et que rien ne serait pire que la fuite en avant
dans l'égocentrisme et le chacun pour soi. D'où l'urgence
et la nécessité de réagir et d'agir collectivement. Car le
pétrole, les matières premières alimentaires, les métaux
précieux et non précieux, l'eau, l'air que chacun respire,
mais tout aussi bien la liquidité mondiale et la justice
sociale constituent désormais autant de biens publics
mondiaux. Dans le monde qui vient, il n'y a plus de
solution nationale, ni même régionale. Le fait que l'ouvrier
chinois de Shenzhen ou de Taiwan ne bénéficie d'aucune
protection sociale a un impact sur l'emploi des ouvriers de
Gandrange ou le niveau de vie des salariés de Ford ou de
Miko. La globalisation oblige les acteurs de l'économie-
monde à coopérer et à s'entendre sur des règles
communes s'ils veulent éviter le pire. C'est-à-dire la fuite
en avant des égoïsmes autour de l'accès à l'énergie, le
contrôle des technologies ou des matières premières.
C'est-à-dire l'affrontement des capitalismes, avec le
développement de formes de capitalisme déconnectées
de la démocratie, sur fond d'institutions internationales
défaillantes.
Comment être optimiste lorsqu'on observe l'impuissance
des États-nations, voire des ensembles régionaux comme
l'Europe, l'inadaptation des grandes organisations
internationales ?
Certes, les autorités de régulation (notamment la Réserve
fédérale américaine, la FED, banque centrale américaine)
ont tout fait pour que la crise des subprimes soit
surmontée et que celle du système financier international
soit évitée. Mais cette crise n'était sans doute que le signe
avant-coureur de ce que nous réserve l'avenir si nous
persistons collectivement dans la voie actuelle. Or, que
voyons-nous depuis que cette nouvelle alerte - d'une
gravité inédite puisque pour la première fois elle est partie
du cœur même du système -s'est déclenchée, sinon la
poursuite des mêmes errements que ceux qui ont servi de
détonateurs à la crise de 2007-2008 ? Déjà la fuite en
avant a repris, attisée par la course au rendement, une
autre bulle s'est formée sur les matières premières,
expression même de la stupidité d'une spéculation qui
n'hésite pas à s'enrichir sur le prix du riz et sur la ruine
des plus pauvres, tandis que les autorités monétaires
semblent se résigner à réguler les cycles économiques
par la liquidité, c'est-à-dire par les bulles, quel qu'en soit le
prix pour les acteurs de l'économie réelle. La banque
centrale américaine sauve les banques, mais se moque
d'inonder le monde de liquidité. Le gaspillage des
ressources rares se poursuit comme si de rien n'était,
aiguillonné par les exigences d'une croissance de plus en
plus « insoutenable ». Les capitalismes s'opposent dans
un affrontement des « valeurs » qui ne dit pas encore tout
à fait son nom. C'est dire si la bataille pour un monde
global stable, pacifique et démocratique est loin d'être
gagnée.
Il faut le redire une dernière fois : il ne s'agit pas ici
d'endosser et d'argumenter un quelconque plaidoyer anti-
globalisation. Mais de montrer que celle-ci nous conduit
droit dans le mur si, au nom de l'efficacité, l'équité est
finalement sacrifiée parce que nos dirigeants politiques et
économiques renonceront à se donner les moyens
d'assumer leurs responsabilités et de réguler
collectivement le système.
« L'homme est un être raisonnable, mais les hommes le
sont-ils ?» : le questionnement de Raymond Aron n'a
jamais été d'une plus brûlante actualité.
Une machine inégalitaire
Inégalités accrues et destructions d'emplois
Quel singulier début d'année en effet dans la France de
2008 avec son improbable cortège : les folies de la
planète finance, mais aussi la détresse des sidérurgistes
de Gandrange, des caissières du Carrefour Grand-Littoral
à Marseille, des ouvriers de Miko à Saint-Dizier, de Ford à
Blanquefort, d'Arc International à Arques ou de Kléber à
Toul, tous condamnés à lutter le dos au mur pour tenter
de préserver leur emploi ou tout simplement obtenir un
salaire décent, à moins que ce ne soit la fin des temps
partiels imposés, fragmentés, qui font vivre la vie petit
bout par petit bout...
Ce fossé entre une petite minorité de privilégiés, qui « sort
» par le haut, et une majorité de salariés de plus en plus
chahutés par les nouveaux désordres de l'économie-
monde (1), s'est sensiblement creusé au cours des
années 2000. Depuis que la globalisation a commencé à
bousculer les économies, les entreprises et les hommes
qui les font. Une nouvelle rupture dans l'histoire du
capitalisme. Ce n'est pas un hasard si le Fonds monétaire
international (FMI), pourtant peu disert sur le sujet dans le
passé, a inscrit solennellement les inégalités au sommaire
de son rapport annuel sur l'économie mondiale en octobre
2007.
Leur accroissement partout dans le monde n'est en effet
ni contesté ni contestable, car si la globalisation crée des
richesses supplémentaires, elle n'a pas son pareil pour
prendre du revenu aux uns et le donner aux autres, ce qui
ne manque pas d'exacerber les tensions entre les futurs «
anciens riches » du Nord et les futurs « nouveaux riches »

de l'Est et du Sud, mais aussi à l'intérieur même de
chaque pays, qu'il soit « développé » ou « émergent ». La
globalisation est en effet une formidable machine
inégalitaire. C'est même là le premier grand déraillement
qu'elle charrie dans ses bagages. Avec à la clé, si l'on n'y
prend garde, le dérapage incontrôlé qui peut miner la
cohésion sociale et ébranler nos démocraties.
Sur le plan économique, il n'y a pas eu de surprise : la
globalisation a produit les effets inégalitaires auxquels on
pouvait s'attendre. (…)
(1) Pour une définition de concept d'économie-monde, voir
l'ouvrage très éclairant (et accessible aux non-initiés) de
l'économiste américain Immanuel WALLERSTEIN,
Comprendre le monde. Introduction à l'analyse des
systèmes-monde, La Découverte, Paris, 2006.
Les excès du capitalisme financier
La machine à fabiquer des bulles tourne toujours
(…) Tant que la liquidité mondiale sera abondante et que
l'obsession du rendement occupera les esprits, la
machine à fabriquer des bulles n'est pas près de s'arrêter.
Or, jusqu'à preuve du contraire, la crise financière n'a pas
fait disparaître l'une et l'autre. On observe simplement un
déplacement de la spéculation d'un objet de désir à un
autre. Ainsi, depuis la fin 2007, la liquidité a, comme on l'a
vu, abandonné le financement de l'immobilier résidentiel
et de tous les actifs titrisés pour se porter sur les matières
premières (alimentaires, énergie, métaux précieux) et sur
les actions des entreprises des pays émergents. Pour ces
actifs, comme pour les actions avant-hier ou l'immobilier
hier, la valorisation est devenue excessive. La hausse du
prix du pétrole depuis l'été 2007, par exemple, ne peut
s'expliquer simplement par l'évolution de la demande
mondiale d'or noir. De même, la valorisation des actions
des pays émergents - en particulier indiennes ou russes -
est bien plus forte que celle des actions des grands pays
de l'OCDE. Aux dernières nouvelles, l'engouement des
investisseurs s'était porté sur la terre agricole « leveragée
», en Ukraine, en Pologne et ailleurs...
L'histoire risque donc de bégayer. Tant que les
investisseurs rechercheront des rendements
anormalement élevés par rapport aux rendements sans
risque et que la liquidité mondiale croîtra rapidement, les
conditions seront remplies pour que les bulles
apparaissent : le mimétisme des investisseurs concentre
la liquidité sur peu d'actifs, dont les prix augmentent donc
inconsidérément. Et comme ils sont désormais en quête
d'actifs « rassurants », c'est-à-dire dans leur esprit
décorrélés de la conjoncture occidentale en général, et
américaine en particulier, leur intérêt a tendance à se
porter sur des classes d'actifs de plus en plus étroites, ce
qui ne peut qu'amplifier et accélérer encore les
phénomènes de bulles. Pas besoin d'être grand clerc pour
pronostiquer de nouvelles explosions.
Pour éviter que l'économie mondiale ne coure de bulle en
bulle, il faudrait que les investisseurs reviennent sur
d'autres actifs dont les prix sont au contraire sous-
évalués. C'est le cas des actifs d'entreprises (actions,
crédit) délaissés, alors que la profitabilité des entreprises
continue de s'accroître avec des gains de productivité
supérieurs à la hausse des salaires réels. Mais
l'observation du passé prouve qu'il est extrêmement
difficile de revenir progressivement sur des actifs dont
l'analyse fondamentale montre que le prix est attrayant,
ce qui revient à convaincre « à froid » les investisseurs
d'accepter collectivement des rendements du capital plus
faibles. Même si une telle évolution devrait être favorisée
par le fait que les banques, contraintes de consommer
davantage de capital (avec les difficultés de la titrisation,
avec l'augmentation de la volatilité), vont pousser dans le
sens d'une réduction du levier d'endettement. (…)
Une révision réglementaire ne peut être
qu'internationale
Ne rêvons pas. Une « autorégulation » collective n'est pas
l'hypothèse la plus probable. À partir de là, comment faire
pour éviter que des secousses comme celle qui a ébranlé
nos économies en 2007 se reproduisent ? Les libéraux
ont tendance à penser que la question de l'«aléa de
moralité» (ou « risque moral », désignant le
comportement négligent ou fautif d'un agent économique,
dès lors qu'il s'estime couvert par un contrat ou une
assurance) n'a pas vraiment de solution. Mais si l'on
renonce, ex-post, à punir les spéculateurs, afin d'éviter de
pénaliser au passage l'économie dans son ensemble, au
moins peut-on se demander comment et jusqu'où il est
possible de leur imposer des règles plus efficaces afin de
les empêcher, ex ante, de provoquer des catastrophes
destructrices de valeur dans la sphère financière, mais
aussi dans l'économie réelle. (…)
Il faut bien pourtant trouver les moyens d'inciter l'industrie
financière à faciliter plutôt le financement de la
croissance. Une part importante de l'épargne mondiale a
été détournée depuis 2003 au profit de l'investissement
logement des ménages américains. Or, on sait que
l'investissement en logements n'est pas efficace pour
augmenter la croissance potentielle d'un pays. Et qu'il
vaudrait mieux, si l'objectif est d'accroître la production et
le revenu, canaliser l'épargne mondiale vers les
investissements productifs ou générateurs de progrès
technique.
En outre, on vient de voir aussi comment, au cours de ces
dernières années, l'épargne s'est investie en masse dans
des actifs financiers « artificiels » - au sens où ils
n'auraient pas dû normalement servir de support à
l'épargne, dès lors qu'ils n'étaient pas faits pour financer
les investissements. C'est le cas en particulier de
l'explosion du marché des dérivés de crédit (depuis le
début des années 2000, le marché des crédits default-
swaps est parti de presque rien pour grimper à plus de 50
000 milliards de dollars). L'investissement de l'épargne
dans ce type de produits ne débouche pas sur un
supplément d'émissions obligataires ou d'investissement
des entreprises. Il s'agit donc bien d'un actif financier «
stérile » au sens de la croissance potentielle.
De même, les marchés à terme de matières premières ne
sont pas conçus pour servir de support au placement de
l'épargne, mais de couverture à des acheteurs qui
consomment ces matières premières pour leur production.
Or, depuis la crise de l'été 2007, ils ont tendance à servir
de refuge aux investisseurs en mal de sensations fortes.
Bien entendu, il est possible de soutenir que, grâce à
cette spéculation sur les marchés à terme de matières
premières, leurs prix au comptant montent et que cela
garantit du revenu supplémentaire aux producteurs,
revenu qui peut, in fine, servir à financer des
investissements bien réels. Toutefois, le fait que l'épargne
transite par des actifs qui ne sont pas conçus pour cela
présente de graves inconvénients, à commencer par la
taille excessive des marchés dérivés avec tous les risques

que cela présente en cas de crise ; sans oublier une
hausse excessive et injustifiée sur le plan économique
des prix des actifs concernés (en l'espèce les matières
premières).
Il vaudrait beaucoup mieux, selon nous, que l'épargne
mondiale soit encouragée à s'investir directement en
actifs d'entreprises (actions et obligations, dont les
émissions sont anormalement faibles), dans le
financement des start-up et autres PME innovantes et
dans le financement d'infrastructures publiques utiles.
L'Europe, en particulier, en a cruellement besoin.
Une centrifugeuse qui peut
faire exploser l’Europe
(…) L'observation froide de la situation de l'Union
européenne en 2008 amène ainsi au constat qu'elle n'est
pas du tout en train de progresser vers une zone
économique et monétaire unifiée, mais plutôt de reculer
vers un agglomérat de régions sans solidarité, où les
riches ne veulent plus payer pour les pauvres. Dans cette
Europe-là, les régions pauvres vont devenir encore plus
pauvres et les régions riches encore plus riches. C'est en
cela que la mondialisation est une centrifugeuse qui peut
finir par faire exploser l'euro et, pourquoi pas, l'Europe.
Conclusion
Dangereuse conjonction
(..) La deuxième tendance qui ne nous paraît pas «
soutenable » dans la durée est la fille des désordres du
capitalisme financier, à mettre avant tout sur le compte de
la juxtaposition de deux phénomènes désormais
solidement installés : l'exigence de rentabilité très forte du
capital (15 % à 25 % par an de rendement des fonds
propres pour les grandes entreprises, les fonds de private
equity et autres hedge funds) et la croissance très rapide
de la liquidité mondiale, attisée par l'accumulation de
réserves de change dans les pays émergents, c'est-à-dire
par le soutien du dollar. Le recyclage des excès d'épargne
des pays émergents et exportateurs de matières
premières par l'intermédiaire des banques centrales
contribue à l'excès chronique de liquidité. Notons que si
ce recyclage prenait la forme d'investissements en capital
des entreprises des grands pays de l'OCDE (mouvement
amorcé, surtout depuis 2007, avec une accélération liée à
la crise financière et à la recapitalisation des banques), il y
aurait une moindre création de liquidités. Mais on
assisterait alors à l'apparition d'un nouveau motif de rejet
de la globalisation, avec le refus, dans les grands pays de
l'OCDE, de la prise de contrôle des entreprises par les
pays émergents ou exportateurs de matières premières.
On n'a pas fini de voir les réactions très négatives
suscitées en Europe et aux États-Unis par l'activité des
fonds souverains...
Quant au curseur de la « norme de rentabilité », il est
désormais placé 14 à 20 points au-dessus du rendement
des actifs sans risque, ce qui est une pure folie. Cela
résulte fondamentalement de la mise en concurrence des
intermédiaires financiers qui gèrent l'épargne, sur un
horizon de jugement à très court terme, même quand
l'horizon normal des investisseurs est le long terme
(assureurs et fonds de pension). La concurrence à court
terme pour les parts de marché conduit inévitablement à
la course aux rendements très élevés et à son corollaire
déstabilisateur, le mimétisme des investisseurs (« rush »
simultané vers les mêmes actifs).
Or, que se passe-t-il lorsqu'il y a à la fois exigence très
excessive de rentabilité et liquidité très abondante ?
D'abord, le levier d'endettement est mobilisé sans retenue
pour accroître la rentabilité du capital. Pour preuve, la
hausse du taux d'endettement des entreprises en Europe,
les rachats d'actions aux États-Unis, à la hausse, jusqu'à
la crise de l'été 2007, l'explosion de la dette des fonds de
private equity et des hedge funds. Mais on observe aussi
une concentration de la liquidité, à chaque instant, sur un
petit nombre d'actifs, d'où des bulles sur les prix des
actifs. Cela résulte du « mimétisme rationnel » des
investisseurs : ils sont, comme on l'a vu, en concurrence
dans un environnement d'exigence forte de rentabilité, et
sont donc contraints d'acheter les mêmes actifs que les
autres investisseurs, et les prix de ces actifs montent.
On a observé ces bulles sur les actions des entreprises
des grands pays de l'OCDE à la fin des années 1990
(sauf au Japon), sur l'immobilier de 2002 à 2006, sur les
actions des pays émergents jusqu'à la fin de 2007, sur les
matières premières depuis 2004. Elles se traduisent par le
freinage des investissements à horizon long, puisque la
rentabilité exigée du capital conduit à une sous-
valorisation des revenus obtenus à long terme, au profit
d'investissements délivrant rapidement des revenus
élevés ; et par une déformation du partage des revenus
en faveur des profits pour satisfaire l'exigence de
rentabilité excessive du capital. En outre, cette exigence
conduit inévitablement à une prise de risque élevée. Un
risque qui peut prendre différentes formes : faillite avec le
levier d'endettement, crises financières quand les bulles
sur les prix des actifs explosent. (…)
L'impératif d'une nouvelle coopération internationale
Ces tendances explosives sont provoquées et amplifiées
par l'absence de coordination internationale. C'est bien là
la grande question de l'heure. Dans les grandes zones
économiques (l'Union européenne en particulier), la
spécialisation productive n'est pas complétée par les
mécanismes qui la rendraient supportable. Le fait que,
parmi les grands pays, l'Allemagne se spécialise dans
l'industrie manufacturière, et la France, l'Espagne, l'Italie
et le Royaume-Uni dans les services ne serait pas un
problème s'il y avait coordination notamment fiscale et
sociale, comme cela doit normalement être le cas dans
une union économique (et monétaire pour la plupart des
pays). Or, on ne peut que constater l'absence de
coordination dans les domaines concernant la mobilité du
travail (correspondant à la spécialisation productive des
régions), comme de solidarité dans le domaine budgétaire
(compensant par des transferts publics des écarts de
revenu créés par la spécialisation). On sait que ni l'un ni
l'autre ne progressent dans l'Union européenne. Au
contraire. L'immobilisme qui a caractérisé les dernières
années fait plutôt craindre une forme de régression
rampante, alimentée d'ailleurs par les tentations
séparatistes qui se sont fait jour ici ou là.
Par ailleurs, il n'y a aucune gestion mondiale des
ressources rares, mais au contraire de plus en plus
compétition pour l'accès aux matières premières. Et, au-
delà des discours, on ne voit pas de volonté réelle, dans
les grands pays émergents (en Chine en particulier), de
réduire la pollution (les émissions de gaz à effet de serre
notamment).
Enfin, pour résorber les « déséquilibres globaux » (déficit
extérieur des États-Unis et à un bien moindre degré de
l'Union européenne, excédents extérieurs des pays d'Asie

et des pays exportateurs de matières premières), donc
contrôler la croissance de la liquidité mondiale, il faudrait
coordonner les politiques économiques des pays
excédentaires et des pays déficitaires : les premiers
devraient mettre en place des politiques de réduction de
l'épargne (hausse des investissements publics, des
dépenses d'éducation, de santé; modernisation financière,
amélioration de la protection sociale pour éviter l'épargne
de précaution) ; tandis que les seconds, à commencer par
les États-Unis, devraient s'imposer des politiques de
stimulation de l'épargne (politiques monétaires plus
restrictives lorsque le crédit augmente rapidement,
excédents budgétaires tant que le taux d'épargne du
secteur privé est bas). Seule cette coordination complexe
des différents types de politiques économiques, qui n'est
absolument pas entreprise à l'heure actuelle, pourrait
rapprocher les taux d'épargne (60 % en Chine, 12 % aux
États-Unis) et réduire les déséquilibres.
Voilà pourquoi nous pensons qu'il est absolument décisif
qu'une nouvelle coopération internationale se mette en
place rapidement. S'il n'y a pas de gestion collective de la
spécialisation productive et de ses effets, des ressources
rares, de la liquidité mondiale, alors les tendances
incontrôlées décrites plus haut (inégalités, déformation du
partage des revenus en faveur des salariés,
affaiblissement de la croissance dans les grands pays de
l'OCDE, excès d'endettement, bulles sur les prix des
actifs, réduction des investissements à long terme,
consommation en croissance très rapide de matières
premières, émissions de polluants en forte hausse) vont
se renforcer partout avec les risques politiques,
économiques et sociaux que l'on imagine.
La fin des faux modèles ?
Au début des années 2000, certains pays comme les
États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande ou l'Espagne ont
souvent été donnés en modèles, comme s'ils avaient
enfin trouvé la martingale du bonheur économique :
croissance forte, chômage en baisse, demande intérieure
dynamique, budgets équilibrés... Rien de plus simple.
Pourquoi donc les autres économies développées n'en
ont-elles pas tout simplement fait autant ? Certains
experts en venaient à regretter par exemple le caractère
frileux du comportement des ménages allemands ou
français, qui aurait empêché leurs pays de bénéficier des
taux de croissance de la « bande des quatre ».
La rupture qui se produit avec la crise financière de 2007
risque fort de montrer que ces économies étaient en
réalité de faux modèles, dont la croissance forte n'était
due qu'à des circonstances transitoires : faibles taux
d'intérêt, développement de la titrisation qui a favorisé la
forte croissance du crédit et des services financiers, sans
oublier l'évolution des conditions du crédit, qui ont permis
de laisser filer les taux d'endettement des ménages. Les
vrais modèles sont ceux des pays qui ont travaillé à
améliorer leur croissance potentielle, ce que l'on repère
par le niveau élevé des dépenses de R & D (recherche et
développement) et par des gains de productivité aussi
élevés que durables. Une catégorie dans laquelle on peut
sans doute ranger la Suède, le Japon et la Finlande.
Quand les investisseurs
se jettent sur le « baril-papier »
Avec la crise des subprimes a la mi-2007, les
investisseurs se sont mis à bouder brutalement leurs
grands actifs de prédilection. Aucun ne trouve depuis
grâce à leurs yeux, ni l'immobilier ni les actions
américaines ou européennes, à commencer par les
financières, ni le marché obligataire privé... Ils se sont
repliés en masse sur les matières premières, ce qui
explique les fortes hausses de prix observées depuis lors.
Des hausses sans rapport avec l'équilibre du marché «
physique » des matières premières.
La hausse du prix du pétrole traduit bien en effet un
surajustement par rapport à la tendance de la demande
mondiale qui n'augmente pas plus vite que sa tendance
de long terme (+ 1,5 % l'an), alors qu'en 2008 l'écart
capacités/demande devrait même s'accroître... De même,
la hausse très rapide du prix de la tonne de charbon ou du
boisseau de blé depuis l'été 2007 peut difficilement être
mise sur le compte de l'évolution de la demande.
Mais cette hausse est perverse, puisqu'elle provoque un
regain d'inflation. Celle-ci réduit la marge de manœuvre
des banques centrales, qui aimeraient bien baisser leurs
taux d'intérêt pour relancer la croissance. Et les
investisseurs - dont certains sont précisément les pays
exportateurs de matières premières qui, au lieu d'investir
leur rente dans l'économie réelle de leur pays, réalisent
essentiellement des placements financiers - sont encore
plus inquiets : ils n'osent plus compter sur une baisse des
taux susceptible de soutenir la croissance, le crédit et le
prix des actifs traditionnels ; et, du coup, ils achètent
encore plus de matières premières...
Conclusion : il est très déstabilisant pour l'économie que
les matières premières puissent servir d'actifs de
diversification pour les investisseurs.
1
/
4
100%