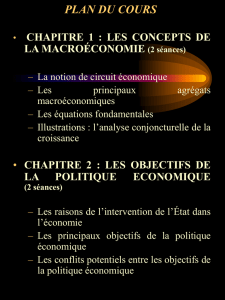texte - Les SES dans l`académie de Bordeaux

Mondialisation et politiques conjoncturelles européennes
Dès l’origine, la construction européenne a été conçue comme le cadre dans
lequel le passage à un capitalisme de grande envergure devait être assuré.
A partir des années 60, la PAC a été mise en œuvre pour permettre la
transformation des structures agricoles en limitant la casse sociale : concentrer les
terres en même temps que les aides et accroître la productivité, tout en maintenant des
revenus minima aux petits agriculteurs.
La liberté de circuler pour les capitaux a été accordée au début de la décennie
90. Dès lors, le capitalisme européen s’intègre dans le capitalisme de plus en plus
mondialisé.
Après une vingtaine d’années d’existence du serpent monétaire et du SME qui
avaient été créés pour rendre possible la poursuite de la PAC après l’instauration des
changes flottants dans le monde, l’accélération de la constitution de l’UEM avec l’euro
et la banque centrale européenne indépendante a pour conséquence d’éloigner le lieu
d’exercice du pouvoir de création et de régulation monétaires des lieux où se gère la
force de travail qui sont encore largement nationaux.
Ainsi, l’Europe est partie prenante de la phase contemporaine du
développement du capitalisme financier. En son sein, et de façon générale dans le
monde entier, les Etats ont été les artisans de la mondialisation sans pour autant la
maîtriser. De ce fait, la mondialisation n’a pas manqué d’avoir des effets sur les
politiques économiques, tant conjoncturelles que structurelles. Globalement, les
politiques ont eu tendance à être normalisées et donc subordonnées aux nouvelles
exigences du capital international. L’exemple européen montre que les lieux de
décision économique s’éloignent de plus en plus des lieux où s’expriment la
démocratie politique et où peuvent se nouer les compromis sociaux.
1. La globalisation normalise et subordonne les politiques
Cette normalisation et cette subordination s’effectuent autour de l’objectif de
stabilité des prix par le biais d’une rigueur monétaire et budgétaire.
1.1. La politique monétaire
1.1.1. Rappel des conceptions de la monnaie et des politiques monétaires
On dit d’habitude qu’il y a deux conceptions théoriques de la monnaie – les deux
premières présentées ci-dessous – parce que c’est entre ces deux que se cristallise le
débat en termes de politiques monétaires. Mais en fait il y a deux autres conceptions –
les deux dernières ci-dessous – qui permettent de saisir les fonctions sociales de la
monnaie.
Première interprétation
La première interprétation de la monnaie consiste à faire de celle-ci un
instrument permettant d’éviter les inconvénients du troc. C’est celle que l’on rencontre
le plus souvent quand on met en relief le rôle d’unité de compte et celui
d’intermédiaire des échanges. C’est celle qui est sous-jacente à la conception classique

2
et néo-classique selon laquelle la monnaie n’est qu’un voile qui dissimule le fait que
les marchandises s’échangent contre des marchandises.
Cette interprétation pose un redoutable problème dès qu’il s’agit de prendre en
compte le rôle de réserve de valeur que joue la monnaie.
Deuxième interprétation
Une seconde interprétation se dégage alors pour souligner que la monnaie est
désirée pour elle-même et pour remettre en cause la dichotomie entre la sphère réelle
et la sphère monétaire. Cette interprétation (que Marx avait en grande partie énoncée)
est celle de Keynes qui montre que la thésaurisation peut entraîner un déséquilibre
entre les revenus susceptibles d’être réinvestis et la quantité de biens de production
disponibles pour être mis en œuvre.
Mais cette interprétation soulève la question de la nature du capital sans la
résoudre.
Troisième interprétation
Une troisième interprétation est alors nécessaire pour comprendre que le capital
n’est pas seulement une ensemble de biens de production et que la monnaie n’a pas le
même sens lorsqu’elle sert à acheter des biens de consommation, des biens de
production ou de la force de travail.
Cette interprétation est celle de Marx qui montre que la monnaie est
l’instrument permettant l’achat de la force de travail génératrice de plus-value pour
grossir le capital au cours des différentes métamorphoses que celui-ci subit : K-argent,
K productif, K-argent.
La monnaie est alors la représentation du travail vivant créateur de valeur, la
monnaie est la valeur par excellence. Mais la monnaie dissimule le rapport social
d’exploitation, l’aliénation du travail.
Sans monnaie, il n’y a pas possibilité de transformer de la plus-value en profit.
Pour cela, le système bancaire anticipe le résultat du processus de production : il
prévalide le travail qui sera reconnu comme socialement utile par le marché.
La possibilité de la crise réside dans la contradiction entre la nécessité pour le
capital d’accomplir jusqu’au bout son cycle et l’impératif de dévaloriser le capital pour
pouvoir suivre le progrès technique et surmonter la concurrence.
Cependant, cette interprétation, la plus satisfaisante jusqu’ici, a l’inconvénient
de laisser supposer que la monnaie est uniquement liée à l’existence d’une société
marchande.
Quatrième interprétation
Une quatrième interprétation permet de prendre en compte ce dernier aspect :
les anthropologues soulignent le fait que même les sociétés que nous appelons
primitives connaissaient la monnaie dont la fonction était d’assurer le lien social.
Avant d’être un outil du marché, la monnaie est un outil de communication sociale.
Pour reprendre l’expression de Marcel Mauss, elle est un « fait social total ».
Non seulement, elle est le reflet des antagonismes sociaux et des rapports de
pouvoir (en cela, cette interprétation rejoint celle de Marx), mais elle exprime la
tentative désespérée de l’homme de fuir sa condition ou de lui trouver un exutoire :

3
l’angoisse de la mort, le spectre de celle-ci sont éloignés, exorcisés par la passion de la
richesse que permet d’assouvir l’argent. En accumulant biens matériels et symboles
que la monnaie permet d’acquérir, on conjure le sort funeste qui nous est promis.
La monnaie est alors un moyen de canaliser la violence à l’intérieur des sociétés
vers cette soif de richesse, exutoire à l’angoisse morbide le plus accessible, et passion
susceptible de dégénérer de façon un peu moins violente que la passion du pouvoir ou
le fanatisme religieux. Ceci est l’interprétation de René Girard.
A partir de là, cette conception de la monnaie connaît deux variantes. L’une, qui
est bien représentée par une partie de l’école des conventions (A. Orléan) rejointe par
une partie de l’ex-école de la régulation (M. Aglietta), considère que la monnaie est
l’acte fondateur de la société. Elle se démarque donc de la théorie classique qui situait
cet acte fondateur dans le seul échange entre individus autonomes hors de tout
environnement social et dans le contrat qu’ils nouent. Cette première conception n’a
plus besoin de la théorie de la valeur.
L’autre variante, que l’on peut rattacher à la problématique marxienne, continue
d’adosser la théorie de la monnaie à la théorie de la valeur parce que le travail est
l’acte par lequel les hommes vont nouer des rapports sociaux dans lesquels la monnaie
joue son rôle (voir plus haut, 2° interprétation).
Les troisième et quatrième interprétations n’aident en rien pour savoir s’il faut
augmenter ou diminuer les taux d’intérêt mais elles sont précieuses pour comprendre,
d’une part, la financiarisation du capitalisme (3° interprétation) à l’époque de la crise
financière, d’autre part le rôle social de la monnaie (4° interprétation) à l’époque où
l’on parle de dissolution du lien social et où certaines monnaies nationales vont
disparaître prochainement.
Les deux premières interprétations se disputent le leader-ship au sein de
l’orthodoxie et de multiples débats opposent les économistes orthodoxes. Un premier
débat oppose ceux qui considèrent la monnaie comme exogène, c’est-à-dire que, en
situation d’inconvertibilité, l’offre globale de monnaie dépend des seules autorités
monétaires au comportement spontanément laxiste ; et ceux qui considèrent la
monnaie comme endogène, c’est-à-dire créée par le système bancaire en réponse aux
besoins de l’activité économique (conception de Wicksel, d’I. Fisher en 1933, et de
Keynes).
Au sein des premiers, un débat partage ceux qui pensent que la monnaie n’a que
des effets nominaux sur l’économie (conception de la monnaie-voile qui voit une forte
dichotomie entre la sphère réelle et la sphère monétaire : TQM, Currency shool, I.
Fisher de 1911, NEC) ; et ceux qui pensent que la monnaie a des effets réels
(conception de la monnaie active). Mais au sein de ces derniers, certains pensent que
les effets ne sont que transitoires (dichotomie faible : Friedman) ; d’autres pensent que
les effets sont durables et dommageables (pas de dichotomie : Hayek, Rueff).
1.1.2. L’objectif principal de la banque centrale
A l’époque où les taux d’inflation étaient élevés, l’objectif fut de réduire, voire
d’éliminer l’inflation. Une fois cet objectif atteint, l’objectif fut de maintenir l’inflation
à un taux très faible.

4
Les justifications de ce choix sont puisées dans la théorie d’inspiration néo-
classique, principalement la branche monétariste de M. Friedman et celle des
nouveaux classiques travaillant sur l’hypothèse des anticipations rationnelles.
- Comme la monnaie est considérée comme neutre pour les variables réelles,
sauf à court terme, la masse monétaire doit être contrôlée et il faut éviter d’en faire un
instrument d’action sur la conjoncture qui se révèlerait nuisible à long terme pour la
stabilité des prix.
- Pour les tenants des anticipations rationnelles, la monnaie étant neutre même à
court terme, la politique monétaire n’aurait d’effet réel que si elle n’était pas anticipée.
Au total, les justifications de la priorité exclusive donnée à la lutte contre
l’inflation peuvent se résumer par le concept de crédibilité. La crédibilité de
l’ensemble de la politique économique est subordonnée à la rigueur de la gestion
monétaire. Le problème est qu’il n’est jamais précisé aux yeux de qui cette crédibilité
doit être assurée. Dans le meilleur des cas, il est dit qu’il s’agit de la crédibilité auprès
des marchés financiers. C’est mieux que rien mais c’est insuffisant. Parce que les
marchés financiers sont ici un euphémisme pour désigner les détenteurs de capitaux
dont l’exigence de rentabilité s’est progressivement élevée au cours des dernières
années. La lutte contre l’inflation est donc un dispositif central dans le processus de
financiarisation de l’économie capitaliste, celle-ci étant elle-même la forme
contemporaine revêtue par l’accumulation du capital.
Dire que la stratégie de lutte contre l’inflation était la seule possible sans
préciser ce qui précède est trompeur. Cette stratégie était la seule compatible avec la
nécessité de restaurer la rentabilité du capital.
Il faut donc en venir à la possibilité de poursuivre simultanément plusieurs
objectifs. Est-il possible d’assurer une croissance équilibrée sans inflation ouverte ni
trop rampante accelerando et en même temps avec un plein-emploi, voire un
commerce extérieur équilibré ? Bref, tout à la fois : les délices du paradis et les
coquineries diablotines et jouissives.
Une politique monétaire expansive pour l’emploi oblige à une course non pas
entre salaires et inflation comme on le dit, le répète et le lit partout, mais entre les
salaires et les profits, avec une résultante sur les prix. Poursuivre plusieurs objectifs
pose donc un problème de répartition. Problème qui est nié avec une politique de
l’objectif unique parce qu’on fait implicitement le choix de l’austérité salariale et de
l’opulence capitaliste.
Le taux de chômage naturel (qui n’accélère pas l’inflation) est une fadaise qui
permet d’éviter un autre concept : celui de taux de chômage qui laisse inchangé le
rapport de forces capital/travail. Voici le schéma suggéré par P. Artus, pourtant néo-
classique bon teint.

5
Croissance du
salaire rée l
Augmentation de
la part des salaire s
Pour une dans la VA (1)
croissance de
la produc tivité Augmentation de
donnée la part des p rofits
dans la VA (2)
Chômage de ? (3) Chô mag e
(1) Accé lération de l’inflation ? oui, si les profits veu len t rep rendre leur pa rt
(2) Ra lentissement de l’inflation ? non, s i les salaires veu len t rep rendre leur pa rt
(3) Chômage d’équilibre ? d’ équilibre de quoi ?
- chômage nature l ? NAIRU ?
- chômage laissant inchangé le ra pport de forc es ca pital/trava il ?
Au cours des
dernières décennies, plusieurs configurations ont été constatées :
- après guerre : pluralité d’objectifs dans des économies encore assez fermées.
- Etats-Unis : politique adaptable aux fluctuations de la conjoncture. L’inflation
est jugée par rapport à l’objectif de long terme et par rapport à l’écart PIB-PIB
potentiel. S’il y a un gros écart négatif, on favorisera la croissance et l’emploi ; s’il est
faible, on sera plus vigilant en matière d’inflation.
- Dans la période récente, notamment depuis la multiplication des risques
d’instabilité financière, les banques centrales ont ajouté un objectif : pour éviter que
tout dégénère, jouer le rôle de prêteur en dernier ressort international
Reste une question : l’inflation est-elle un mal en soi ? un mal pour certains
groupes sociaux ? un mal nécessaire ?
L’inflation réduit le pouvoir d’achat de la monnaie à revenus nominaux
constants. Mais comme les revenus nominaux ne restent jamais constants et qu’ils ne
se modifient jamais de manière homothétique pour tous les individus et tous les
groupes sociaux, alors l’inflation provoque une modification de la répartition des
revenus. Le problème est de savoir au profit et au détriment de qui. Si c’est à
l’avantage de ceux qui ont la propension marginale à consommer la plus forte, alors
cela tire la consommation, la production et/ou les importations vers le haut. Pendant
les 30 Glorieuses, la progression des salaires parallèle à celle de la productivité et leur
indexation sur l’inflation rampante étaient vertueuses. En 1981-82, la hausse du
pouvoir d’achat s’est traduite par des importations supplémentaires. Aujourd’hui, le
blocage des salaires et l’inflation financière nourrissent les revenus du capital.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%