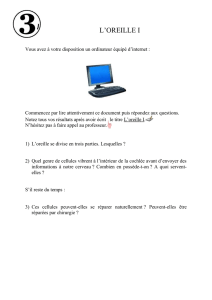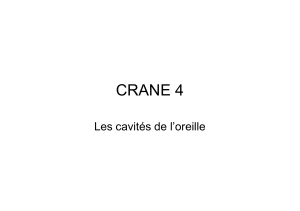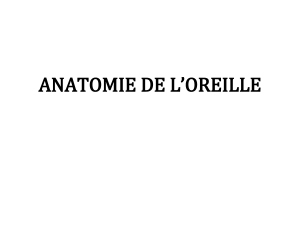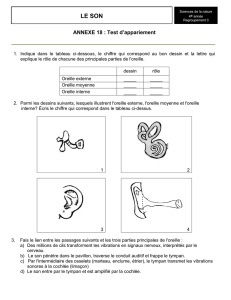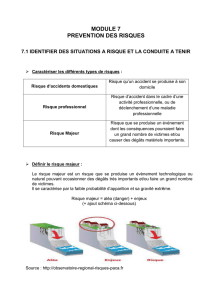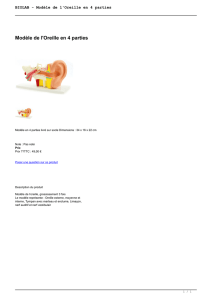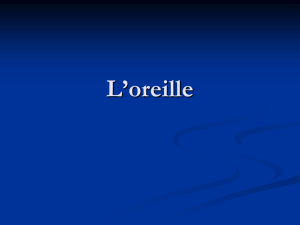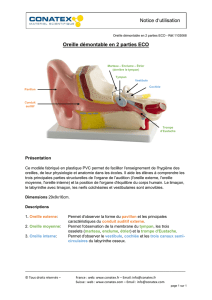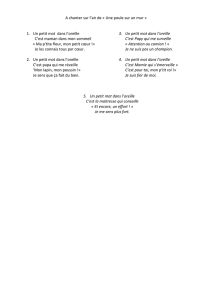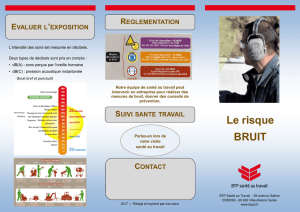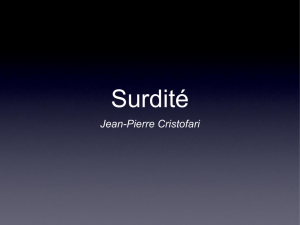"une infection" virus

Le système auditif Laetitia SICARD
Cours N4 du 01 / 03 / 15
Plan : 1.Anatomie de l’organe
- description
- fonction d’équilibre et d’audition
2. L’audition
- la perception des sons
- l’audition subaquatique
3. Les atteintes en plongées
- Les atteintes barotraumatiques
- Rappel : l’ ADD vestibulaire
4. La prévention
- Les manœuvres d’équilibrage
- Le rôle du GP
Justification : L’oreille est un organe fragile extrêmement sollicité en plongée. Il est primordial de connaitre les
risques de lésions qui lui sont liés afin de préserver ses fonctions essentielles d’équilibre et d’audition.
1. Anatomie de l’organe
- Description
Diapo avec schéma
Le pavillon entoure l’entrée du conduit externe. Ce conduit se poursuit jusqu’au tympan : c’est une fine membrane
composée de 3 couches de peau très fine. Il sépare l’oreille externe de l’oreille moyenne.
L’oreille moyenne est une cavité remplie d’air contenant la chaine des osselets : contre le tympan on trouve le
marteau, relié à l’enclume puis l’étrier.
La trompe d’Eustache part du bas de l’oreille moyenne en direction du rhino-pharynx (partie haute de l’arrière
gorge), cet étroit conduit en forme de 2 cônes reliés par leur sommet, est long en moyenne de 3,7 cm. Il permet
l’équilibrage de l’oreille moyenne de part son ouverture et fermeture possibles grâce à l’action des muscles
péristaphylins l’entourant.
L’oreille interne débute avec la fenêtre ovale, orifice d’entrée de la cochlée, à laquelle est relié l’étrier. Juste en
dessous se trouve donc la cochlée tube enroulé sur lui-même et remplie de liquide : le périlymphe. Cet « escargot »
débouche sur la fenêtre ronde avec retour vers l’oreille moyenne.

Au dessus de la cochlée se trouve le vestibule composé de 3 partie :
la plus haute - 3 canaux semi circulaires, orientés sur les 3 plans de l’espace et sont remplis de liquide :
l’endolymphe
En dessous - l’utricule : poche remplie elle aussi par l’endolymphe tout comme
- le saccule situé juste en dessous près de la cochlée.
Du vestibule part le nerf vestibulaire qui rejoint le nerf cochélaire pour former le nerf auditif.
- Fonction d’équilibre et d’audition
Le vestibule est consacré à l’équilibre. Les canaux semi circulaires tout comme l’utricule et le saccule sont pourvus de
« cils » qui oscillent dans l’endolymphe. Les canaux sont sensibles aux mouvements de rotation tandis que l’utricule
et le saccule renseignent le cerveau sur les mouvements latéraux et verticaux. Notre position par rapport au sol et
toute rotation et accélération sontdonc détectées par ces organes et transmis au cerveau via le nerf vestibulaire.
Le tympan, la chaine des osselets et la cochlée sont eux dédiés à l’audition.
2. L’audition
- La perception des sons
Les vibrations de l’air qui composent les sons, pénètrent dans le conduit externe et atteignent le tympan en le
faisant vibrer. Le tympan met en mouvement la chaine des osselets (amplification de 20 fois la vibration
tympanique): le marteau, l’enclume puis l’étrier. Ce dernier est relié à la fenêtre ovale qui est l’entrée de la cochlée.
Les vibrations actionnent donc les cellules cillées situées à l’intérieur,dans la périlymphe, qui transforment ce
mouvement en impulsions électriques que le cerveau recevra et traduira grâce au nerf cochélaire.
La vibration initiale est évacuée dans l’oreille moyenne par la fenêtre ronde après avoir parcouru toute la cochlée.
Visualisation sur le schéma
- L’audition subaquatique
Sur terre le son se propage à une vitesse de 330 m/sec. A cette vitesse et selon la provenance des sons, les ondes
atteignent l’un de nos tympans légèrement avant l’autre et de ce fait une oreille perçoit donc le bruit avant l’autre
indiquant ainsi la provenance du son, c’est ce que l’on appelle le déphasage. Dans l’eau, milieu plus dense que l’air,
les sons ont une vitesse de propagation d’environ 1500 m / sec. Les ondes y sont de faibles amplitudes et
actionnent très faiblement nos tympans, elles sont en revanche transmises par voie osseuse dans la boite crânienne
directement dans les cellules cillées des 2 cochlées et quasiment en même temps. Notre cerveau ne peut donc plus
distinguer la provenance des sons, nous perdons notre audition stéréophonique terrestre.
Cela implique une grande vigilance dans l’espace proche en cas de bruit de moteur. Nous l’entendons très bien mais
nous ne savons pas d’où il provient.

3. Les atteintes en plongée
- Les atteintes barotraumatiques
L’otite barotraumatique de l’oreille moyenne : il se produit en cas d’équilibrage tardif et / ou brutal ou bien
lors d’une descente trop rapide. Le tympan se déforme alors à l’extrême et se congestionne.
Symptômes : douleurs, bourdonnements, baisse de l’audition
La phase critique de l’otite barotraumatique est la perforation du tympan. L’eau envahie alors l’oreille
moyenne (apport de bactéries)
Symptômes : avec ou sans douleurs, saignements éventuels, vertiges, acouphènes, surdité temporaire…
Barotraumatisme de l’oreille interne : survient souvent suite à un Valsalva brutal qui met en surpression
l’oreille moyenne. Cette surpression est transmise à l’oreille interne via les fenêtres ronde et ovale,
ébranlant ainsi brutalement les liquides labyrinthiques et menaçant les centres de l’audition et de l’équilibre.
C’est le coup de piston (étrier sur la fenêtre ovale ou bien sur la fenêtre ronde directement).
Symptômes : vive douleur, acouphènes, vertiges,…
Il peut aussi se produire la rupture de la fenêtre ovale par rapport à l’étrier, sans douleur particulière mais
qui peut conduire à des séquelles faute de prise en charge médicale. Il est donc important de consulter un
médecin ORL pour toutes gênes persistantes et consécutives à une plongée.
Le vertige alterno-barique : est du à un retard d’équilibrage d’une oreille par rapport à l’autre. En effet, lors
de la remontée, une trompe d’Eustache peut s’obstruer et gêner l’équilibrage naturel d’une des 2 oreilles
moyennes.
Symptômes : important vertige pouvant aller jusqu’à la syncope ( donc avec risques de noyade). C’est un
incident fugace et bénin mais devant être pris au sérieux quant à ses conséquences. Il suffit de stopper
momentanément la remontée, prendre en charge la personne concernée en se tenant très proche d’elle.
Déglutir peut permettre de rétablir la situation mais JAMAIS de Valsalva.
L’otite infectieuse : n’est pas un accident barotraumatique à proprement parler. Il s’agit d’une infection du
condit externe du à des bactéries présentes dans l’eau. Plus cette dernière est chaude, plus la présence de
microbes et bactéries est importante.
Symptômes : forte douleur tympanique qui irradie, constitue une contre-indication passagère à la plongée.
Consultation d’un médecin ORL ou généraliste
En prévention : bien se rincer le conduit externe à l’eau tiède après chaque plongée, bien le sécher et
éventuellement utiliser de l’huile d’amande douce avant de plonger afin de former un film hydrofuge dans le
fond du conduit et sur le tympan pour éviter la macération d’eau contre ces tissus.
- L’ADD vestibulaire
Cet ADD représente 25 à 30 % des ADD. Il est en augmentation puisqu’il représentait 10 % il y a 20 ans. En
Mer Rouge par exemple le taux de cet ADD par rapport au total des ADD est de 40 %.

2 types de formation :
Une bulle tissulairepeut se former dans l’endolymphe ou la périlymphe (1/3 des cas d’ADD de l’oreille) suite
par exemple à des remontées multiples ou rapides avec dégazage des liquides de l’oreille interne.
Une bulle artérielle cette fois (2/3 des cas) arrive dans l’artère vestibulaire et bloque l’irrigation des organes
de l’oreille interne.
Dans 75% des cas d’ADD cochléo-vestibulaire, il y a présence d’un FOP. Ce dernier est donc un
facteur clairement aggravant.
Dans les 2 cas : vertiges, nausées, perte d’équilibre, vomissement,…
Déclenchement des secours en cas de suspicion : appel CROSS au 196 depuis un tel portable ou canal 16 sur une
VHF, mise sous O2 100% 15L/min et hydratation 1L d’eau en 1 heure. Voir cours sur les ADD pour plus de détails.
4. La prévention
- Les manœuvres d’équilibrage
La mise en équipression de l’oreille moyenne est possible grâce à la trompe d’Eustache. La morphologie même de ce
conduit tapissé de muqueuse et les éventuels encombrements s’y trouvant expliquent les difficultés voire
l’impossibilité à « faire passer les oreilles » lors de certaines plongées.
Schéma des 3 types de trompes
Ces 2 conduits sont normalement fermés et ne s’ouvrent que par l’action des muscles péristaphylins et lors de la
déglutition.
Leur perméabilité dépend donc :
- leur rectitude
- l’état de la muqueuse (inflammation, mucus,…)
-la tonicité des muscles péristaphylins
On distingue plusieurs types de manœuvre d’équilibrage à la descente :
Les méthodes actives : qui par une action musculaire volontaire et une mise en surpression des voies
aériennes forcent l’ouverture des trompes
Valsalva : la plus connu car la plus facile mais la plus traumatisante aussi. Bouche fermée, nez pincé, contraction des
abdominaux afin de faire remonter le diaphragme et d’expulser le volume d’air des poumons vers le pharynx. La
surpression thoracique occasionnée favorise l’ouverture des FOP et shunts pulmonaires et provoque une ouverture
violente des trompes. JAMAIS A LA REMONTEE
Frenzel :bouche fermée, elle consiste à envoyer l’air contenu dans le rhino pharynx dans les trompes d’Eustache par
un mouvement arrière de la langue vers le palais. La glotte doit donc être fermée et le nez pincé (réalisation
possible avec le nez dégagé). Le volume d’air mobilisé est ainsi beaucoup plus faible que pour un Vasalva, l’ouverture
des trompes moins brutale.
Lowry : c’est une variante de Valsalva : nez pincé, bouche fermée, souffler doucement par le nez en déglutissant.
L’action de déglutition empêche une hyperpression thoracique et donc une manœuvre brusque.

Edmonds : consiste à avancer la mâchoire lors de la réalisation d’un Valsalva ou Frenzel. Le mouvement de mâchoire
empêche là aussi une action violente au niveau de la trompe.
Les méthodes passives : il n’y a pas de sollicitation du thorax mais un maintien volontaire de l’ouverture des
trompes
Déglutition : nez et bouche ouverts, peut suffire chez les personnes bénéficiant de trompes rectilignes
Béance Tubulaire Volontaire (BTV): par l’action des muscles peristaphylins les trompes restent ouvertes durant la
descente et s’équilibrent donc au fur et à mesure du changement de pression. Cette manœuvre nécessite de
prendre conscience des muscles sollicités et peut demander un apprentissage (gymnastique tubaire). La sensation
est proche d’un début de bâillement, la langue maintenue vers le palais peut aider à la réalisation
Equilibrage à la remontée :
En toute logique les oreilles s’équilibrent naturellement à la remontée mais en cas de difficulté :
Toynbee : bouche fermée et nez pincé, inspirer légèrement par le nez tout en déglutissant. Il s’agit de l’inverse de la
méthode de Valsalva qui permet de soustraire de l’air à l’oreille moyenne
- Le rôle du GP
Avant la plongée :
- Veiller à ce que les personnes soient à l’abri du vent et du froid car cela favorise la congestion des tissus, conseiller
le port d’un bonnet
- Faire connaissance avec les personnes, les rassurer notamment les débutants toujours un peu anxieux. Les tensions
musculaires induites par le stress ne favorisent pas un bon passage des oreilles.
- Durant le briefing bien rappeler de ne pas attendre la douleur pour équilibrer et toujours le faire avec douceur
- Rappeler systématiquement de ne pas forcer si des difficultés apparaissent et de le signaler immédiatement
- Se renseigner sur les antécédents : ancienne perforation, difficultés récurrentes,…et renforcer votre vigilance
-Toujours rappeler de ne jamais effectuer de Valsalva à la remontée
Pendant la plongée :
- En surface faire rentrer de l’eau dans les cagoules afin d’éviter le phénomène de succion à la descente pouvant
blesser le tympan
- Effectuer une descente lente, tête en haut pour une surveillance optimum.
- Privilégier une descente au mouillage ou le long d’une roche plutôt qu’en pleine eau : un repère visuel rassure et
permet de prendre appui le cas échéant
- Rester très proche des personnes de manière à intervenir rapidement en cas de difficultés : maintien, assistance
- Etre vigilant lors de la remontée en cas de vertige alternobarique
 6
6
1
/
6
100%