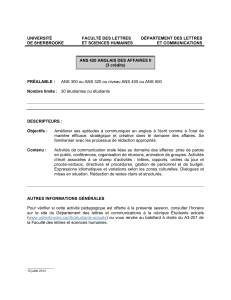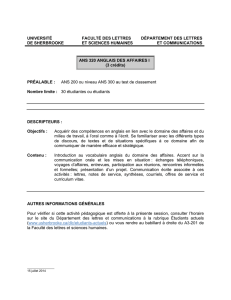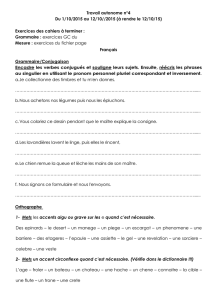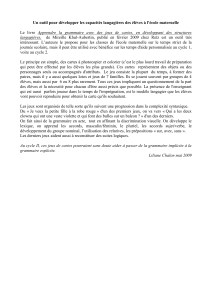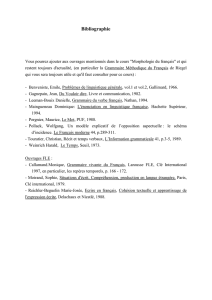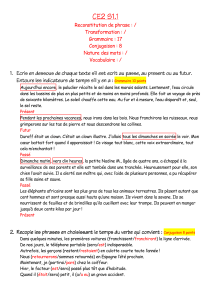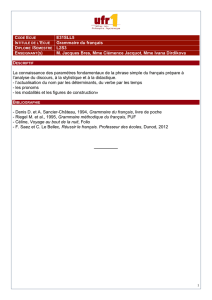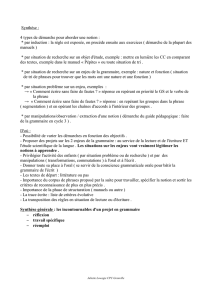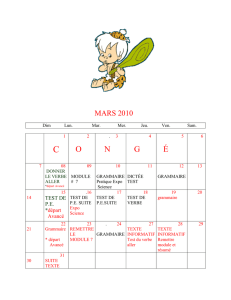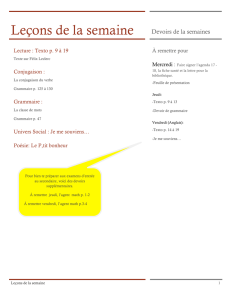Introduction à l`étude de la grammaire Par Sandra Leroy Avant donc

INTRODUCTION A L’ETUDE DE LA GRAMMAIRE
Par Sandra Leroy
Avant donc que d'écrire, apprenez à penser.
Selon que notre idée est plus ou moins obscure,
L'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure.
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément.
Boileau, Art poétique, I
Qu’est ce que la grammaire ? Et pourquoi l’étudier au XXIème siècle ?
La réponse à ces deux questions nous semble ici, à l’ILFM, évidente. La grammaire
est l’art de parler et d’écrire correctement. Elle est composée de règles, elle classifie et
ordonne les différents éléments qui composent notre langue et elle s’accompagne
naturellement d’exercices.
Nous savons que l’enseignement de la grammaire a subi ces dernières décennies de
très grandes mutations, il s’est transformé au gré des vents idéologiques, sociaux et
politiques. Il est vrai que la question de la grammaire, tout comme celle de l’orthographe
d’ailleurs, est un véritable enjeu de société qui cristallise de nombreuses crispations.
Chacun a son avis sur la grammaire, sans vraiment savoir de quoi il s’agit !
Et si nous sommes réunis cette année, c’est que nous avons tous un même avis, le
même a priori sur la chose grammaticale. Nous nous engageons d’emblée sur la voie de la
tradition. Mais en grammaire, la tradition, lorsqu’on l’examine, nous laisse devant un
amas de théories, de terminologies, de conceptions très variés. Que faire de cette tradition
grammaticale dont nous nous prévalons souvent en réaction face à la linguistique qui
domine depuis quelques décennies, et qui a été imposée dans les salles de classe de
manière souvent assez surprenante ?
Nous allons ici revenir sur l’histoire de la grammaire depuis ses origines pour
constater que ces querelles ne sont pas nouvelles, et que la grammaire que nous avons
entre les mains et que nous utiliserons cette année, est le fruit d’une longue évolution au
fil des siècles mais aussi le résultat de choix fondamentaux. Car la grammaire,
contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, est une science en perpétuelle évolution. La
langue n’est pas figée, nous le savons, elle évolue constamment, et la grammaire, qui est
avant tout une réflexion sur la langue et son fonctionnement, et elle aussi en constant
mouvement.
Le grammairien fait des choix. Comment organiser la langue, comment la présenter,
comment hiérarchiser les faits de langue, comment nommer, comment rendre compte du
fonctionnement de la langue ? Ce sont des questions que chaque maître doit se poser

avant de faire sa première leçon. Et comment plus précisément, rendre l’étude de cette
matière digeste afin de faire comprendre aux élèves la nécessité de maîtriser la
grammaire pour comprendre, parler, écrire, lire et pour finalement exprimer sa pensée,
et devenir un homme libre ?
Les phénomènes grammaticaux que nous pensons souvent être immuables et fixés
depuis l’origine de la langue, sont souvent apparus tardivement au gré de la réflexion de
tel ou tel grammairien, linguiste ou philosophe. Chacun s’inspire des travaux de ses
prédécesseurs, les complète ou bien lance ses propres innovations qui auront plus ou
moins de postérité.
D’ailleurs, la grammaire traditionnelle telle que nous la concevons actuellement est
née de la Révolution et du XIXe siècle. La notion de grammaire normative et formelle est
s’est développée à cette époque ainsi que la systématisation de l’exercice et de l’analyse
grammaticale scolaire.
Nous allons très sommairement effectuer un petit tour d’horizon de l’histoire de la
grammaire en en dégageant les grandes périodes afin de mieux comprendre les enjeux
fondamentaux de cette discipline essentielle. La grammaire étant perméable aux époques
et aux courants politiques et idéologiques, son évolution suit celle des grandes périodes
de l’Histoire.
I- Les grammaires des origines
On s’imagine souvent que la grammaire, en tant que réflexion sur la langue, est née
en Grèce. Or, il n’en est rien. La première grammaire est une grammaire du sanscrit, celle
de Panini, retrouvée en Inde et elle daterait du 4e siècle avant notre ère. Elle décrit
particulièrement bien les sons de cette langue.
Il faut dire, que l’apparition de la grammaire va de pair avec le développement de
l’écrit. Comment transposer par écrit les sons ? Répondre à cette question c’est faire de la
grammaire, c’est proposer des moyens de reconnaissance et de concordance entre le
pictogramme et le mot par exemple dans l’écriture chinoise ou sumérienne.
Il faudra attendre le premier alphabet complet avec un système de décomposition
syllabique du mot grâce à la présence de voyelles et de consonnes pour assister à la
naissance de la grammaire et de la réflexion sur la langue. Platon et Aristote théorisent la
langue et en proposent une métaphysique. On peut d’ailleurs considérer Aristote comme
le père de la grammaire en occident. Il invente la théorie des dix parties du discours, et sa
grammaire repose sur la logique. A l’origine, la grammatikè technè ou épistémè désigne
d’abord l’art de savoir lire les lettres de l’alphabet, dites grammata. Ensuite, la grammaire
a étendu son domaine à l’étude de toute activité de parole ou d’écriture (prononciation,
orthographe, vocabulaire, maîtrise des règles…). Elle est liée à la rhétorique en tant qu’art
de la parole.

II- Les premières grammaires du Moyen-Age
En France, au Moyen-Age, l’enseignement est dominé par les langues anciennes, le grec et
plus fortement le latin. C’est la grammaire latine de Donat qui sert de modèle et de
référence. A cette époque, le français n’existe pas en tant que tel, on parle divers dialectes,
regroupés sous l’appellation langues d’oc au sud de la Loire et langues d’oil au nord.
Progressivement, les langues locales prennent de l’autonomie par rapport au latin et la
langue qui s’impose est celle parlée à la cour du roi. Cette langue est en usage d’ailleurs à
la cour des rois d’Angleterre, de Sicile (d’origine normande) ; elle ne cesse d’accroître son
prestige. Et au XIIè siècle, ne pas parler le français de l’aristocratie parisienne est
considéré comme une honte. Parallèlement à ces évolutions apparaissent des théories qui
viennent légitimer l’emploi des langues locales par rapport au latin considéré encore à
l’époque comme la langue de référence. C’est donc l’apparition et le développement des
nouvelles langues comme l’italien, l’espagnol ou le portugais qui va entraîner celle des
premières grammaires qui décrivent ces nouvelles langues.
Pour le français, ce sont les anglais qui les premiers créent des glossaires ou des
tableaux afin de faciliter la traduction en français. Ce sont de véritables manuels
d’utilisation où l’on pratique l’éloge du français : « le plus gracieux parler qui soit au
monde et de tous gens mieux prisé et aimé que nul autre » peut on lire dans un de ces
manuels destiné aussi bien aux traducteurs qu’aux marchands.
Au Moyen-Age, la grammaire entre dans l’enseignement des Arts Libéraux, et est une
des disciplines du Trivium à côté de la dialectique et de la rhétorique, le quadrivium
réunissant l’arithmétique, la géométrie, l’astronomie et la musique.
III- Les grammaires françaises de la Renaissance
Le phénomène majeur et révolutionnaire de la Renaissance est l’invention de
l’imprimerie. En effet, les progrès de l’imprimerie exigent une régulation et une fixation
de la langue. Les imprimeurs ont besoin de règles de transcription et une fois encore, c’est
l’écriture, la graphie qui pousse en avant la grammaire. A cette époque, on propose des
comparaisons avec la langue latine, et on voit apparaître une Grammatica latino-gallica
qui, calquée sur le latin regroupe les formes propres au français. Notre langue, pendant la
période humaniste, est admirée et diffusée, les humanistes voient dans l’étude de la
langue, un des moyens de parvenir au bonheur. Du Bellay écrit d’ailleurs en 1549 une
Défense de la Langue française.

La grammaire latine est considérée comme le modèle absolu. C’est l’élaboration de
manuels d’apprentissage des langues étrangères qui permet de rendre les grammaires de
cette époque bien plus fonctionnelles.
Un des grands grammairiens humanistes, nommé Ramus, établit en 1562 une
grammaire qui se présente comme un dialogue entre le maître et l’élève. La grammaire
devient alors indissociable de la pédagogie, c’est à dire de son enseignement.
D’autres comme Henri Estienne cherchent dans leurs ouvrages non seulement à légitimer
la langue française par rapport au latin, mais aussi à distinguer la bonne langue française
du parler du peuple. Il s’agit d’une opération de purification et de perfectionnement de la
langue. La réflexion sur le langage est désormais coupée de la réflexion métaphysique des
grecs. Les grammairiens puristes apparaissent. Ils passent la langue et ses usages au
crible, ce qui implique l’existence de normes.
Ainsi, à la fin du XVIè siècle, Pasquier fait des reproches à Montaigne à propos de la
forme de ses Sentences. Selon lui il use de mots inaccoutumés qu’il lui reproche d’aller
chercher en dehors de la réserve de mots admise dans les milieux lettrés. Il lui reproche
aussi d’employer des tours syntaxiques familiers aux gascons et non pas aux français.
IV- Les grammaires de l’âge classique
A l’époque classique, le latin n’est plus la langue de référence qu’il a été jusqu’alors.
Il est de bon ton dans de nombreux pays européens d’apprendre le français, tout comme
en France, on s’enorgueillit de savoir l’italien ou l’espagnol. Les grammairiens vont donc
proposer un arsenal pédagogique hérité des méthodes vivantes d’apprentissage du latin
développées au XVIe siècle. Ainsi, Charles Maupas, un des plus célèbres de ces
grammairiens écrit-il en 1625, une Grammaire et Syntaxe française contenant règles bien
exactes et certaines de la prononciation, orthographe, construction et usage de notre langue
en faveur des étrangers qui en sont désireux. La démarche adoptée par Maupas est toute
nouvelle, il ne se réfère plus aux modèles du latin mais il observe les usages en place chez
des sujets choisis. Pour lui, c’est l’usage qui prime sur toute autre considération en
matière de grammaire. Il s’inscrit dans la tradition classique de l’usus mais au service du
bon goût. Le grammairien prend acte des irrégularités, ne tente pas de les réduire à la
norme pourvu qu’ils soient « artistement agencés ». Le grammairien n’est plus un
philosophe dans l’acception antique du terme, il n’a pas de vocation transcendentale non
plus, il ordonne, classe. Maupas, comme Charles Oudin son contemporain dont les deux
ouvrages de 1632 et 1640 ne sont que des reprises de ceux de Maupas, sont d’abord des
pédagogues professionnels. Oudin contribue à débarrasser la grammaire de Maupas de
tous les tours provinciaux qui y pullulaient. Il dit avoir reconnu chez Maupas « force
antiquailles à reformer ». Oudin s’attaque à la mauvaise prononciation qui choque les
oreilles délicates.

C’est ce type de raisonnement qui sera aussi adopté par le célèbre Vaugelas dans ses
Remarques sur la langue françoise en 1646, pour qui l’usage de la Cour prime. Vaugelas
est un mondain intelligent qui mit ses talents au service des grands de son époque.
Membre de l’Académie dès sa création en 1634, il se consacrera au dictionnaire jusqu’à sa
mort. Pour lui le dictionnaire est inséparable de la grammaire qu’il débarrasse de ses
longs catalogues et inventaires de mots.
Le modèle de la langue parfaite doit être trouvé à la Cour et auprès des bons auteurs.
Le principe central des travaux de Vaugelas est d’atteindre la perfection, l’harmonie et le
bon goût. Vaugelas propose dans son ouvrage un recueil d’observations sur le bon usage.
Il recommande d’écrire comme on parle : « La plus grande des erreurs en matière d’écrire
est de croire, comme font plusieurs, qu’il ne faut pas écrire comme l’on parle. » Il n’y a pas
une langue parlée et une langue écrite, mais un style noble ou bas, un genre sublime ou
familier.
Il s’agit d’éliminer de la langue tous les mots jugés bas ou techniques ou provinciaux.
La cour et les bons auteurs acquièrent une dimension universelle. Les irrégularités,
lorsqu’elles se présentent montrent que le langage est une invention humaine. A l’époque
classique, la langue française a enfin conquis ses lettres de noblesse par rapport au latin,
et semble à tous capable de produire elle aussi ses propres génies.
La Grammaire Générale de Port Royal :
La Grammaire Générale Raisonnée parue en 1660 va avoir un destin incroyable. Elle
propose un dispositif d’ensemble sans précédent. Elle puise sa source dans la pédagogie
de l’apprentissage du latin. La grammaire est inséparable de la logique. Mais la nouveauté
est que cette grammaire de Port Royal a un caractère très général. Elle est conçue pour le
français mais est sensée pouvoir s’appliquer à toutes les langues. Le concept même de
règles universelles apparaît.
Les religieux de Port Royal fixent un ensemble de règles qui, avec quelques ajustements
peuvent s’appliquer à toutes les langues. Les jansénistes, théologiens et grands bourgeois
cherchent à joindre la recherche de la Vérité en Dieu et les nouveautés artistiques et
scientifiques. La religion chrétienne étant celle de la Parole, l’analyse des faits de langue
est absolument décisive. Il faut rechercher la vérité dans l’analyse de la langue car c’est
par la langue que la Parole peut s’épanouir dans sa vérité. De plus, les jansénistes sont de
grands pédagogues et réfléchissent sur la transmission du savoir aux enfants. Leur
démarche repose non sur la répétition mais sur l’analyse et la réflexion. Ils proposent
donc une grammaire logique qui s’efforce d’établir des rapports entre les lois du langage
et celles de la pensée pour arriver à cette vérité d’ordre spirituelle.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%