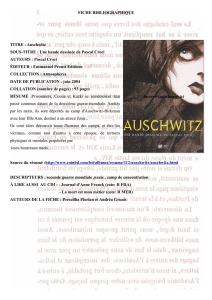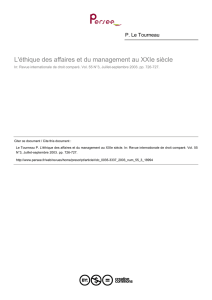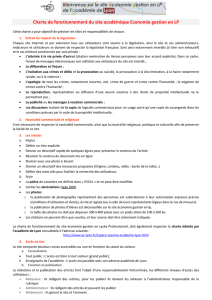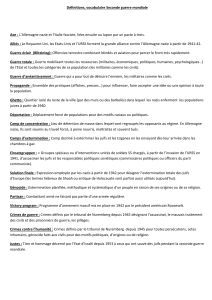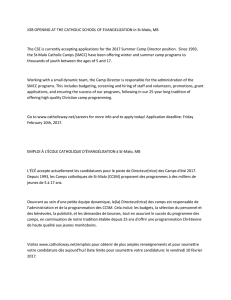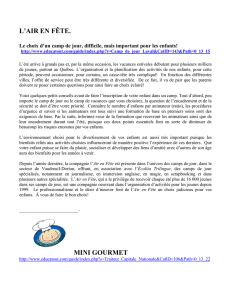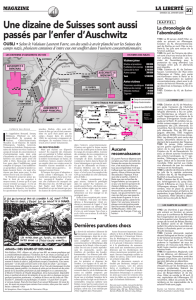Du triomphe de l`Homme

3ème partie
3
Du triomphe de l’Homme (et du droit ?)
Lutter
Le triomphe de l’Homme
De longues colonnes, colonnes de robes rayées, de numéros, d'ombres humaines; ce sont les détenues
du camp de concentration d'Oswiecim. C'est ainsi que les Allemands nous voyaient probablement,
c'est ainsi qu'ils avaient voulu nous voir, bien que parfois ils fussent déçus et leurs poings levés
retombaient alors soudain avec peur, paralysés par le regard d'une ombre humaine en vêtements rayés.
C'était comme un éclair du feu caché qui flambait sous le couvercle de la fatigue, de l'humanité brisée.
Il arrivait plus d'une fois que nos persécuteurs s'arrêtaient stupéfiés, hypnotisés par le regard et parfois
par une parole de leur victime désarmée.
Je me souviens de la figure d'un agent de la Gestapo frappé par ma réponse méprisante à sa proposition
de me sauver la vie au prix d'une lâcheté.
J'ai encore devant moi l'image d'une SS-Frau gênée qui contrôlait d'un regard avide un colis de ma
camarade Aline, tandis que celle-ci en remettait le contenu à une autre de nos compagnes. Je vois les
yeux baissés du commandant du camp lorsque, au cours d'une revue de santé passée au camp des
femmes, une jeune fille s'arrêta devant lui toute rouge de honte et de colère. Je n'oublierai jamais les
démarches pleines d'humilité d'un SS qui cherchait à passer pour un homme généreux aux yeux des
détenus.
Je me rappelle la colère impuissante d'un de nos chefs qui, ayant obligé en guise de représailles une
détenue à porter plusieurs pelles lourdes, aperçut soudain d'autres détenues entourer la malheureuse et
lui enlever toutes les pelles en la laissant les mains libres.
Je me souviens également de la rage d'une SS-Frau qui, voulant humilier une jeune détenue, lui a
enfoncé un vase de nuit sur la tête, tandis que celle-ci au lieu de pleurer lui a ri au nez.
Jamais ne s'effacera de ma mémoire la misérable figure d'un S.S. qui avait battu un prisonnier devant
les femmes pour le forcer à crier de douleur, quand ce dernier, bien qu'ensanglanté et tout couvert de la
boue dans laquelle on l'avait poussé, se fut levé en regardant droit et avec force devant lui. Le
bourreau, sentant sa défaite, cracha derrière l'homme qui s'éloignait en chancelant.
Il y avait des jours où les Allemands pompaient de nous toutes les forces dans un travail qui dépassait
la mesure d'une résistance humaine. Ça valait la peine de voir alors l'admiration qu'ils ne savaient pas
cacher pour les femmes qui, malgré leur fatigue, chantaient d'un air provocateur.
Tout en se sentant compromis, ils entraient en fureur lorsqu'une colonne de détenues se taisait malgré
l'ordre : « Ein Lied ! » (Un chant !) ou bien entonnait un chant en polonais. Ils se vengeaient en nous
forçant à marcher à travers la pire boue, mais même alors, ils ne réussissaient pas à se faire obéir.
Je me souviens encore d'une autre défaite allemande. C'était à Pâques 1944, le commandement du
camp nous avait ordonné un travail très sale et inutile pour se moquer de nous, le travail qui consistait
à transporter d'une place à l'autre dans la grange un tas de son. La poussière nous brûlait la figure,
couvrait nos vêtements, coupait la respiration et malgré cela, les femmes, entra vaillant avec une
lenteur voulue, chantaient Alléluia et d'autres chants de Pâques. Malgré les terribles tenailles qui nous
enserraient, plus d'une fois notre résistance collective et spontanée se manifestait à quelques occasions
de moindre importance, explosant comme un feu allumé par une étincelle qui partait de l'œil d'une de
nos compagnes de misère; elle se manifestait par la crampe de nos mâchoires, par un geste d'un poing
serré. Ces actes de résistance surprenaient tellement les Allemands que souvent ils ne savaient y réagir
dans leur rage impuissante qu'en laissant exploser leur colère et distribuant quelques coups à ceux qui
leur tombaient sous la main.(…)
Ne voulant pas provoquer la bête sans nécessité, nous évitions consciemment de regarder de leur côté,
nous arrêtions les sourires sur nos lèvres, nous cessions nos conversations, car les Allemands
supposaient toujours être l'objet de nos moqueries. Ils s'approchaient alors de nous et nous
demandaient ce que nous leur voulions. Les Allemands faisaient preuve d'une extraordinaire
susceptibilité, aussi se sentaient-ils très mal à leur aise lorsque les circonstances les mettaient en
présence d'un prisonnier que, pour une raison ou une autre, ils ne pouvaient pas frapper. C'est
seulement quand ils battaient les détenus ou procédaient à une « sélection » en vue de l'envoi au four
crématoire, qu'ils reprenaient leur assurance et avaient le sentiment d'agir en « race des seigneurs ».
Et cependant, malgré l'écrasante terreur physique et morale, une lutte continuelle couvait, le combat se

poursuivait contre les violences et pour la dignité humaine, pour le battement honnête du cœur humain,
pour la conservation de la vie physique. Cette résistance n'était pas toujours organisée, n'était pas
toujours celle de masse, même quand elle était spontanée, mais si la collectivité n'y prenait pas
toujours part, elle existait toujours comme une résistance individuelle.
Elle n'oubliera probablement jamais, Sala K..., les coups de poings que les SS faisaient tomber sur sa
figure pour s'être baladée dans le camp après le couvre-feu, quand elle portait à une camarade habitant
une autre baraque une chemise chaude volée au magasin. (…)
Sala avait sa propre philosophie de la vie au camp. Elle estimait que les Allemands ne pouvaient
jamais nous humilier, nous faire injure, même lorsqu'ils cassaient nos dents à coups de poings; car les
êtres humains se considèrent-ils comme insultés par un chien qui les mord ? Suivant Sala, l'honneur
d'une détenue n'était vraiment atteint que lorsqu'elle devenait soumise et servile à l'égard des autorités
allemandes. Sala serrait rarement ses mâchoires de colère; au contraire, elle rayonnait de sérénité en
puisant sa sagesse et son calme dans sa foi profonde en l'homme. Y avait-il dans la baraque 2 B des
femmes qui n'eussent pas connu Sala, la blanchisseuse de Cracovie, qui eussent ignoré qu'elles
trouveraient toujours auprès d'elle, dans chaque misère, conseils et secours, car Sala n'avait jamais
besoin de grand-chose pour elle et elle trouvait toujours quelque chose pour d'autres. Mais elles étaient
rares, les femmes que Sala honorait de son amitié.
Extrait de Pelagia Lewinska, Vingt mois à Auschwitz, Nagel, 1945, pages 184-189
« Créer un monde à eux, fermé à l'ennemi, un monde humain »
À cette époque, la rentrée des Kommandos au camp remplaçait l'appel du soir. Pour qui venait de
Buchenwald, c'était une fête véritable. Ne pas avoir à supporter deux ou trois heures d'appel sur la
grand-place ! Le maigre morceau de pain était vite avalé et alors, jusqu'à neuf heures du soir, il était
possible de se promener sur la place, d'aller d'un Block à l'autre en quête d'amis. Une vie de société
s'ébauchait. Les contraintes si cruelles à Buchenwald, se relâchaient ici quelque peu. Le repos était
plus grand à ces visites, à ces propos toujours rompus et repris, qu'à s'étendre tout de suite sur sa
paillasse dans l'atmosphère empestée et dans le tumulte du Block. J'allai ainsi avec René voir les
Belges au [Block] 18. Ils étaient réunis à la même table, des livres ouverts devant eux. Je gardais de
cette rencontre une impression saisissante. Ces hommes, qui avaient vécu la misère et l'angoisse
incomparables des premiers jours de Neuengamme, qui ne dénombraient plus les cadavres de
camarades, qui continuaient à être dans ce monde concentrationnaire sans issue raisonnable, où toutes
les chances de destruction demeuraient assemblées, ces hommes avaient réussi à force d'obstination et
d'audace, en pariant de toute leur puissance de vie contre le destin, à créer un monde à eux, fermé à
l'ennemi, un monde humain. Ils s'écartèrent pour me faire place. Ils étaient aimables, polis. Ils
m'offrirent sans plus de m'aider. Cependant, ils parlaient peu, comme avares de mots. Ils écoutaient
attentivement, et pourtant je devinais qu'ils écoutaient à peine. Ils s'étaient fait des choses et des gens
de la société civile dont je venais une représentation qu'ils ne discutaient plus. Les problèmes et les
émotions dont je parlais, qui avaient encore pour moi une fraîcheur, leur paraissaient lointains et
souvent insoutenables. Ils avaient monté leur réseau d'informations. Ils portaient leurs jugements
posément mais définitivement. Ils vivaient en circuit fermé et avaient perdu l'intérêt des réactions, des
malaises et des forces de la société libre. Et c'était précisément le sens de leur résistance profonde que
ce repliement sur eux-mêmes et sur leurs moyens stricts. J'étais pour eux un passant. Ils ne me
rejetaient point. Ils m'accueillaient au contraire et m'offraient la richesse, leur expérience, non en
discours, en actes précis, mais ils ne voulaient point se laisser troubler par moi. Je por-tais encore en
moi un oxygène trop fort. Le moindre reflet du monde des hommes était comme une ivresse, et ils
refusaient à cette saoulerie, sachant par expérience toutes les impatiences et tous les désespoirs qu'elle
dégage et qui sont funestes dans le marais pestilentiel des camps. Pour avoir quelques chances de
survivre, il fallait vivre en acceptant seulement l'univers concen-trationnaire. Rien d'autre n'existait
plus. Si un jour la délivrance se réalisait, le temps et les moyens de vivre avec les hommes seraient
aussi donnés. Quelle leçon, et de quelle importance pour moi, jamais dite, mais mon-trée dans les actes
par ce petit groupe de Belges qui affir-mait silencieusement son indestructible volonté de vaincre !
Quelle affirmation contre la mort, calme et nue, faite seulement d'une conscience claire, d'une
intelligence lucide de l'événement !
David Rousset, Les jours de notre mort, Editions du Pavois, 1947, (Hachette Littératures, 1993, pages
255-257)

3ème partie
3
Du triomphe de l’Homme (et du droit ?)
Malgré des conditions de vie conçues pour empêcher toute solidarité
entre détenus, ou les dresser les uns contre les autres, des actes
individuels ou collectifs de solidarité ont pu exister.
Le Développement des solidarités nationales
Les premiers s’organiser en groupe de résistance sont évidemment les détenus allemands pour qui les
camps ont été ouverts. L’efficacité́ des mesures de coercition et la di culté s’imposer face aux droit
commun compliquent l’action clandestine des politiques. Les libérations, encore possibles avant-
guerre, contribuent également fragiliser les groupes constitués. Ainsi, Buchenwald, la résistance
intérieure se structure vraiment partir de septembre 1939 quand arrivent les Allemands considérés
comme politiquement suspects arrêtés en masse au début de la guerre.
Les SS profitent aussi des dissensions qui persistent entre les détenus allemands. Divisés au moment de
la prise de pouvoir par les nazis, les communistes et les sociaux-démocrates allemands le sont souvent
encore la veille de la guerre. A Buchenwald, les communistes se méfient des sociaux-démocrates,
Dachau les communistes ont peu d’influence car ils ont été écartés des postes de responsabilité́. Dans
tous les camps, les dernières réticences sont levées l’été 1941 et les détenus politiques allemands
arrivent coopérer au nom d’un front antinazi.
Avec l’internationalisation des camps, les SS doivent trouver des interlocuteurs capables de transmettre
les ordres et de leur rendre compte, donc comprenant l’allemand. Ils nomment aux postes de
responsabilité́ des Allemands déportés depuis les pays o ils s’étaient exilés après l’arrivée au pouvoir
d’Hitler ou des non-Allemands germano- phones (notamment des Tchèques et des Polonais). Des
opportunités se présentent donc pour mettre en place des groupes nationaux en pro tant de l’appui de
ces fonctionnaires détenus non-allemands. Evidemment, tous ne sont pas disposés venir en aide
d’une manière ou d’une autre leurs compatriotes et beaucoup se révèlent aussi durs et détestables que
leurs homologues allemands.
Les SS savent par les multiples mouchards qu’ils soudoient que les organisations nationales peuvent
s’avérer contre-productives pour les détenus. En e et, les SS s’évertuent monter les nationalités les
unes contre les autres comme ils ont poussé les droit commun prendre le dessus sur les politiques.
Les témoignages des déportés rendent compte de ces animosités, voire de ces haines, fondées sur la
méconnaissance, le ressentiment ou l’instinct de conservation. Dans un premier temps, la tentation a
existé de privilégier les intérêts nationaux et de trouver dans le rapprochement avec des compatriotes
la protection indispensable la survie dans le camp. Pourtant, dans un second temps, la nécessité́
d’unir toutes les forces dans un front commun s’est imposée parmi les détenus les plus lucides, les plus
résolus et les plus entreprenants.
L'amiti, la solidarit, la survie
Tous les témoins insistent sur l'importance du moral et de l'entraide pour "tenir". La solidarité,
matérielle et morale, fut bien souvent une victoire sur l'entreprise de déshumanisation engagée par les
nazis, et un facteur déterminant de la survie.
a/ L'entraide Dachau
Les détenus ont fait de gros efforts pour célébrer les fêtes, qui permettaient de briser le morne
enchanement des jours et d'empêcher l'atonie et le laisser-aller total. De multiples activités
clandestines (comme la construction de petits objets ou l'expression artistique) constituèrent autant de
résistances symboliques sur le régime concentrationnaire.
b/ La fabrication d'objets au camp
"Nous avons trouvé une nouvelle occupation. Nous fabriquons de petits objets : croix, croix de
Lorraine, étoiles, et nos numéros surmontés du triangle rouge. Ces petits objets sont les cadeaux pour
les jours de fête, des témoignages d'affection : nous ne sommes pas encore des bêtes.(...)Le tout, c'est
d'arriver voler le matériel : des boutons en Galalithe (interrupteur), car les manches de brosse dents
sont rares. Il faut surtout faire très attention de ne pas se faire prendre.(...)" Marie-José Chombart de
Lauwe, Toute une vie de résistance, FNDIRP - éd. Graphein, 1998, p. 96.
c/ Sauver les enfants : l'exemple du Block* des nourrissons Ravensbrck

Dans les camps aussi, des enfants naissent ; mais ils sont par avance condamnés. Pour les détenues
s'engage alors une terrible et incertaine lutte : les sauver des SS*, les sauver du régime du camp.
"En septembre 1944, je suis affectée la Kinderzimmer (Block* des nourrissons), Block* 11. En effet,
maintenant, les enfants naissent au camp. La Kinderzimmer est une pièce tout en longueur avec deux
lits de deux étages superposés, une fenêtre au fond, une table, deux corbeilles, une armoire, un poêle,
un lavabo... Marie-France, une petite franaise est née avant terme. Elle a maintenant presque deux
mois. On dirait une petite poupée de cire, longue et si mince qu'elle n'a pas l'air d'un bébé. Sa maman
fait l'impossible pour la sauver, mais vivra-t-elle ? Peu probable. Presque tous les jours, on amène des
nouveau-nés, assez beaux généralement, mais ils prennent rapidement l'aspect de petits vieux(...) La
solidarité du camp alertée nous apporte un peu d'aide ; des chiffons pour faire des couches et dix
petites bouteilles qui deviendront des biberons quand une infirmière courageuse vole une paire de
gants du médecin-chef, dont les dix doigts deviendront dix tétines ..."
Marie-José Chombart de Lauwe, Toute une vie de résistance, FNDIRP - éd. Graphein, 1998, p. 113.
Conserver son autonomie et sa faculté de choix en situation extrême
Les prisonniers qui [...] conservaient leur faculté de sentir et de percevoir, en prenant conscience de
leurs réactions intérieures, même quand ils ne pouvaient pas les traduire en actes, survivaient [...]. ils
se rendaient également compte de ce qui leur avait échappé tout d’abord, qu’ils conservaient la
dernière, sinon la plus grande des libertés : choisir leur attitude dans n’importe quelle circonstance. Les
prisonniers qui l’avaient pleinement compris s’apercevaient que c’était cela, et uniquement cela, qui
constituait la différence cruciale entre préserver son humanité (et souvent la vie elle-même) et accepter
de mourir moralement (ce qui entraînait souvent la mort physique) : conserver la liberté de choisir son
attitude dans une situation extrême même si, apparemment, on n’avait aucune possibilité d’agir sur
elle.
Bruno Bettelheim, Le cœur conscient, Robert Laffont, 1972, pp. 214-215.
(NB. Bruno Bettelheim désigne les détenus du système concentrationnaire par le mot « prisonniers ».)
Rester des hommes
Mais il n’y a pas d’ambiguïté, nous restons des hommes, nous ne finirons qu’en homme. La distance
qui nous sépare d’une autre espèce reste intacte, elle n’est pas historique. C’est un rêve ss de croire que
nous avons pour mission historique de changer d’espèce, et comme cette mutation se fait trop
lentement, ils tuent. [...] C’est parce que nous sommes des hommes comme eux que les ss seront en
définitive impuissants devant nous. C’est parce qu’ils auront tenté de mettre en cause l’unité de cette
espèce qu’ils seront finalement écrasés. [...] et si nous pensons alors cette chose qui, d’ici, est
certainement la chose la plus considérable que l’on puisse penser : « les ss ne sont que des hommes
comme nous » ; si, entre le ss et nous – c’est-à-dire dans le moment le plus fort de distance entre les
êtres, dans le moment o la limite de l’asservissement des uns et la limite de la puissance des autres
semblent devoir se figer dans un rapport surnaturel – nous ne pouvons apercevoir aucune différence
substantielle en face de la nature et en face de la mort, nous sommes obligés de dire qu’il n’y a qu’une
espèce humaine. [...] tout ce qui place les êtres dans la situation d’exploités, d’asservis et impliquerait,
par là-même, l’existence de variétés d’espèces, est faux et fou ; et nous en tenons ici la preuve, et la
plus irréfutable preuve, puisque la pire victime ne peut faire autrement que de constater que, dans son
pire exercice, la puissance du bourreau ne peut être autre qu’une de celle de l’homme : la puissance du
meurtre. il peut tuer un homme, mais il ne peut pas le changer en autre chose.
Robert Antelme, L’espèce humaine, Gallimard, 1957, pp. 228-230.
En situation extrême, préserver des facultés secrètes
La vie dans les camps de concentration était extrêmement complexe. La pression qu’exeraientles ss
pour obtenir l’obéissance, le conformisme, la soumission et les changements de personnalité de
comportement était évidente. tous les efforts du prisonnier pour tenter de modifier la vie dans le camp,
de lutter contre les changements psychologiques, de pallier les effets d’une adaptation forcée, devaient
demeurer secrets.
Bruno Bettelheim, Le cœur conscient, Robert Laffont, 1972, p. 235.

3ème partie
3
Du triomphe de l’Homme (et du droit ?)
La résistance à la dégradation humaine a revêtu des formes diverses,
montrant chez beaucoup de détenus une volonté de rester des êtres
pensants et de contrer les plans des bourreaux nazis : refus de
collaborer au projet nazi, révoltes, recours à l’art, à la culture, à la
spiritualité, etc.
Je m'en tiendrai à certains aspects de la résistance au camp de Monowitz (Auschwitz 111) où je suis
resté des premiers jours de janvier 1944 au 18 janvier 1945.
Je n'ai été à Birkenau que durant 48 heures environ après mon arrivée le 26 juin 1943, d'où je suis parti
à Jawischowitz, où j'ai été affecté à la mine. Les principaux faits concernant la résistance dans ce camp
sont relatés dans « Jawischowitz, annexe d'Auschwitz ».
J'ai été transféré de Jawischowitz à Monowitz grâce à la résistance qui était implantée à la
Schreibstube (secrétariat général).
Fort heureusement pour moi, en raison de mon état physique, un autre camarade, Victor Malik, arrivé
le 15 août 1942, après son internement au camp du Vernet (France), m'accompagnait. Nous étions
mutés à Monowitz comme spécialistes électro-mécaniciens!
Nous aurions dû transiter par Auschwitz, où nous avions le contact avec le groupe de résistance. Mais
nous sommes arrivés directement à Monowitz. En quarantaine!
Premier écueil, grain de sable qui aurait pu nous être fatal.
Puis-je rappeler que le principe premier dans un mouvement de résistance était de s'informer, afin
d'alimenter la réflexion pour pouvoir informer et agir.
A Monowitz, comme à Jawischowitz, la résistance était à l'affût de tous mouvements: arrivées ou
départs.
C'est ainsi qu'un inconnu de nous deux cherchant à s'informer sur et par les nouveaux venus (nous
étions une dizaine) demande à Victor d'où il venait: « De France » lui répond-il. « Où étais-tu en
France »? « Au camp du Vernet ».
C'était le sésame ouvre-toi.
« Es-tu seul? » « Non, je suis avec un jeune Français », « Son nom? » « Georges » (mon prénom
clandestin lors de mon arrestation).
Trois jours plus tard, j'étais alors en état de me déplacer, nous nous rendons dans un bloc après l'appel
et nous rencontrons le premier inconnu et un second. Ils me posent deux questions:
« Tu es bien Georges le Rouquin? » (c'était ma couleur de cheveux) et ensuite: « Tu avais un frère qui
se prénommait Pierre? » (c'était le prénom clandestin de mon jeune frère Maurice, abattu le 10 mars
1943 lors d'une action de son groupe de résistance à Paris).
Le 27 mars 1943, j'étais arrêté par la Brigade spéciale avec d'autres camarades de mon groupe dans la
première affaire dite des jeunes de la M.O.I.
Nos deux inconnus étaient Alfred Besserman et Idel Korman. Ils avaient été arrêtés dans la deuxième
affaire M.O.I. de Paris en juillet 1943. La troisième affaire M.O.I. de Paris en novembre 1943 est plus
connue par l'inoubliable « Affiche rouge ».
Le contact était rétabli. Nous revenions à l'espérance, nous avions rétabli le chaînon manquant.
Jusqu'en juin 1944, j'ai été affecté au Kabel Komando (des câbles), puis dans un autre, d'électro-
mécaniciens, et enfin dans un de soudeurs.
C'est dans ce dernier que j'ai pris contact avec un jeune Français de Lyon qui travaillait sur le chantier
comme requis du S.T.O.
Etablir le contact, bien sûr nous parlions la même langue, nous étions du même âge. Mais lui était en
civil et moi en rayé. A force de prudence et de ruse, je lui parle et lui fais une demande: « Peux-tu me
procurer un crayon? » Etonné il me répond: « Oui, mais c'est bien la première fois qu'un rayé me
demande autre chose que de la nourriture ». La glace était rompue, le lendemain il m'apporte un
crayon et est d'accord pour prendre un courrier pour la France.
Le surlendemain, je suis victime d'un accident sur le chantier de la Buna, encore un fil rompu.
Je suis hospitalisé et mes activités prennent un nouveau cours. Je me rétablis et les camarades de la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
1
/
29
100%