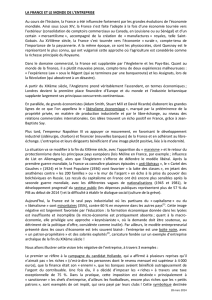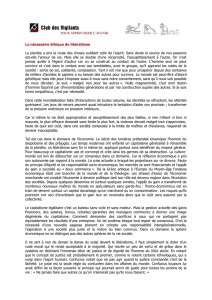1 ½ ç c Ç â ê ë ë C:\WORD5\NORMAL

Hubert Bonin, « Morale & entreprise dans l’histoire », Le Débat
(éditions Gallimard), n°67, novembre-décembre 1991, pp. 167-185.
L'histoire économique n'est pas "neutre", car elle reflète les courants de pensée qui
traversent la société. L'époque des années 1960-1970 avait vu des historiens marxistes
pourfendre le capitalisme, en rencontrant d'ailleurs une adhésion massive de la
communauté intellectuelle, voire de la presse. Dans les années 1980, le culte de
l'entreprise
1
et le triomphe du "bernardtapisme" ont déclenché un retour de balancier que
l'effondrement historique du marxisme et de sa base universitaire ont accentué, d'autant
plus que l'histoire des entreprises elle-même n'échappait pas à la promotion d'enseignants-
chercheurs adeptes de l'économie de marché. C'est pourquoi cette réflexion sur une morale
et entreprise dans l'histoire repose sur un déséquilibre volontaire, pour réhabiliter certains
thèmes que l'effacement du marxisme militant et même parfois de l'histoire du
mouvement social a pu rendre moins présents à l'esprit. Toutefois, le souci de l'objectivité
impose de ne pas s'en tenir à une analyse critique et de prétendre que des exigences
morales peuvent être préservées dans le monde des affaires.
1. LES PECHES CAPITAUX DE L'ENTREPRISE
L'histoire des entreprises paraît difficilement conciliable avec un conte moral. En effet, la
vie d'une société repose fondamentalement sur des bases immorales, puisqu'elles sont
faites d'égoïsme.
A. Le règne de l'égoïsme
La préoccupation première d'une firme est sa survie ; elle agit dans le monde de la
compétition ; les meilleurs conseillers l'incitent à déterminer sa stratégie selon son
« environnement concurrentiel » ; elle se bat pour rafler des « parts de marché ». L'on
parle de « guerre mondiale des entreprises », de « batailles boursières »
2
, de « stratégie » -
que l'on rend plus suaves par des analogies avec des jeux comme le jeu de go -,
d'« offensive » technologique ou commerciale, de « champ de bataille » où s'affrontent
3
des « requins de la finance », des « raiders », des « géants » et des « champions
nationaux » : « nous sommes une profession en état de siège », déclare un patron en 1990.
Il semblerait donc naïf de supposer que des combattants ainsi poussés dans les cordes du
ring puissent entretenir, derrière leur cuirasse, des exigences morales. Si la dynamique du
capitalisme suppose que l'entreprise s'engage dans une compétition qui revêt des aspects
sportifs, contrairement aux Olympiades, l'essentiel n'est pas de participer, mais de gagner,
c'est-à-dire d'assurer la pérennité de la firme et de lui tailler un maximum de profits et de
parts de marché. En effet, un seul objectif domine : survivre, c'est-à-dire résister
(= conserver ou augmenter ses parts de marché), percer (= produire une innovation
technologique ; remodeler son appareil de production ou de service pour le rendre
« performant » et digne du « prix de l'excellence »
4
) ; et enfin gagner (= récolter
suffisamment de profits pour amortir les dépenses effectuées et préparer les suivantes), car
gagner, c'est, pour une entreprise, gagner de l'argent.
Il ne faut pas oublier que l'histoire des sociétés comporte une spécialité morbide, la
"démographie des entreprises" : les historiens scrutent la "mortalité" des firmes ; ils
recensent les faillites et liquidations déclarées au tribunal de commerce, afin de construire
des courbes statistiques du dynamisme ou de l'affaissement entrepreneurial, au rythme de
la conjoncture et des "mouvements longs" de l'économie, marqué par des périodes
sombres, comme la Grande Dépression des années 1880-1895, la crise des années 1930 ou
la Crise des années 1974-1986. La "théorie des trois générations" prétend même qu'une

2
entreprise familiale ne résiste pas plus de trois générations de dirigeants : la première crée,
la seconde développe, la troisième profite du capital et le consume. Chaque vive récession
ou "grande dépression" commence d'ailleurs par un krach, qui engloutit les banques ayant
trop engagé de capitaux et les entreprises trop alourdies de stocks, de frais et de dettes.
L'histoire économique est donc une immense nécropole et les monographies d'entreprises
autant de cénotaphes.
L'on comprend que, pour une société soucieuse de son destin, la règle essentielle soit
l'égoïsme, au service de ses "intérêts privés". Cet égoïsme viscéral
5
est la clé de voûte de
son système d'action, qui pourrait se résumer selon l'adage bien connu : la fin justifie les
moyens. Lorsqu'une société abaisse ses prix dans une région ou sur un produit donné pour
"casser le marché" - comme cela s'est toujours fait à un moment ou un autre de l'histoire
d'une branche d'activité -, n'est-ce pas pour éliminer délibérément des rivales (agression à
main armée) ? Lorsqu'une société en rachète une autre seulement pour rafler sa part de
marché, sa clientèle, son réseau de distribution, et qu'elle ferme aussitôt ses usines qui
créaient trop de concurrence, n'est-ce pas là une visée morbide (assassinat) ? Ne peut-on
penser enfin que "l'espionnage industriel" est une forme élaborée de cambriolage, tout
comme la contrefaçon délibérée (vol) ? Les moeurs du « capitalisme sauvage » pourraient
donc sembler quelque peu d'une immoralité impitoyable. Une historienne des Etats-Unis
n'a-t-elle pas dressé des portraits flamboyants des grands "capitaines d'industrie"
6
du
tournant du XXe siècle, surnommés les « barons pillards » (robbers barons), en une
expression consacrée dans l'historiographie américaine ? Ils ont réussi à populariser des
thèses optimisant le "darwinisme social" au nom de L'Evangile de la richesse, les self
made men devenus des magnats des affaires à l'époque de l'éclosion du Big business. Ainsi
se dégageraient des "lois du capitalisme" profondément éloignées des exigences morales,
car, comme l'évoque le titre de la pièce d'Octave Mirbeau, « les affaires sont les affaires ».
B. La cupidité
Cette immoralité est imposée par l'exigence de survie ; celle-ci passe par le contrôle de
parts de marché, et donc par des gains, des recettes et des profits.
a. Des surprofits
En effet, l'entreprise vit dans le monde de l'argent ; si elle doit dégager les procédés lui
permettant de disposer des sommes les plus larges. Sans entrer dans les précisions des
économistes, notons seulement que la fixation de "surprofits" dans les périodes de
lancement de nouveaux produits - au démarrage d'une révolution technique, par exemple -
correspond aux "rentes de situation" dont bénéficie la firme innovatrice. D'autre part, les
tentatives pour contrôler le marché se renouvellent sans cesse, par le biais des "ententes",
des "cartels", ponctuellement lors de la soumission à des marchés publics - pour les
chantiers - ou privés - les rails vendus aux compagnies ferroviaires au XIXe siècle -, ou
durablement, au sein du groupe de producteurs nationaux et même au niveau d'un
continent - comme la fameuse Entente internationale de l'acier en 1926-1939 qui affectait
les parts de marché entre les divers producteurs européens. Ces adeptes de l'économie de
marché sont ainsi les premiers à recourir aux "pratiques non concurrentielles" quand des
occasions de profits surgissent, au nom de « l'organisation du marché » par le biais de
barèmes de prix. Depuis la naissance de la société de consommation dans les années 1950,
les "refus de vente" - malgré les textes officiels, comme celui de 1960 - complètent ces
agissements, pour éviter les rabais de distributeurs qui pourraient, à la longue, peser trop
fortement sur les prix et comprimer les marges ; l'art des fabricants d'appareils ménagers
pour diversifier apparemment leurs gammes afin que chaque distributeur puisse disposer
de ses propres modèles et empêcher toute comparaison efficace entre les prix des

3
concurrents est un exemple parlant d'entrave à la transparence du marché, pourtant
conçue comme la clé de l'économie de marché libérale. La notion de « juste prix » (justum
pretium) sur laquelle ont glosé, depuis le Moyen Age, les théologiens et les économistes
semble une vue de l'esprit, et seules certains services publics victimes des échafaudages
rationalisateurs des "prix marginaux" - dans la droite ligne des théories du marginalisme -
se sont trouvés engoncés - au nom de l'intérêt général - dans des systèmes de prix qui les
ont empêchés de connaître la prospérité par le profit - que ce soient les compagnies
ferroviaires privées, soumises aux contrôles tatillons de la Puissance publique dans les
années 1880-1930, ou les entreprises publiques depuis les nationalisations de la
Libération.
b. Spéculer
Dès la renaissance des affaires au Moyen-Age, la fluidité de l'argent le transforme en une
"matière première" sur des marchés de l'argent, où l'on fait "travailler" l'argent
7
. Tant de
volumes épais ont été écrits, jusqu'à l'orée du XIXe siècle, sur la "production d'argent" ! Le
taux d'intérêt était condamné par l'Eglise - tout comme, encore de nos jours par l'Islam -,
car l'on considérait que le temps, créé par Dieu, ne pouvait se vendre – « on vend ce qui
n'existe pas », confirme Saint-Thomas-d'Aquin ; ou : « pecunia pecuniam non parit »,
affirme le concile de Latran en 1215 en reprenant Saint-Luc ; Dante place dans son enfer
les hommes d'affaires, les marchands, les banquiers et les usuriers, et nombre de tympans
d'églises médiévales ou de chapiteaux de cloîtres dénoncent ensemble lucre et luxure,
condamnés à la même opprobre. Il faut des milliers de pages aux sophistes de l'Eglise pour
tenter de légitimer la base même de l'échange commercial et bancaire, le bénéfice tiré du
risque causé par une opération, par le simple délai entre paiement et livraison, par la
circulation des "lettres de change", au nom de cette prise de risque même, et donc, in fine,
au nom de la "spéculation".
Quelles que soient sa dimension et l'époque où elle agit, l'entreprise a comme principale
caractéristique cette prise de risque ; c'est ce qui la distingue d'ailleurs de la "bureaucratie"
gestionnaire et ce qui en fait une pièce déterminante de l'économie de marché
entrepreneuriale - par rapport aux économies centralisées et dirigistes. Spéculer, c'est
anticiper sur l'avenir, sur l'état futur des marchés des produits et de l'argent. Or, de la
spéculation dite "saine" - le bénéfice à attendre d'un investissement à partir de son utilité
économique ; le profit obtenu d'un placement financier ; la mise à l'abri de liquidités
possédées ou destinées à être récupérées sur un contrat pour les préserver des aléas
monétaires, la gestion des marchés à terme des valeurs mobilières, des matières premières
et denrées alimentaires -, les sociétés glissent, sans franchir de frontière de nature ou de
métier, vers la spéculation "malsaine". Ainsi s'affirme au XXe siècle une espèce nouvelle de
"monstres" - d'ailleurs l'on emploie parfois l'expression d'« hydre capitaliste » ou de
« pieuvre capitaliste » - hors de toute morale, dénués de toute préoccupation des intérêts
nationaux, ce que constate le malheureux ministre des Finances britannique Brown,
lorsqu'il dénonce en 1966-1968, avec une virulence désespérée, « les gnomes de Zurich »
qui orchestreraient la spéculation contre une livre rongée par la mauvaise gestion des
Travaillistes.
Le XXe siècle donne une dimension spectaculaire aux jeux d'argent internationaux, en un
véritable changement de nature
8
, ce que Keynes surnomme « l'économie de casino » et
qu'on a appelé récemment « la bulle financière », source d'engrenages pervers : sur-
endettement, découplage d'une finance "artificielle" par rapport à une économie "réelle".
L'on parle donc de l'argent « facile », comme on dit qu'une femme est « facile » : les
entreprises qui sombrent alors dans la débauche financière tombent en même temps dans
le péché de cupidité : elles nourrissent des placements spéculatifs qui les éloignent de leurs

4
investissements productifs - et, en certaines années, leur rapportent plus que leur activité
de production - et n'abordent le marché financier que, en jargon, pour y "faire des coups",
"tirer un coup sur le marché", en "spielers" (joueurs) ou "money makers" (faiseurs
d'argent). « L'homme à argent qui, tel un magicien, peut d'un trait de plume transporter sa
fortune au bout du monde, et qui, n'agitant jamais que des signes, se dérobe également à la
nature et à la société (Rivarol). »
c. S'enrichir
La cupidité est enfin individuelle, lorsque des patrons de sociétés s'octroient des revenus
amples, en récompense de leur initiative et dynamisme entrepreneuriale. La fortune du
propriétaire de la firme est certes le résultat légitime de l'investissement en capital,
rétribué par des dividendes dont l'ampleur reflète son talent. L'élargissement des élites de
la fortune et de la grande bourgeoisie n'est que l'aboutissement de ce foisonnement
capitaliste. Cependant, des comportements divergents peuvent surgir, entre la bourgeoisie
"sobre" - comme à Lyon, à Bordeaux ou dans le Nord - qui s'impose une certaine retenue -
ou mène un grand train de vie dans la capitale, loin des regards des salariés de la firme - et
la bourgeoisie tapageuse, qui étale sa richesse sans vergogne, comme c'est le cas pour de
nombreux patrons de grosses moyennes entreprises : les membres de la famille même
incompétents se voient octroyer des salaires plantureux, des dépenses personnelles
luxueuses sont prises en charge sur le budget de la firme, etc. L'on se souvient peut-être de
l'indignation des salariés des frères Schlumpf lorsque leur firme de textile alsacienne a
déposé son bilan dans les années 1970 et qu'on a découvert leur fabuleuse collection de
voitures Bugatti. De l'entrepreneur enrichi l'on glisse à la dilapidation de la richesse,
parfois au détriment de l'entreprise, et, en tout cas, au profit du creusement des inégalités
de niveau et de genre de vie - et l'on pourrait songer aux imprécations de Rousseau contre
le luxe. La quête du profit se transforme en goût du lucre, en cupidité ; de l'immoralité des
affaires l'on se fourvoit aux marges de la morale individuelle. L'entreprise elle-même se
trouve compromise dans des malversations dues à une âpreté au gain identique. Trop de
dirigeants de sociétés bancaires ou financières tolèrent des chevauchements entre leurs
diverses filiales, en "conflits d'intérêts" nuisibles à la transparence de leurs opérations et
aux revenus des actionnaires ou des épargnants, puisque les diverses activités du "groupe
d'argent" ne sont pas séparées par les nécessaires "murailles de Chine" exigées par la
déontologie - ainsi pour la gestion de certaines SICAV. La Bourse a depuis toujours connu
ses "gogos" victimes des "épongeurs d'épargne", mais la manipulation des cours boursiers
est devenue au XXe siècle une pratique fréquente, exacerbée par la frénésie des marchés
financiers dans les années 1980 et symbolisée par l'éclatement de "scandales boursiers" de
haute volée.
C. Le mensonge
C'est ainsi une morale de l'efficacité et du profit qui l'emporte, afin d'accumuler le plus
d'argent possible – « l'accumulation capitaliste » chère à la Spartakiste Rosa Luxembourg.
La gestion même du stock d'argent constitué échappe parfois aux critères moraux. L'on
parle d'« argent caché » : la société redoute la soif du Fisc, l'avidité des banquiers,
l'aspiration des actionnaires à des dividendes plantureux. Aussi cherche-t-elle par tous les
moyens à mettre de l'argent de côté, au service d'une fin qui peut être juste, puisqu'elle vise
à disposer d'un maximum d'argent pour investir ou pour résister aux coups durs de la
conjoncture. Les firmes qui ont traversé les décennies sont celles qui ont su constituer
d'amples réserves, avec, souvent ce qu'on appelle des réserves "occultes", celles qui, diffé-
rentes des réserves légales, comptables, ou "latentes", sont cachées dans la profondeur des
bilans annuels, par exemple dans ce que les banques appellaient, chez elles, leurs "comptes
d'ordre", de véritables fourre-tout. Le bon patron est celui qui sait jongler avec les chiffres

5
de sa comptabilité. André Citroën ne disait-il pas, dans les années 1920, qu'il dressait trois
sortes de comptes : pour le Fisc, pour ses banquiers et pour lui-même ? Jean Bouvier a
relevé dans les archives du jeune Crédit lyonnais que cette banque tenait, elle aussi,
plusieurs séries de comptes, ce qu'elle explique en recourant à un langage puisé dans
l'Ancien testament : « Première pièce : le compte de profits et pertes à l'usage des enfants
d'Israël, des purs élus - sois les quatre membres du comité de direction -. Le compte, divisé
par colonnes, vous donne le débit et le crédit de chacun des comptes qui constituent
l'inventaire. Deuxième pièce : même compte, où les dépenses et les recettes sont réunies
par groupes à l'usage des gentils de la Porte - les quatorze autres administrateurs -. Nous
confectionnerons ensuite une troisième pièce pour les Philistins - les actionnaires -, quand
les deux premières auront été passées au crible. »
9
Par le biais des amortissements, des
provisions, des sous-évaluations de nombreux actifs (stocks, immeubles, etc.), les comptes
des banques et des entreprises peuvent recéler d'amples cavernes d'Ali Baba, où se
tapissent les profits restés discrets et non distribués aux actionnaires : c'est l'art de
"toiletter les bilans", de la "cosmétique bilantielle". Le secret des affaires confine là à la
dissimulation : l'égoïsme de survie ouvre la voie au mensonge financier.
L'argent est donc au coeur du secret des affaires. Fraude fiscale et "évasion fiscale" sont
devenues des constantes de l'art du comptable d'entreprise compétent, qui tente de
repousser au mieux les règles de la légalité quand il ne peut les contourner ; la quête
exotique de "paradis fiscaux" est ainsi devenue courante à partir des années 1960, au fur et
à mesure que la fiscalité et les contrôles s'appesantissaient dans les pays développés. Cet
art des comptes a faussé souvent les rapports entre les sociétés et leurs banquiers ; elles
ont cherché à obtenir un maximum de crédits en arguant de bilans et d'affaires qui
s'avéraient parfois aléatoires ; le "papier de cavalerie" ou "de complaisance" créait des
échanges imaginaires qui servaient à obtenir l'escompte d'effets auprès de banques
crédules. Escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux : la "criminalité en col
blanc" a acquis désormais une existence pleinement reconnue, comme le prouvent la mise
sur pied de sections financières de la Police et de la Justice
10
. Faut-il enfin évoquer ici les
dépôts de bilan et les faillites plus ou moins frauduleuses, qu'ont multipliés certains
patrons désireux de se libérer de leurs dettes - surtout après 1889, quand la législation sur
les faillites a allégé la responsabilité pénale du failli - considéré jusqu'alors comme une
sorte de criminel susceptible d'une peine de prison ?
D. L'incivisme
Les jeux de l'argent, la cupidité et l'âpreté dans l'obtention de profits rapides, sont autant
de fautes morales dont des entreprises sont coutumières. Des "arbitrages" de change de
Place à Place pratiqués depuis le Moyen Age, nombre de sociétés et de banques de
l'entredeux-guerres puis de notre époque se sont lancées dans les spéculations monétaires
pures et simples : la marge est mince entre la défense des intérêts financiers contre
l'érosion des disponibilités en stock par des procédés de "couverture de change" ou le
retard du rapatriement des devises obtenues à l'exportation et la sortie volontaire de
capitaux pour jouer sur la variation du change. Le président du Conseil Raymond Poincaré
(1922-1924) découvre avec stupeur le rôle des banques et de certaines firmes dans la
spéculation menées contre le franc pendant ces années, alors qu'il pensait que seules les
puissances germaniques ou germanophiles attaquaient le franc. Quand l'intérêt particulier
s'élève contre l'intérêt général, l'égoïsme des sociétés joue contre la communauté de la
Cité : n'est-il pas alors traître à la Patrie et la trahison n'est-elle pas immorale ? Le
capitalisme « cosmopolite » - comme on dit à l'époque - sape les bases de l'honneur
national par sa complicité de facto avec les ennemis du franc.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%