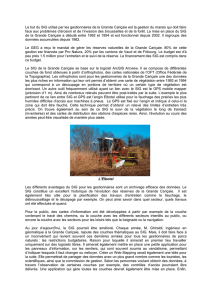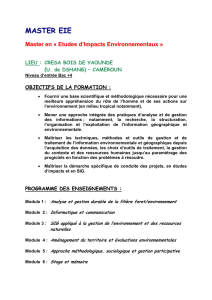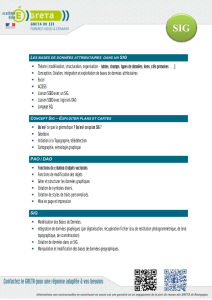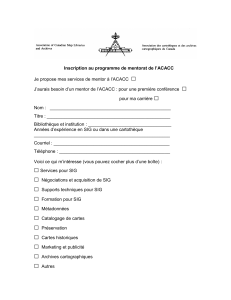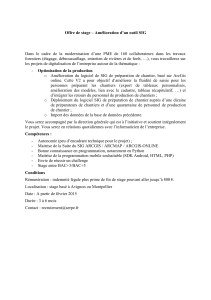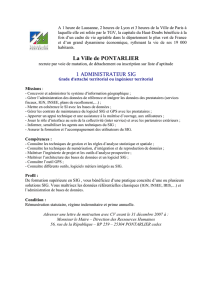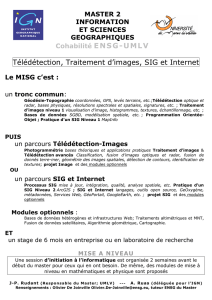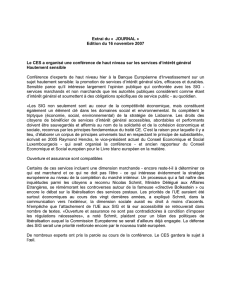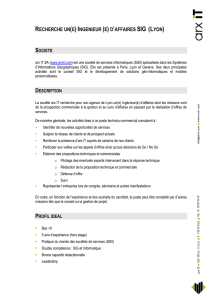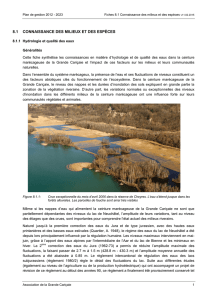SIG_CARICAIE

Delphine Douçot, MA1,SIE Joelle von Ballmoos, UNIL Pierre-Jean Copin, MA3,SIE
Francesca Gambazzi, MA1, SIE Matthias Fournier, MA3,SIE
Travail de séminaire « SIG pour l’environnement », 2006
Gestion des réserves naturelles. Exemple de la Grande Cariçaie
Liens entre les SIG et les réserves naturelles
Les réserves naturelles constituent un territoire protégé pour préserver un patrimoine naturel remarquable et
menacé. Les biotopes concernés par les réserves naturelles possèdent souvent un écosystème au
fonctionnement complexe et abritent des liens entre espèces souvent difficiles à distinguer. Les interactions entre
les divers systèmes, souvent dynamiques, sont difficilement modélisables et la mise en place d’une action peut
engendrer des conséquences à différents niveaux, thématiques, spatiaux et temporels. Cette complexité en fait
un environnement vulnérable aux changements anthropiques, mais aussi à l’évolution naturelle des espèces.
Cette fragilité en fait un milieu rare, qui peut avoir une importance nationale ou même internationale, selon les
espèces qu’elle abrite. Dans plusieurs pays, elle fait même l’objet de textes de loi cantonaux et fédéraux.
1
De part
ce statut, la sauvegarde de ce milieu et de ces espèces passe par une surveillance et un entretien efficace.
Cette fragilité quant aux facteurs de changement implique que soient pris en compte, lors de chaque décision
ou de chaque intervention, de nombreux paramètres et que soient manipulées d'énormes quantités
d'informations. Les outils informatiques apportent dans un contexte un soutien bienvenu. Cependant, pour une
gestion efficiente, l’outil optimal doit répondre à quelques critères :
Pouvoir représenter, séparément ou simultanément, des informations issues de différents domaines
(zoologie, botanique, hydrologie…)
Représenter à différentes échelles selon le phénomène étudié
Etre en mesure d’évoluer avec les phénomènes naturels
L’interdisciplinarité qu’abrite une réserve naturelle demande que les différents responsables puissent
communiquer de manière efficace, s’échanger ou modifier des informations, etc. Nous pouvons donc ajouter que
l’outil devra pouvoir :
S’adapter à différentes configurations informatiques
Pouvoir permettre une manipulation ou une modification facile des données par différents utilisateurs
Dans l’ensemble de ces points la demande en information géographique, ainsi que sa représentation dans le
temps, se trouve au centre de la problématique. En effet, le suivi des observations naturalistes, le suivi précis de
populations animales dans le cadre de protocoles,… sont des informations qui ont un caractère géographique
évident et ne peuvent être exploitées efficacement que dans le cadre d’un Système d’Information Géographique.
Bien sûr, les données qui forment la base de ce SIG sont effectuées sur le terrain. Une fois le travail de saisie
terminée, le choix des couches de représentation, thématiques et sous-thématiques doit être judicieux afin que le
SIG mise en place soit optimal pour la gestion de la réserve naturelle. Mais au final, c’est au niveau du traitement
des données, rendu possible par les fonctions des logiciels informatiques, que le SIG s’exprime comme outil
d’aide à la gestion des réserves naturelles.
Il faudrait aussi noter que les objectifs d’une réserve naturelle autre à la protection du patrimoine naturel
(notamment pour une gestion adaptée des milieux naturels et paysagers), sont constitués par :
1
Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.(Suisse)
Loi de réserves de chasse et de faune sauvage (France)

- une contribution à l’aménagement du territoire
- une contribution au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie
- assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public
- la réalisation des actions expérimentales ou des programmes de recherche
Dans ce travail, nous allons tenter de déterminer les traitements utilisés par les gestionnaires de sites
protégés (en nous concentrant particulièrement sur le cas de la Grande Cariçaie), leurs avantages et leurs
inconvénients, ainsi que leurs limites en tant qu’outil d’aide à la gestion.
Pour la mise en œuvre d’un SIG dans une réserve naturelle, on procède d’abord à un diagnostic du système
existant, qui permet de définir rapidement les orientations à prendre. Il s’ensuit un travail important sur
l’évaluation et l’analyse des besoins en fonction du contexte, des perspectives et des attentes du personnel. Des
solutions sont alors proposées et mises en œuvre pour la hiérarchisation des données, la gestion des échanges
avec les partenaires, l’adoption d’une démarche qualité, l’acquisition d’un logiciel et de référentiels
cartographiques nationaux.
Afin de fournir un travail de qualité il est très important de savoir combiner des objectifs à court terme comme
la cartographie thématique, la gestion technique, l’analyse,… avec les objectifs à long terme, visant à la création
d’une base de données fiable et précise.
Cas de la Grande Cariçaie
La Grande Cariçaie occupe la rive sud du lac de Neuchâtel. C’est le plus grand marais bordant un lac de
Suisse. D’abord dédaignées des populations riveraines, car se prêtant mal à l’agriculture, les terres nées de la
1ère correction des eaux du Jura trouvèrent leur vocation au milieu du 20e siècle avec le développement des
loisirs lacustres. Dès 1910, les premiers naturalistes relevèrent la valeur biologique extraordinaire des lieux.
Des navigateurs de la Rive nord s’y intéressèrent également et obtinrent en 1930 de pouvoir y établir des
chalets de vacances. Dès la fin de la guerre, la reprise économique poussa quelques investisseurs à
développer le tourisme sur la Rive sud. Des zones résidentielles et des ports de petite battellerie furent alors
construits. En 1980, près d’un quart de la Rive sud avait été affectée aux loisirs lacustres. Le processus de
protection démarra dès 1982.
Elle est constituée de 8 réserves naturelles, couvrant 3000 hectares et s'étendant sur plus de 40 km. Elle
abrite environ 1'000 espèces végétales et 10’000 espèces animales, soit approximativement le tiers de la flore et
le quart de la faune suisse. Sa diversité et sa rareté fait de ce lieu un ensemble naturel exceptionnel dont la
valeur est reconnue au plan international.
La Grande Cariçaie est un site dont l’importance n’est plus à démontrer et la nécessité de structurer ses
données dans une base de données unique est évidente afin de faciliter les travaux de gestion, d’analyse du
milieu et de surveillance scientifique.
Bibliographie :
- Savignat Géraldine, Un SIG pour le Parc naturel Régional de Millevaches en Limousin, Rapport de
Stage, Septembre 2005.
- Riedo Marc, Etude et réalisation d’un base de données prototype pour la gestion de la grande Cariçaie,
travail de diplôme, 1996

1
/
3
100%