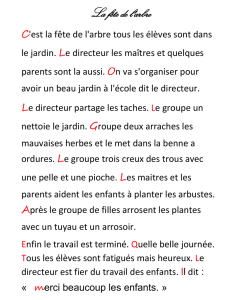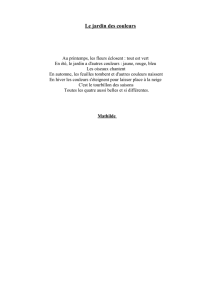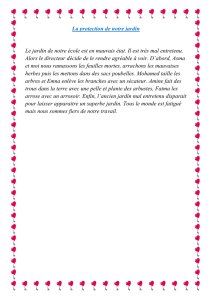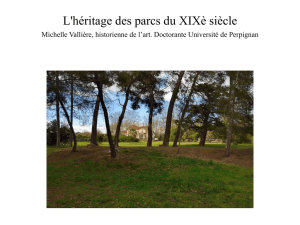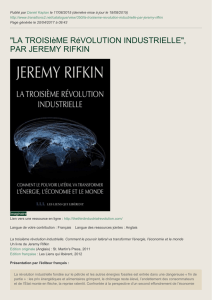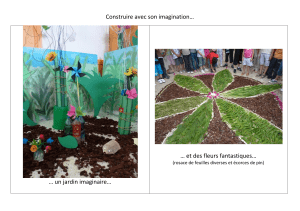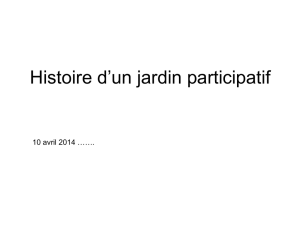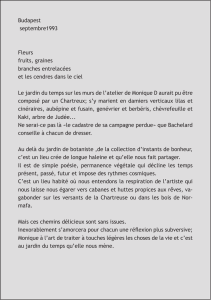La ville et la transition écologique Table des matières (Mode Word

La ville et la transition écologique
Table des matières
(Mode Word : Ctrl + clic sur l’Article pour accéder au chapitre désiré)
Article 01 - François-Michel Lambert : « Changer de cap face à la raréfaction des ressources »
Article 02 - Mobilisation pour la qualité de l’air
Article 03 - Conférence environnementale : un bilan en demi-teinte pour les collectivités
Article 04 - Jeremy Rifkin, le bon plan de la région Nord-Pas-de-Calais
Article 05 - Stratégie Europe 2020… « Une économie plus intelligente, plus verte, plus inclusive ? »
Article 06 - Jean-Louis Joseph, président de la FPNRF : « Les parcs naturels régionaux seront autonomes en
énergie dans 15 ans »
Article 07 - Contrat de performance énergétique appliqué aux bâtiments : un guide et des « fiches exemples »
Article 08 - L’économie circulaire en actes
Article 09 - Contre la précarité énergétique des ménages, Grenoble crée une plateforme d’assistance
Article 10 - Paris 20e : le jardin en l’air et solidaire achève son insertion
Article 11 - Les 8 rapports du débat national de la transition énergétique
Article 12 - La communauté de communes du Méné vise l’autonomie énergétique en 2030
Article 13 - Simplification pour les permis de construire et la transition énergétique
Source : Le Courrier des Maires
http://www.courrierdesmaires.fr/

Article 01 -
François-Michel Lambert : « Changer de cap face à la raréfaction des ressources »
Pour François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, l’économie circulaire permet de sortir du
modèle linéaire “extraire-produire-consommer-jeter”, qui prévaut depuis la révolution industrielle et
mène aujourd’hui dans une impasse.
Propos recueillis par Fabienne Nedey
François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, vice-président de la commission du développement
durable et de l’aménagement du territoire, préside l’Institut de l’économie circulaire.
Courrierdesmaires.fr. Vous êtes le président de l’Institut de l’économie circulaire, une association nationale
multi-acteurs lancée en février 2013. Qu’est-ce exactement que l’économie circulaire ?
François-Michel Lambert. « C’est la convergence de réflexions engagées depuis maintenant plus de 40 ans sur
la raréfaction des ressources. L’économie circulaire est un autre modèle économique qui vise à optimiser les flux,
d’énergie, de matières, en s’appuyant sur 7 axes : dans l’ordre, l’écoconception, l’écologie industrielle, l’économie
de la fonctionnalité, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage.
Il s’agit par exemple de rallonger la durée de vie des produits, en bannissant les toxiques et l’obsolescence
programmée. Le modèle prône aussi une révolution des modes de commercialisation et de consommation :
l’usage plutôt que la possession du bien, etc. L’objectif est de parvenir à découpler la croissance économique de
l’épuisement des ressources naturelles par la création de produits, services, modèles d’affaire et politiques
publiques innovants. La vocation de l’Institut de l’économie circulaire est d’aider à identifier les freins et à mettre
en place les leviers nécessaires à la généralisation de ce modèle.
Est-ce une vision réaliste de l’avenir ?
F.-M. L. Tout à fait. Aux Pays-Bas, les positions prises par le gouvernement ont favorisé des initiatives
extraordinaires et permis à ce pays de prendre une avance certaine. La manière dont ils sont parvenus à mettre
en pratique circuits de proximité, collaborations entre les acteurs, développement à partir de leurs propres
ressources, est remarquable.
En matière d’écoconception appliquée à la construction de bâtiments par exemple, tout est pensé en fonction de
l’évolution future des constructions, jusqu’à leur déconstruction afin de récupérer les matériaux en fin de vie. En
matière d’économie de la fonctionnalité, des entreprises développent l’usage de moquettes, de chaises, de
lumière et non plus la vente de ces produits.
« Soutien aux politiques de partage, de transmission, d’allongement de la durée de vie de produits , de
valorisation matière de déchets… Les maires font déjà de l’économie circulaire sans le savoir”
Le port de Rotterdam, premier port européen, a inscrit dans son plan stratégique l’économie circulaire et plus
particulièrement le développement d’activités économiques sur le concept d’écologie industrielle. La totalité des
flux générés par le port et les entreprises intégrées au port sont des sources de production de matière générant
de nouvelles activités, en boucles industrielles, pourvoyeuses d’emplois locaux et non délocalisables.
Les Pays-Bas nous démontrent que l’utopie est réalité. Nous pouvons développer une économie fondée sur la
circularité de la matière, créatrice d’emplois, améliorant l’environnement. A nous de définir le modèle adapté à la
très grande diversité de nos territoires.

Comment envisagez-vous le rôle des maires dans le déploiement d’un tel modèle ?
F.-M. L. L’échelon communal est fondamental, du fait de sa capacité à agir sur ses propres services internes, sur
les services rendus aux habitants, mais aussi de sa parfaite connaissance des acteurs de terrain, de leurs
besoins, de sa faculté de mise en contact et d’entraînement.
En fait, les maires font déjà de l’économie circulaire sans le savoir : soutien aux politiques de partage
(covoiturage, Vélib’), de transmission (ressourceries), d’allongement de la durée de vie de produits (réparation de
vélo), de valorisation matière de déchets (compost)… Ils peuvent systématiser ces démarches dans une vision
d’économie industrielle et d’échange de flux.
« Le concept de l’économie circulaire se décline aussi en matière de foncier”
Je peux citer une multitude d’exemples d’articulations à mettre en œuvre. Ainsi, à Aubagne, à quelques
kilomètres de distance, une entreprise achetait des palettes et une autre en jetait : les mettre en contact a évité
des transports et soulagé la collectivité. On peut imaginer la même chose sur la valorisation de la chaleur, que
certains produisent en excès (artisans, restaurants, etc.) alors qu’au même endroit d’autres en manquent.
L’économie circulaire peut-elle aussi s’appliquer dans des domaines traditionnels ?
F.-M. L. Oui. Au lieu de construire des bâtiments uniformisés, on peut encourager des démarches s’appuyant sur
les matériaux locaux et exploitant les ressources du territoire. Le concept de l’économie circulaire se décline
aussi en matière de foncier, car il devient lui aussi une ressource rare et devant être économisée.
Là encore, on peut imaginer de nombreuses approches innovantes, en réfléchissant à une intensification de
l’utilisation de l’espace. On peut envisager des adaptations toutes simples : remplacer le gazon naturel du stade
de foot par un gazon synthétique autorise d’autres activités, multiplie par dix le temps d’utilisation de ce lieu et
évite de construire un stade de rugby ou une salle de handball qui consommeront de l’espace. Plus original, on
peut chercher à trouver d’autres usages aux grands parkings vides la moitié du temps. Il suffit de débrider sa
pensée et on ouvre le champ d’un cercle vertueux local.
La table ronde sur l’économie circulaire lors de la Conférence environnementale de septembre 2013 a
regroupé trois ministres et un aréopage de personnalités et d’experts, mais il n’y a pas eu le signal fort
que vous attendiez…
F.-M. L. La Conférence environnementale est tombée dans une chausse-trappe trop fréquente : elle s’est limitée
à aborder le sujet par les déchets. En ne s’intéressant qu’à l’ultime bout du cycle, on passe à côté des enjeux
prioritaires (écoconception, économie industrielle, économie de la fonctionnalité) et cela ne nous permettra pas
de sortir de l’ornière dans laquelle nous nous enlisons.
Sur le coup, le constat de cette occasion manquée a généré une grande déception. On n’a pas encore, au
sommet de l’Etat, commencé à penser “ressources” au lieu de “déchets”. En revanche, la très grande majorité
des participants à la Conférence s’inscrivaient dans une approche très constructive. J’espère que la conférence
de mise en œuvre, qui devrait être un moment plus apaisé, changera la donne. Il est indispensable que l’Etat
donne un cap et envoie des signaux aux acteurs. Comme les Pays-Bas, mais aussi l’Allemagne, le Japon et
même la Chine, l’ont déjà fait.
Revenir à la table des matières

Article 02 -
Mobilisation pour la qualité de l’air
La Commission européenne a présenté, le 18 décembre, une série de mesures en faveur de la qualité de
l’air. La France, sous la menace de sanctions européennes, active ses plans de protection de
l’atmosphère. Et envisage de renouer avec la circulation alternée en cas de pic de pollution.
Alerte au dioxyde d’azote le 18 décembre dans le Territoire de Belfort, cinq jours d’alerte en Ile-de-France, alerte
aussi en Rhône-Alpes, Hautes-Pyrénées et Oise… En 2013, le seuil d’alerte n’avait été déclenché en Ile-de-
France qu’une seule fois, le 3 décembre, avant cet épisode. Il l’avait été quatre fois en 2012, et jamais en 2011 et
2010. Il faut remonter à décembre 2007 pour retrouver un épisode aussi long d’alerte aux particules en Ile-de-
France.
Contentieux européen
La qualité de l’air en France est mauvaise. La France fait d’ailleurs l’objet depuis plusieurs années d’une
procédure contentieuse pour non-respect des valeurs limites de particules, fixées par une législation entrée en
vigueur en 2005.
La France a reçu une mise en demeure de la Commission européenne le 23 novembre 2009, suivie d’un avis
motivé le 29 octobre 2010, lui demandant de prendre des mesures pour mettre fin au dépassement des limites
concernant les particules PM10 dans quinze zones du pays. La réponse n’étant pas jugée satisfaisante, la
France a été assignée devant la Cour de justice européenne, le 19 mai 2011.
Le 21 février 2013, la Commission a de nouveau adressé une mise en demeure à la France concernant le
manquement à l’obligation d’établir et de mettre en œuvre des documents permettant de respecter les normes.
Quinze régions sont concernées. La France fait aussi l’objet de demandes d’information de la part de la
Commission européenne pour non-respect des valeurs-limites de concentration de dioxyde d’azote (NO2) dans
l’air et pour dépassement du plafond national d’émissions d’oxydes d’azote (NOx).
Les réponses de la France se sont succédé, depuis le plan particule de 2010, sans résultats satisfaisants, avec,
la dernière en date, le plan d’urgence pour la qualité de l’air, le 6 février 2013. Il y a, en effet, urgence face à la
pression européenne.
« Si la France était condamnée (dans un délai d’un à deux ans), elle encourrait une amende d’un montant de
l’ordre de plusieurs dizaines de millions d’euros par an, jusqu’à ce que les normes de qualité de l’air soient
respectées », rappelle le ministère de l’Ecologie. L’amende pourrait atteindre 11 millions d’euros et les astreintes
journalières, dès 2014, au moins 240 000 euros, soit environ 100 millions d’euros pour l’année, puis 85 millions
les années suivantes. C’est pourquoi il y a urgence à convaincre la Commission que les plans d’action pour la
qualité de l’air, qui prennent la forme des plans de protection de l’atmosphère, permettront de répondre aux
obligations communautaires.
Table-ronde sur la circulation alternée
Autre réponse, conjoncturelle, suite à l’actualité récente : la réactivation du principe de la circulation alternée,
appliquée à l’ensemble des polluants réglementés, alors que le dispositif antérieur ne s’appliquait qu’à la pollution
à l’ozone. Décision prise lors d’un Comité interministériel de la qualité de l’air (CIQA), du 18 décembre.
Le ministre de l’Ecologie, Philippe Martin, a proposé l’organisation, dès janvier 2014, d’une table ronde avec les
collectivités locales et les autorités organisatrices de transport afin d’étudier les modalités de mise en œuvre de
cette mesure.

Nouvelles mesures européennes
Le même jour, la Commission européenne annonçait un nouveau train de mesures en faveur de la qualité de l’air
en Europe :
•un nouveau programme «Air pur pour l’Europe», prévoyant des mesures destinées à garantir la réalisation des
objectifs existants à court terme, et établissant de nouveaux objectifs de qualité de l’air pour la période allant
jusqu’à 2030. Le paquet comprend également des mesures de soutien pour réduire la pollution de l’air, mettant
l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’air dans les villes, le soutien à la recherche et à l’innovation, et la
promotion de la coopération internationale ;
•une révision de la directive sur les plafonds d’émission nationaux, fixant des plafonds nationaux d’émission plus
stricts pour les six principaux polluants ;
•et une proposition de nouvelle directive visant à réduire la pollution provenant des installations de combustion de
taille moyenne, comme les installations de production d’énergie de quartier ou de grands bâtiments, et les petites
installations industrielles.
Chiffres Clés
23 milliards d’euros par an : les coûts directs liés à la pollution de l’air dans l’Union européenne (UE), y compris
les dommages causés aux cultures et aux bâtiments.
Revenir à la table des matières
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
1
/
30
100%