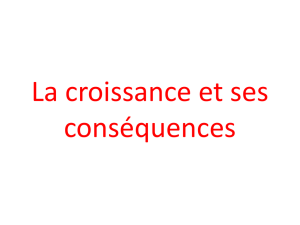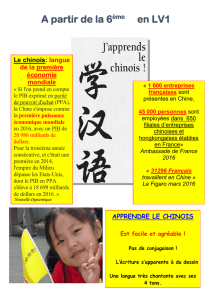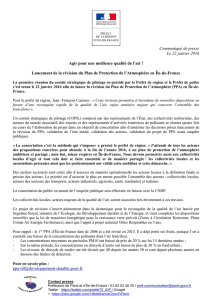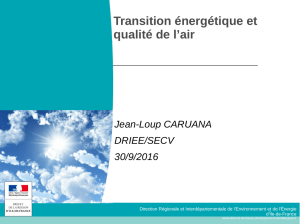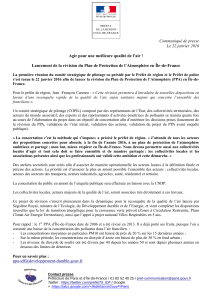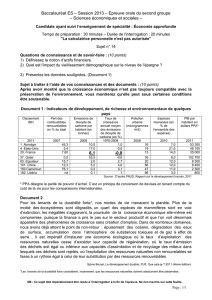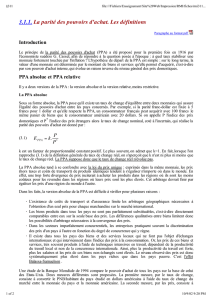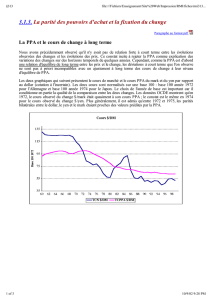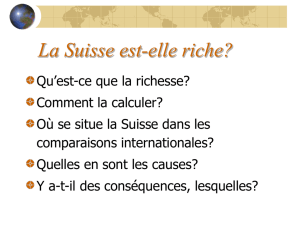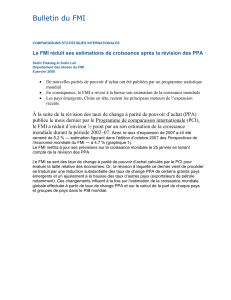Aspectualité, temporalité et séquentialité :

L’interprétation des participes présents en prédication seconde : co-verbe ou sous-
phrase autonome ?
1. Cadre
La définition des constructions à prédication seconde (CPS) oscille d’après le tour considéré entre une
saisie fonctionnelle - en termes de fonction périphérique de la prédication de base - et une
appréhension qui accentue plutôt l’élaboration d'une prédication ‘complexe’ à travers l'imbrication de
deux rapports prédicatifs. Notre recherche vise à identifier des propriétés syntaxo-sémantiques
communes à ces constructions apparemment disparates permettant à la fois de mieux délimiter les
frontières avec la structure argumentale de la prédication première et de préciser les différences avec le
rapport de subordination.
2. Objectifs de la contribution
Notre étude se centre sur le participe présent non absolu et non épithète (PPa). D’après Herslund
(2000), c’est fondamentalement un co-verbe qui, en combinaison avec le verbe principal, dénote une
situation unique. Pour Combettes (2003) par contre, il possède les propriétés constitutives d’une forme
verbale autonome. Notre contribution veut montrer que le fonctionnement de ces PPa est
effectivement différencié : Parfois, les prédicats dénotent une seule action (1a) mais souvent aussi des
événements distincts (1b) ; par ailleurs, le PPa peut aussi porter sur un nom plutôt que sur le
verbe(1c) :
1. a) La sultane s’est levée mettant fin à l’entretien.
b) Apprenant la mission dont il était en charge, A.B. répondit que le petit Baron le dégoûtait.
c) La publication du journal de S.J, relatant la campagne de son mari [...], a fini de persuader
chacun [...].
A partir de là, elle soulignera le parallélisme entre les emplois des PPa et les diverses CPS de type
adjectival.
3. Hypothèse et méthode
Notre méthode d’analyse des CPS est basée sur deux dimensions centrales du traitement paramétrique
des types de connexions phrastiques, généralement reconnues comme étant une des approches
analytiques les plus appropriées des combinaisons de propositions dans les langues naturelles (Raible
2001 : 614) : la première dimension implique une série de propriétés en rapport avec la cohésion
intraprédicative de la prédication seconde ; la seconde propose un faisceau de caractéristiques
orientées vers la cohésion interprédicative entre les deux prédications.
4. Résultats
L’analyse des PPa selon cette double dimension permet d’abord de mettre en évidence l’unité
profonde de la construction, en soulignant le fonctionnement parallèle entre les PPa et les adjectifs en
CPS dans certains tours comme les suivants :
2. a) La sultane s’est levée mettant fin à l’entretien
b) La sultane est morte jeune
3. a) Je l’ai trouvé ivre.
b) Je l’ai surpris volant une pomme.
Elle caractérisera ensuite les différences entre les tours en les faisant découler de leur composition.
Ainsi, nous décrirons l’impact de l’origine verbale des PPa sur leur capacité à marquer une valeur
temporelle ou aspectuelle, déniée par certains (Gettrup 1977), mais accepetée dans certains contextes
par d’autres (Arnavielle 2003, Combettes 2003).
5. Bibliographie
ARNAVIELLE, T. (2003), “Le participe, les formes en –ant : positions et propositions”. Langages 149, 37 –54.
COMBETTES, B. (2003), “L’évolution de la forme en –ant : aspects syntaxiques et textuels “. Langages 149, 6-
22.

GETTRUP, H. (1977), “Le gérondif, le participe présent et la notion de repère temporel”. Revue romane 12,
210-271.
HERSLUND, M. (2000), “ Le participe présent comme co-verbe “. Langue française 127, 86-94.
RAIBLE, W, 2001, “Linking clauses“, HASPELMATH, M., EKKARD, K., OESTERREICHER, W. (eds.),
Language typology and language universals : an international handbook. Sprachtypologie und sprachliche
Universalien : ein internationales Handbuch. La typologie des langues et les universaux linguistiques :
manuel international, Berlin, W. De Gruyter, 590-617.
1
/
2
100%