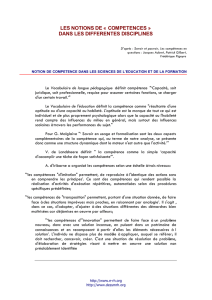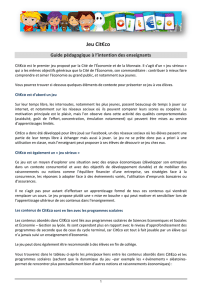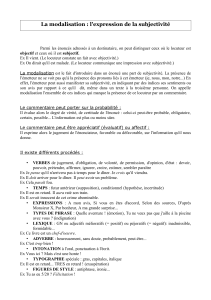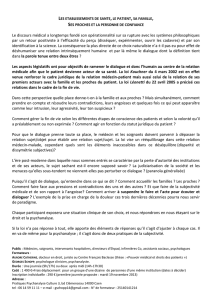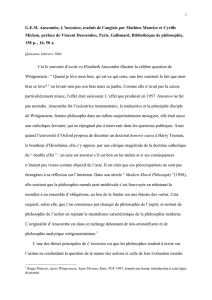Passer à l`action - comprendre

Passer à l’action ? Remarques sur la psychologie
des sociologues
par Yves Clot
On n’y échappe pas : les sciences humaines, et tout particulièrement la sociologie, sont le
théâtre d’une forte relance des « théories de l’action ». Cette relance s’alimente au regain
d’intérêt de beaucoup de chercheurs pour la dimension philosophique du problème. Sous
l’effet du reflux de la figure marxiste de l’action historique, la confrontation des traditions
issues de la phénoménologie et de la philosophie analytique revient au premier plan [1].
Au-delà, une philosophie pratique de l’agir social cherche à repenser le sens de l’activité
politique en parcourant le chemin suivi par M. Weber, H. Arendt ou J. Habermas [2].
I - Une « anthropologie de la prudence »
Il semble aussi que la référence à Aristote soit devenue structurante pour accompagner la
redécouverte de cette rationalité pratique [3]. Certes A. Tosel a raison de faire remarquer
que ce retour à Aristote s’opère selon les lignes de clivage des débats contemporain, en
séparant, dans la tradition grecque, la philosophie pratique de l’ontologie qui lui donne
sens [4]. Il reste qu’il est devenu fréquent de regarder L’Éthique à Nicomaque comme « la
première théorie de l’action » et qu’une interprétation récente de la pensée de Marx
comme « philosophie de l’activité » n’hésite pas à soutenir que ce dernier a trouvé dans
Aristote l’antidote de l’idéalisme hégélien [5].
Bien sûr il n’est pas dans mon propos de discuter le bien-fondé théorique de ce retour à
Aristote. Par contre on peut réfléchir, dans la conjoncture actuelle, sur la percée de cette
« anthropologie de la prudence », pour reprendre le mot de P. Aubenque. Si l’on évite le
contresens qui ferait prendre le souci de la délibération et, plus largement, la « prudence »
d’Aristote (phronesis) pour des signes de renoncement à agir, on partagera sans peine
l’analyse de P. Aubenque sur les racines historiques de cette anthropologie : au début, la
société de Platon, désaxée mais dans laquelle tout paraît possible à l’action des hommes
justifiée par la science, à la fin, l’impuissance politique de la Grèce, l’impossibilité de
transformer le monde, transmuée en une cosmologie du destin. « Entre les deux, le monde
d’Aristote est ambigu, comme la société où il vit : tout n’est pas possible, mais tout n’est
pas impossible ; le monde n’est ni tout à fait rationnel, ni tout à fait irrationnel. La
délibération traduit cette ambiguïté » [6]. On peut penser que le monde dans lequel nous
vivons aujourd’hui n’a rien à envier à celui d’Aristote en matière d’équivocité.
Simultanément offert et refusé, l’avenir fait rage contre lui-même et les conditions de
possibilités de l’activité transformatrice n’existent que sous bénéfice d’inventaire. Du
coup, il paraît difficile de séparer la réhabilitation en cours des « théories de l’action » et la
situation historique présente où se cherchent les sujets d’une possible intervention sur le
monde.
II - Un préalable : l’action avec qui ?
Dans ce cadre, la discussion ouverte par le « passage à l’action » de quelques-unes des
disciplines des sciences de l’homme fait peut-être partie des inventaires en cours sur les
possibilités d’agir. Il n’est pas possible de parcourir tout le spectre couvert par le travail
réalisé dans ces disciplines. Dans ce qui suit je me limiterai à examiner d’abord quelques
problèmes relatifs à la réception sociologique de l’ethnométhodologie en France. Encore
plus étroitement j’essaierai de comprendre les termes de la confrontation entre
sociologues portant sur l’intentionnalité du sujet dans l’action. C’est ce qui me poussera à
m’intéresser à ce qu’on pourrait appeler « la psychologie spontanée des sociologues ».

Au préalable, c’est le régime de production des connaissances sur l’action que je voudrais
questionner. Car il est malheureusement toujours possible de réduire l’action à son
concept sans reconduire les problèmes épistémologiques à la transformation effective des
situations humaines concrètes. En effet, même lorsqu’on est résolu à mettre l’action au
centre de la réflexion conceptuelle, on peut se trouver concerné par cette remarque de A.
Rich : « Lorsque quelqu’un qui jouit de l’autorité du professeur, par exemple, décrit le
monde et que vous n’en faites pas partie, il y a un moment de déséquilibre psychologique,
un peu comme si vous regardiez dans un miroir sans vous y voir [7]. »
Soyons net. Le miroir des concepts est indispensable à qui veut se connaître. Mais, à
l’inverse, ce miroir ne démontre son utilité qu’exposé au dehors, face à ce qui n’est pas lui.
L’expérience de la vie a besoin d’être réfléchie, pas escamotée. On peut le dire aussi en
soutenant la thèse d’une double racine de la pensée. C’est L. Vygotski qui a peut-être été le
plus loin dans ce sens [8]. Pour lui, les concepts scientifiques et les concepts quotidiens
sont deux sources d’intelligibilité qui peuvent se rejoindre mais jamais s’identifier. Les
seconds sont saturés de contenus empiriques, gorgés du sens d’une expérience singulière.
Les premiers ne prennent pas les choses directement comme point de départ et leur
rapport à l’objet est lui-même médiatisé par le système de concepts. Il y a deux façons de
penser, et ce qui fait la force de l’une fait la faiblesse de l’autre. Du coup, les dangers qui
menacent le développement des concepts quotidiens sont tout autres que ceux qui
menacent la croissance des concepts scientifiques risque de se refermer sur les rhétoriques
narratives d’un côté, risque de s’isoler dans l’exercice logique et catégoriel de l’autre [9].
C’est sans doute pourquoi M. Bakhtine a pu écrire que tout le problème de l’exactitude des
sciences humaines tient à la difficulté de « surmonter l’altérité de ce qui est autre sans le
transformer en quelque chose à soi » [10]. A vrai dire cette difficulté nous impose non
seulement d’avoir une activité théorique mais aussi de construire des milieux sociaux
d’analyse et d’actions comme instruments de recherche. S’ils sont durables, ces milieux
scientifiques élargis, ces « tiers-milieux » cultivant l’indépendance mutuelle des formes de
vie et des formes de recherche, peuvent agir comme des zones communes de
développement décisives pour lier et relier inlassablement les deux lignes d’intelligence
opposées décrites ci-dessus. Quand ces conditions existent, c’est le régime de production
du savoir sur les hommes qui se trouve modifié. Les concepts scientifiques germent vers le
bas par l’intermédiaire des concepts quotidiens et ceux-ci germent vers le haut par
l’intermédiaire des autres. Cette discordance créatrice instituée me paraît être le ressort
philosophique indispensable de la recherche en sciences humaines. Le chercheur, pour ce
qui le concerne, est alors au carrefour d’une double expérimentation « dialogique », avec
l’expérience de ses interlocuteurs d’un côté, avec la communauté scientifique de
l’autre [11].
III -Le choix ethnométhodologique
En fait, c’est sans doute aussi avec ce genre de préoccupations que s’est décidé le tournant
sociologique assumé par ce qui allait devenir l’École de Chicago entre 1915 et 1935, si l’on
retient sa grande époque comme référence. Il ne s’agit pas ici de discuter directement de la
contribution importante de cette tradition [12] à la reconnaissance de l’intelligence
sociologique existant en dehors de la sociologie professionnelle. Il s’agit plutôt de
comprendre pourquoi ce retour au concret dont portent témoignage tant de beaux
travaux [13] et ce souci de saisir l’expérience dans le vif des interactions sociales peuvent
susciter en France une discussion aussi engagée chez ceux qui cherchent à promouvoir
l’action pratique comme concept central de la sociologie. Visiblement, en traitant les faits
sociaux comme des « accomplissements » factuels portant strictement en eux-mêmes le
sens de la situation observée, l’ethnométhodologie a ranimé de vieux démons
épistémologiques.

On ne dira jamais assez à quel point l’interactionnisme cherche à se défaire du mythe de
l’intériorité dans l’analyse de l’activité humaine. O. Schwartz a bien marqué, par exemple,
à quel point pour H. Becker, l’un des maîtres de cette tradition, il n’est pas de propriété
« cachée » du comportement, pas de « qualités occultes » du social qui ne puissent se
regarder comme l’effet d’une séquence interactive. L’interactionnisme, écrit-il, ne connaît
pas de « boîte noire » [14]. On pourrait dire qu’il s’agit d’une sociologie sans vie intérieure,
si l’on voulait flirter avec le vocabulaire utilisé par G. Politzer pour définir sa « psychologie
concrète ». L. Quéré a particulièrement insisté sur les implications de cette posture
épistémologique en marquant ainsi la réception française des travaux américains.
L’originalité de l’ethnométhodologie résiderait dans une « désubjectivation de
l’intentionnalité ». Pour lui, « l’action n’est pas un mouvement d’extériorisation d’une
intériorité déjà constituée. Au contraire l’intériorité se forme par réappropriation,
internalisation et formulation des actions et expressions publiques » [15]. C’est une
« illusion grammaticale » que de se représenter la subjectivité comme un état mental
déposé dans une « instance externe de pilotage de l’action et d’attribution de sens »
(ibid.). La subjectivité n’a pas plus de consistance qu’une émergence en cours
d’accomplissement public de l’action. On reconnaîtra sans peine dans cette formulation
l’influence de la critique radicale de Wittgenstein à l’égard de tout mentalisme et de tout
fétichisme du sens : « on ne peut pas savoir ce que l’on cherche à faire si ce qu’on fait n’a
jamais été fait par quiconque » (ibid., p. 104). La démonstration suit donc le chemin d’une
identification de la subjectivité à l’intentionnalité puis, celle-ci étant considérée comme
une propriété émergente de l’action, l’analyse débouche sur l’identification de l’agent à un
corrélat de l’accomplissement social de ses actes. On comprend dans ces conditions que
l’action - qui est toujours action réciproque - soit seulement passible d’une enquête
« grammaticale » s’interdisant les explications causales qu’engendre toujours la question
« pourquoi ? » Une analyse sémantique de l’action, en épousant le sens commun, ne peut
qu’enfermer le chercheur dans l’impasse scientifique de la sociologie compréhensive. Cette
conclusion a le mérite de la clarté. Très proche des conceptions de H. Garfinkel, elle a fait
l’objet d’une critique non moins claire de P. Pharo.
IV -Le retour de l’intention
Ce dernier voit dans l’ethnométhodologie « une accentuation behavioriste et sceptique de
la théorie wittgensteinienne » [16]. A suivre cette accentuation, l’intention n’est plus
qu’une modalité de l’action dont la factualité épuise la signification. A ce compte, « on ne
peut que perdre son temps à faire comme le sens commun et la sociologie usuelle qui ne
cessent de chercher des motifs à des événements dont le sens est rigoureusement
inaccessible » (ibid.., p. 280). Bien sûr, il n’est pas pensable de séparer l’intention de
l’action mais, en suivant E. Anscombe, P. Pharo soutient qu’il existe un ordre original de
l’action et de la rationalité pratique fait « de connaissance préthéorique et d’exercice d’un
désir en vue d’une fin » (ibid., p.283). L’existence d’un « vouloir actif » du sujet de l’action
présidant à la formation des buts et au choix des moyens, théâtre de délibérations
internes, n’est pas réductible à une grammaire de l’action. Même si l’on suit Wittgenstein -
ce qui ne va pas de soi - pour qui « le monde de la représentation est tout entier décrit
dans la description de la représentation » [17], même si, en conséquence, décrire le motif
n’est rien d’autre que décrire l’accomplissement de l’action, rien n’autorise à aller plus
loin : à penser, par exemple, que ces descriptions ne puissent jamais apporter une réponse
vraie à la question du « pourquoi ? ». Mieux, la liaison sémantique entre l’intention en
acte et sa description, écrit P. Pharo, « nous réintroduit immanquablement et de façon
renouvelée dans la problématique de la responsabilité et de la justification morale à
l’intérieur de la Cité » (ibid., p. 305).
L. Quéré a répondu à ces objections, qu’on revient en deçà de l’interactionnisme lorsqu’on
réintroduit la substance d’un sujet présupposé de l’action, lorsqu’on prend le sens
commun à la lettre et enfin lorsqu’on rétablit le primat de l’opposition entre individu et

société [18]. Une philosophie morale de la conscience ne peut que suivre un tel acte de
réhabilitation de l’intentionnalité en sociologie.
L’antagonisme de ces « théories de l’action » pourra paraître irréductible si on ajoute au
dossier de cette discussion l’intérêt de P. Pharo pour l’hypothèse de E. Anscombe selon
laquelle pourrait exister en l’homme une tendance originaire à bien faire [19]. Cette
prémisse formerait le lien intrinsèque du jugement et de l’action et fonderait la possibilité
de « vérités pratiques ». Désir informé, l’intention rendrait l’action vraie ou fausse (ibid.,
p. 191).
V - Subjectivité et intentionnalité : quel « social » ?
Il n’est pas envisageable ici de pousser d’avantage la discussion qu’appelle cette sociologie
de l’éthique si réceptive à l’anthropologie de la prudence évoquée plus haut. Je voudrais
plutôt concentrer mon attention sur la question de l’intentionnalité et surtout questionner
l’évidence de l’identification entre subjectivité et intentionnalité qui pourrait bien être le
point aveugle de la discussion entre les tenants de l’ethnométhodologie et leurs critiques.
Disons-le brutalement Contrairement aux apparences, l’anti-psychologisme militant de
l’interactionnisme ne fait pas la part belle au social. On peut même se demander si ce n’est
pas sa conception de la socialité qui rend trop lourde pour lui l’hypothèse « subjective ».
Pour L. Quéré, par exemple, si le sens de l’action n’a bien sûr pas sa source dans le sujet, il
ne la trouve pas non plus « dans la situation ou dans l’histoire. Il est intersubjectivement
assemblé, sur une base purement procédurale, à partir de significations publiques déjà
données par les formes symboliques » [20]. Cette définition du sens de l’activité comme
usage du symbolique fait de la subjectivité une appropriation des normes collectives que
les agents se rendent mutuellement disponibles. Par une action réciproque de
configuration, ils s’accordent sur « les faits naturels de la vie », pour reprendre
l’expression de Garfinkel, c’est-à-dire sur des définitions de l’ordre des choses tenues pour
légitimes et sur des structures normatives qui les obligent moralement [21].
Rien ici qui permette de penser la vie sociale dans ces dissonances constitutives comme un
rapport entre les plusieurs ensembles, les plusieurs formes de vie auxquelles chaque
individu appartient et entre lesquels il se doit de circuler. Rien qui ne nous rapproche de
cette arène d’incitations discordantes que recèle la topologie sociale, ni même des
possibilités simultanément offertes et refusées qu’elle renferme. Or, vivre en société n’est
pas un exercice de grammaire symbolique. Certes, « on ne peut savoir ce que l’on cherche
à faire si ce qu’on fait n’a jamais été fait par quiconque » mais il faut bien expliquer
pourquoi, alors, nous nous entêtons à chercher à faire ce qui n’a jamais été fait.
Décrire un segment d’actions réciproques indépendamment des réseaux et des univers
socio-historiques qui viennent s’y mêler, s’y croiser, s’y contredire, et opposent par
conséquent la situation à elle-même, coupe l’herbe sous les pieds à l’activité du sujet.
Transparente, la situation est sans énigme. Elle n’offre pas d’intrigues à l’intersection des
logiques socio-symboliques excentrées, mais seulement l’immédiateté de « l’arrangement
spontané des parties ». Ce qui est alors occulté c’est le temps des questions ou des doutes
qui ont partie liée avec les contradictions multiples de la situation, pour ne laisser
subsister que l’espace des réponses grammaticalement possibles. Au contraire, on peut
considérer, en suivant ici l’œuvre trop ignorée de Ph. Malrieu, que les individus n’agissent,
même à leur corps défendant, que dans une pluralité de formations sociales qui les
provoquent. De plus, chacun des ensembles ou systèmes où se déroule leur vie est porteur
de valeurs et de significations propres, sources d’une disparité qui « divise les acteurs
entre eux et au fond d’eux-mêmes » [22]. Ces divisions exposent ceux qui les vivent à
chercher un sens à ces discordances qui, même lorsqu’elles échappent à l’acteur, révèlent
leur force dans le sentiment d’aliénation du sujet.

Il s’ensuit que, loin d’être le coffret de l’intentionnalité, le sujet n’existe qu’en découvrant
les valeurs des formes de vie qui le divisent, qu’en éprouvant leurs possibilités et leurs
contradictions, qu’en agissant pour surmonter celles-ci dans une activité de subjectivation
d’où la société ne sort jamais identique à elle-même. Le sujet existe si et seulement si, en
quelque façon, existe le pouvoir de l’individu de se déprendre de ce que ses activités
sociales représentent pour lui et pour l’ensemble de ceux auxquels il s’identifie. Dans cette
perspective, la subjectivité est un travail du sujet pour « se mettre à distance de l’une de
ses formes de vie sociale lorsqu’il est situé dans l’autre » au prix de payer ses
identifications successives du sacrifice d’autres possibilités. Pour être abandonnées, ces
possibilités ne sont d’ailleurs pas abolies pour autant et continuent d’agir. Mais il
n’empêche : être sujet c’est aussi « se faire inconscient, par ses choix, ses partis-pris, ses
paris, d’une part de la réalité » (ibid., p. 264). Ainsi, toute représentation du réel
résulterait d’un tri opéré parmi plusieurs représentations possibles. Toute intention
impliquerait le refoulement d’une autre et la subjectivité, loin de voir ses frontières
dessinées par l’intentionnalité vivrait, au contraire, de ses limites. C’est ainsi que nous
comprenons la formule de G. Canguilhem : « la subjectivité, c’est alors uniquement
l’insatisfaction. Mais c’est peut-être là la vie elle-même » [23]. La subjectivité n’est pas une
chose, - fût-ce une représentation mentale -, c’est un rapport qu’on ne peut dissoudre tout
entier dans une description grammaticale. La critique de l’illusion d’intériorité psychique
s’aveugle si elle confond subjectivité et intentionnalité. L’activité des sujets est rendue
amorphe si elle est regardée seulement comme une médiation des interactions et on
échoue à désubstantialiser l’individu et la société, comme L. Quéré souhaite le faire, si on
ramène la qualité de sujet à une émergence ou à un corrélat. Il semble préférable de
soutenir, avec Ph. Malrieu, que la qualité de sujet s’éprouve, entre les formes sociales,
comme médiateur actif : « Elle leur est assujettie, et en même temps elle est le lieu ou se
révèlent leurs contradictions. Il lui revient de choisir entre elles, comme de rechercher les
moyens de les rendre compatibles : ce n’est pas possible sans un effort pour prendre
conscience des refoulements, des méconnaissances que le sujet opère pour se défendre des
angoisses que suscitent ses divisions internes » (op. cit., p. 265). Ici on pourrait parler
avec J.-L. Nancy d’un sujet qui n’est pas plus présupposé que se supposant lui-même mais
« " exposé " ou s’exposant. C’est-à-dire à la fois présenté au dehors, exhibé et risqué,
aventuré » [24].
VI -Intentionnalité et subjectivité : quel sujet ?
Et de fait, à l’occasion des hésitations, des délibérations et des dénégations par lesquelles
il s’emploie à surmonter les divisions auxquelles l’exposent les contradictions sociales, le
sujet se mesure aux conflits de sa propre histoire. Aux discordances topologiques
croissantes de ses formes de vie sociale répond, sans coïncidence, une topologie subjective
attestant que l’histoire vécue par lui n’est pas et ne fut jamais la seule possible. Les
histoires avortées, les projets suspendus ne disparaissent pas sans laisser de traces. Les
vies non vécues ne sont pas abolies. Refoulés, leurs résidus incontrôlés n’en ont que plus
de force pour exercer dans l’activité du sujet une influence contre laquelle il est sans
défense puisqu’il en ignore la source au moment même où les dissociations sociales les
incitent à renaître.
On ne peut que s’associer à une critique du concept de sens défini comme visée, comme
représentation consciente d’un but, comme intention orientée. Le sens n’est pas un oeil
mental. C’est la limite de toute sociologie compréhensive et même de celle, si
remarquable, de M. Weber [25]. Mais il ne s’ensuit nullement qu’il faille se passer d’un tel
concept. Si on le conçoit comme une manière d’apprivoiser les rapports toujours
singuliers par lesquels chacun relie entre elles, même sans intention de le faire, les
diverses activités dissonantes où il est introduit, on peut le comprendre ainsi : l’évaluation
énigmatique qui permet ou ne permet pas à un sujet de réguler ses activités dans un
domaine de vie par la signification qu’il leur accorde dans d’autres domaines de sa
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%