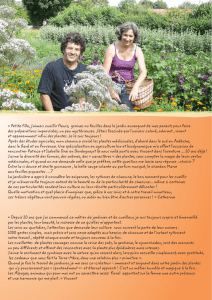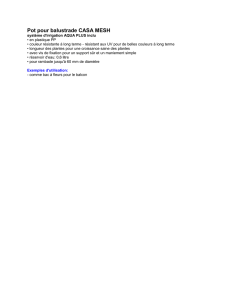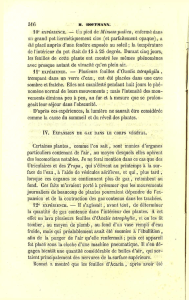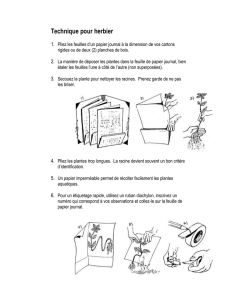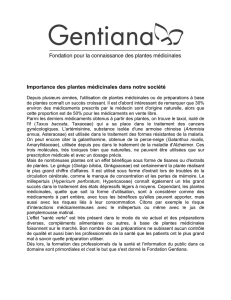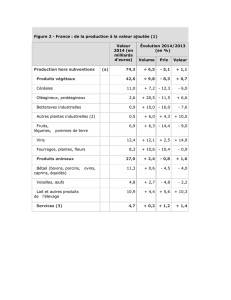Feuilles à gogo, feuilles à bobo - Jardin botanique de l`Université de

DOSSIER PEDAGOGIQUE
Feuilles à gogo,
feuilles à bobo
>>5ème & 4ème

2
Présentation de l’atelier
Feuilles qui soignent ou feuilles qui blessent, les plantes ne sont pas sans effet et les
hommes s’en servent depuis toujours. Mais connaissons-
nous vraiment tous leurs
secrets ? Nous avons tous fait l’expérience de l’ortie urticante mais savons-
nous que sa
feuille est dépurative ? Qu’en est-il de la reine des prés (Filipendula ulmaria) ?
Avec cet atelier, le Jardin botanique propose de faire un tour d’horizon de certaines
plantes ayant des effets positifs ou néfastes
sur l’organisme et de les mettre en relation
avec un organe. Les notions de médicament et de dose seront également abordées.
Cet atelier peut servir de préalable à un travail sur les drogues et les substances
addictives néfastes.
Déroulement
Accueil de la classe par l’animateur scolaire et introduction à l’activité.
La classe est divisée en équipes de 3 élèves. Chaque groupe reçoit
une trousse de secours
avec un carnet de santé à compléter.
Les équipes complètent leur carnet en autonomie puis de retour en salle, synthétisent leur
travail.
Synthèse globale et discussion autour du thème « plante-médicament
», avec une
ouverture sur la notion de drogue.
Liste du matériel à prévoir
stylos, crayons de papier
un appareil photo
quelques feuilles de papier par élève

3
connaître être capable de attitudes développées
pilier 1 :
la maîtrise
de la langue française
un vocabulaire juste et
précis pour décrire les
plantes
lire à haute voix de façon expressive
comprendre un énoncé, une consigne
manifester sa compréhension de textes
variés (descriptions)
répondre à une question par une
phrase simple
rédiger un texte bref en respectant des
consignes imposées
prendre la parole en public
rendre compte d'un travail individuel ou
collectif : échange en groupe, exposés
volonté de justesse dans
l'expression écrite et orale, goût
pour l'enrichissement du
vocabulaire
intérêt pour la lecture
(description des plantes et de
leurs effets)
ouverture à la communication,
au dialogue, au débat
pilier 3 :
les principaux éléments de
mathématiques et la culture
scientifique et technologique
un vocabulaire juste et
précis pour décrire le
monde végétal et le corps
humain
savoir observer
mobiliser ses connaissances en
situation, par exemple comprendre le
fonctionnement de son propre corps et
l’incidence de l’assimilation de certains
éléments par notre corps
sens de l'observation
curiosité pour la découverte des
plantes et de leurs effets,
l'imagination raisonnée,
l'ouverture d'esprit
intérêt pour les progrès
scientifiques et techniques
responsabilité face à
l’environnement, au monde
vivant, à la santé
pilier 7 :
l’autonomie et l’initiative
s’appuyer sur des méthodes de travail
(organiser son temps, prendre des
notes, consulter spontanément un
dictionnaire…)
être capable de raisonner avec
logique et rigueur
savoir respecter des consignes
travailler en groupe
motivation
conscience de la nécessité de
s'impliquer, de rechercher des
occasions d'apprendre
Cet atelier s’inscrit dans le socle commun

4
Comprendre l’atelier
« Depuis l'aube des temps, les hommes se soignent avec les plantes. Mais, de la
cueillette au laboratoire, les méthodes ont profondément évolué. Déterminer le
principe actif, l'isoler, le sy
nthétiser : les médicaments sont aujourd'hui le fruit d'une
recherche longue et coûteuse.
Les vertus thérapeutiques des plantes sont connues depuis la préhistoire. Les
hommes apprirent souvent à leurs dépens à distinguer les végétaux toxiques des
bénéfique
s. Puis ces plantes médicinales, appelées simples, furent séchées et
préparées en infusion. Même dans la pharmacopée classique, les plantes restent
au cœur des médicaments. Ou, du moins, leurs principes actifs, ces molécules
aptes à corriger déséquilibres
ou dysfonctionnements dans l'organisme. Près de 50
% des produits thérapeutiques commercialisés ont une origine naturelle. Les
plantes n'ont d'ailleurs pas fini de nous étonner : sur les 250 000 à 300 000
espèces recensées, on suppose qu'environ 35 000 pos
sèdent des propriétés
médicinales. Or, jusqu'à présent, seulement 5 000 ont été étudiées ! »
Extrait de « Semences la lettre », Edition GNIS, avril 2003
Des mots pour nommer
On a donc appris, depuis le XXe siècle, à isoler ces principes actifs, à les extraire et
à les transformer.
La recherche de traitement des maladies débute chez les primates comme le
chimpanzé qui s’alimente avec une plante aux principes amers du genre Vernonia
(Asteraceae) pour se dé
barrasser des vers intestinaux qui gonflent son estomac.
Cette plante ne fait pas partie de son régime alimentaire lorsqu’il n’est pas malade.
Depuis, l’homme, par un apprentissage fait sans doute de beaucoup d’échecs et de
quelques réussites, a expérimenté sur lui-
même des remèdes tirés du monde
végétal et parfois du monde animal. Certains de ces remèdes sont devenus des
classiques de la pharmacopée moderne. Nous citerons le principal remède contre
la douleur, la morphine extraite du pavot (Papaver somniferum
, Papaveraceae) et
celui contre le paludisme, la quinine extraite des quinquinas (Cinchona spp,
Rubiaceae). Ces succès ont autorisé des recherches au XXe
siècle sur les
substances naturelles qui ont abouti à partir de plantes médicinales ou vénéneuses
à l’isolement de deux grandes classes d’anticancéreux, les alcaloïdes bi-
indoliques
comme la vinblastine isolée de la Pervenche de Madagascar (Catharanthus roseus
,
Apocynaceae) et le taxol isolé des ifs (Taxus spp
, Taxaceae) ou une nouvelle
classe d’antipaludiques, les dérivés de l’artémisinine.
Extrait du site de l’Institut de Recherche pour le Développement : www.mpl.ird.fr

5
Prolongements possibles en classe
Une campagne anti-drogue
Les élèves
pourront réaliser des spots, des articles, un reportage photo de lutte
contre une ou plusieurs drogues de leur choix.
fiches techniques des drogues connues
Les élèves pourront réaliser des comptes-rendus qui présenteraient :
o les plantes citées pendant l’atelier,
o leurs lieux de culture,
o les effets sur le système nerveux, le corps et la dépendance.
Bibliographie & Webographie
COUPLAN & STYNER, Guide des plantes sauvages comestibles et toxiques, Editions Delachaux
& Niestlé, Paris 1994.
BOTTICELLI & CAGNOLA, Les plantes médicinales, la nature est un bon médecin,
Edition
Gründ, Espagne, 2002.
BRUNETON, Pharmacognosie, Phytochimie, Plantes Médicinales
, Editions Lavoisier, Paris
1993.
SEVENET, Plantes, Molécules et Médicaments, Editions Nathan, CNRS, Paris 1994.
Des sources du savoir aux médicaments du futur, éditions IRD, SFE, Paris 2002.
http://www.mpl.ird.fr/suds-en-ligne/fr/plantes/index.htm
http://www.gnis.fr/index/action/page/id/226/title/Plantes_et_medicaments
Conception & réalisation : Laura Asther
Service d’action pédagogique - Jardin botanique de l’Université de Strasbourg
Juillet 2011
Cet atelier a été conçu en collaboration avec la Délégation Académique à l’Action Culturelle.
Chargée de mission : Barbara Gless, barbara.gless@ac-strasbourg.fr
1
/
5
100%