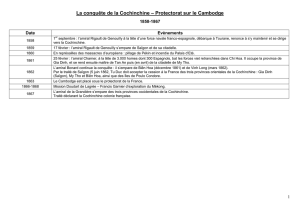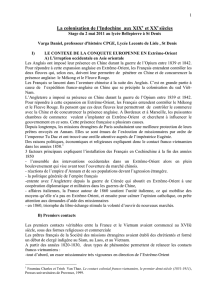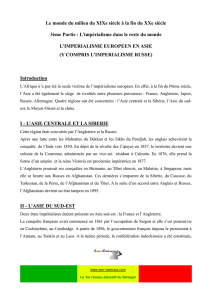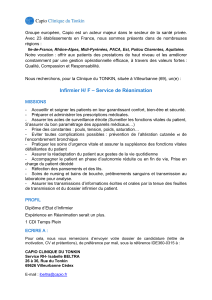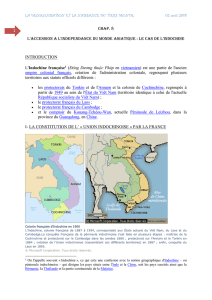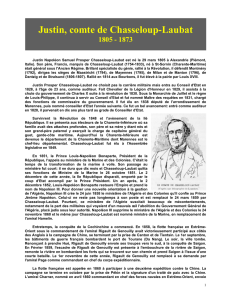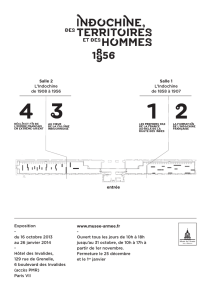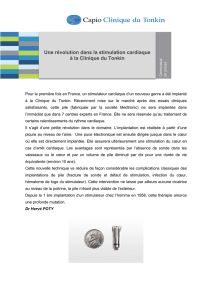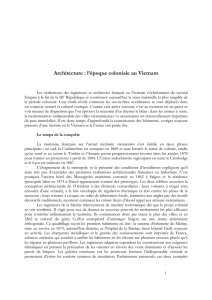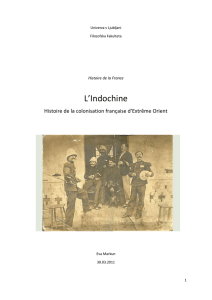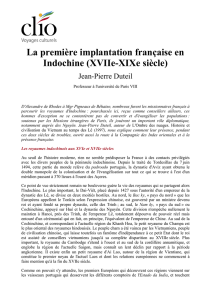survol de l`histoire de la pénétration française en indochine

© FNAOM—ACTDM / CNT TDM
1
SURVOL DE L’HISTOIRE DE
LA PÉNÉTRATION FRANÇAISE EN INDOCHINE
(1625 - 1939)
Au moment où nous voyons, avec une douloureuse inquiétude, se poser non
plus seulement la question du maintien de l'Indochine dans une Union Française
d'avenir incertain maïs même celle de notre simple présence dans les territoires
du Vïêt-Nam, il ne paraît pas sans intérêt de rappeler, sous la forme laconique
d'éphémérides, les différentes étapes de l'établissement de l'influence française
dans ces terres lointaines, auxquelles, quoi qu'il advienne, nous demeurerons at-
tachés par d'impérissables souvenirs.
C'est aux anciens d'Indochine, ceux d'avant 45 comme ceux d'après — car
j'unis les uns et les autres dans une identique et fraternelle estime — que je dédie
ce court travail. Puissent-ils y trouver la justification des efforts et des sacrifices
qu'ils ont si généreusement consentis pour tenter, trop souvent sans en avoir les
moyens et dans l'indifférence et l'incompréhension de la Métropole, d'assurer la
pérennité de l'œuvre sacrée de trois générations consécutives, sans compter les
précurseurs.
Général NYO.
1625-1645
— Sous Louis XIII, le Père Jésuite
Alexandre de Rhodes effectue plusieurs séjours en
Cochinchine, Annam et Tonkin. Il en dresse une pre-
mière carte et en écrit l'histoire. Il est l'introduc
teur de
la pensée française en Indochine.
1658
— Le Pape, à l'instigation de Louis XIV et
de Mazarin, nomme en Extrême-Orient des vicaires
apostoliques français pour évangéliser les Extrêmes-
Orientaux : Monseigneur Poilu pour le Ton
kin et le
Laos — Monseigneur Lamothe-Lambert pour la Cochin-
chine et le Japon.
Avant de partir. Monseigneur Fallu crée un éta-
blissement pour la formation des missionnaires.
Les missionnaires vont désormais implanter
là-bas une tradition française et établir un premier
lien entre Extrême-Orient et Occident.
1667
— II faut se rappeler, pour situer l'his-
toire de la pénétration de notre influence en Ex-
trême-Orient dans son cadre d'ensemble, que la
Compagnie Française des Indes créait à partir de
1667 ses premiers comptoirs aux Indes, auxquels
Louis XIV portait un intérêt particulier, que, sous
Louis XV, Dupleix, après avoir été de 1721 à 1741
"Premier Conseiller de la Compagnie et Commis-
saire Général des Troupes des Indes", puis Direc-
teur Général de la Compagnie, fut de 1741 à 1754
"Gouverneur Général des Indes" que c'est enfin le
16 janvier 1761 que la capitulation de Lally-Tollendal
à Pondichéry se traduit par la perte des Indes.
Ni le Gouvernement de Louis XV, ni l'opinion
publique n'avaient voulu consentir les sacrifices né-
cessaires pour sauver l'œuvre de Dupleix, mais ils
rendirent, seul, responsable de la catastrophe Lally,
objet d'un procès inique qui le conduisit à l'échafaud
en mai 1766.
1685
— Louis XIV envoie un chargé de mis-
sion à la cour de Hué en vue d'obtenir l'autorisation
officielle pour les missionnaires de prêcher le catholi-
cisme et d'établir des relations entre France et An-
nam.
L'Indochine sous la Royauté,
la Révolution et le Premier Empire
Mgr. Pigneau de Behaine

© FNAOM—ACTDM / CNT TDM
2
1686
— Une Ambassade siamoise vient à Ver-
sailles et défraiera longtemps la chronique de la cour.
1748
— Sous Louis XV la compagnie de Law
envoie des missions commerciales en Cochinchine
mais il ne s'ensuit aucune relation durable.
1749
— L'intendant Pierre Poivre, chargé
par Dupleix d'étudier l'organisation des comptoirs
en Annam, débarque à Fai-Fo au sud de Tourane
et obtient de l'Empereur d'Annam la permission de
s'y établir et d'y faire commerce.
La Métropole ne donne aucune suite à cet ac-
cord.
Il visite la Cochinchine qu'il étudie sous le rap-
port des possibilités d'échange et réunit sur ce sujet
une première documentation.
OCTOBRE 1765
— Le missionnaire Pigneau
de Behaine, futur évêque d'Adran, est affecté à la
mission d'Hatien pour évangéliser les indigènes du
Bas-Cambodge. Il fonde à Hondat un séminaire indi-
gène.
1767
— II devient coadjuteur du vicaire
apostolique de Cochinchine.
1770
— A vingt-huit ans, il est nommé évê-
que du diocèse de Cochinchine avec le titre
d'évêque d'Adran (il aurait administré jusqu'à
cent mille chrétiens).
1775
— L'insurrection des Tay-Son ayant,
de 1770 à 1776, chassé du Tonkin la dynastie
des Trinh (les Seigneurs du Nord) et de l'Annam
la dynastie des Nguyen (Seigneurs du Sud), et
massacré le roi Due Thuong, son neveu et héri-
tier, Nguyen Anh (futur Gia-Long) se réfugie à
Saigon.
En vue de rétablir la paix et d'asseoir l'in-
fluence de la France dans ce pays, l'évêque
d'Adran le recueille.
Il se fixe pour but de l'aider, avec l'appui de la
France, à reconquérir son empire.
1782
— Avec une troupe recrutée en partie
parmi les chrétiens, grâce à l'aide de l'évêque,
Nguyen Anh attaque les Tay-Son à Saigon. Il
échoue mais organise la guérilla autour de la
ville.
Chassé de Cochinchine et du Cambodge, il
se réfugie à Poulo-Condor. L'évêque lui conseille
de faire appel à l'aide de la France et se rend à
Versailles pour appuyer sa requête.
28 NOVEMBRE 1787
— Un traité d'alliance
est signé entre le "Roi de France et de Navarre"
et Nguyen Anh "Roi de Cochinchine". La France
organisera et équipera l'armée annamite de
Nguyen Anh et lui fournira un encadrement de
dix-huit cents hommes à réunir aux Indes. Elle
obtient en échange la cession de Poulo-Condor,
la copropriété du port de Tourane, le monopole du
commerce sur tous les territoires à reconquérir
par Nguyen Anh et une alliance militaire.
JUIN 1789
— Les clauses françaises ne
sont pas respectées. L'évêque d'Adran se fait
homme de guerre.
Avec quelques officiers et volontaires fran-
çais venus de "l'Ile de France" (Ile Maurice) sur
"La Méduse", il prend en mains l'organisation ces
forces de Nguyen Anh. Il concentre, au Siam,
troupes indigènes et volontaires français puis dé-
barque à Cap Saint-Iacques où il a donné rendez-
vous à Nguyen Anh. Un officier français, Dayot,
qui a pris le commandement de la flotte cochin-
chinoise, armée par des annamites, détruit la
flotte des Tay-Son.
1791-1801
— En dix ans avec l'appui et
les conseils de l'évêque d'Adran et de la mission
militaire française Nguyen Anh reconquiert Co-
chinchine, Annam et Tonkin.
Victor Olivier construit la citadelle de Sai-
gon, puis celle d'Hanoi. — J.B. Chaigneau est
nommé "Général de l'Armée du Centre".
En 1799, Nguyen Anh rentre à Hué dans le Pa-
lais de ses ancêtres. Il est proclamé empereur sous le
nom de Gia-Long et se fera reconnaître par la Chine
en 1804.
OCTOBRE 1799
— Mort de Monseigneur
Pigneau de Behaine. Il a jeté les fondements de
notre future souveraineté en Indochine.
1820
— Mort de Gia-Long.
Ses successeurs, à commencer par Ming-Mang
(1820-1841), témoignent une hostilité marquée aux
étrangers, persécutent les chrétiens, font mettre à
mort plusieurs missionnaires.
JANVIER 1833
— Un édit de la cour de Hué
prescrit une persécution générale des missionnaires.
Ils sont chassés ou suppliciés. Seul, le mandarin des
provinces du Sud Le Van Duyet, ancien compagnon
de Gia Long, les protège jusqu'à sa mort.
1848 — 1851 — 1855 — Les édits
nouveaux dé-
crètent la mort des prêtres européens et indigènes.
Plusieurs missionnaires français et espagnols et de
nombreux prêtres annamites sont exécutés.
1856
— Napoléon III envoie à Tourane le
"Catinat" afin d'obtenir réparation
pour le meurtre des missionnaires. Le Commandant
du Catinat fait occuper les forts mais ne peut obtenir
satisfaction.
1857 —.Le Consul de France à Shangaï — de Mon-
tigny — vient à Hué. Il demande l'installation d'un
Consul en cette capitale, la liberté religieuse et des
relations commerciales. Il se voit opposer un refus
formel de l'empereur Tu Duc.
En vingt-cinq ans — 1833-1858 — sept évê-
ques et quinze prêtres français et espagnols sont as-
sassinés.
C'est une croisade religieuse qui, pour une
large part sous l'influence de l'Impératrice Eugénie,
va être à l'origine de la conquête de la Cochinchine.
1858
— Tu Duc fait assassiner l'évêque ca-
tholique M. Diaz de nationalité espagnole.
SEPTEMBRE 1858
— Napoléon III décide
d'intervenir. L'amiral Rigault de Genouilly, à la tête
d'une escadre franco-espagnole et de trois mille
hommes de troupe dont huit cents chasseurs ta-
gals envoyés par le Gouverneur des Philippines,
détruit les forts de Tourane et s'empare de la ville.
Mais il n'a pas assez d'effectifs pour marcher sur
Hué, les troupes étant décimées par le choléra. Il
décide d'agir en Cochinchine d'où provient le riz
indispensable au ravitaillement de l'Annam.
Restauration, Deuxième République,
Second Empire

© FNAOM—ACTDM / CNT TDM
3
FEVRIER 1859
— L'Amiral fait occuper puis
détruire la citadelle de Saïgon (commandant Jaure-
guiberry) incendie les approvisionnements en riz
destinés à l'Annam et met des garnisons dans les
forts du sud de la ville.
NOVEMBRE 1859
— L'amiral Page
(successeur de Rigault de Genouilly) demande à
l'Empereur d'Annam, au nom de Napoléon III, la
liberté des cultes, l'installation de trois consuls
français dans des ports ouverts à notre commerce
et d'un chargé d'affaires à Hué. Tu-Duc oppose un
refus global.
MARS 1860
— Page rejoint avec le gros de ses
forces l'amiral Charner pour
participer à la Guerre
de Chine. Il laisse à Saïgon une garnison de sept
cents Français et cent Espagnols sous les ordres
du capitaine de vaisseau français d'Aries et du
colonel espagnol Palanca.
MARS 1860 - FEVRIER 1861
— La garnison
de Saïgon soutient un siège difficile contre une ar-
mée de douze mille Annamites.
OCTOBRE 1860
— Fin de la campagne de
Chine. Le traité de Pékin accorde à la France la
protection des missions en Chine et Indochine.
FEVRIER 1861
— Le corps expéditionnaire
de l'amiral Charner (Brigade d'Infanterie de Ma-
rine du colonel puis général de Vassoigne) reve-
nu en Cochinchine détruit ou disperse au prix de
pertes sérieuses l'armée régulière annamite for-
tement retranchée à Chi-Hoa — six kilomètres
de Saigon.
AVRIL 1861
— L'amiral Charner fait, re-
connaître le réseau des rivières qui unissent Mé-
kong et Rivière de Saïgon. Après avoir dégagé
les abords de Saïgon, le général de Vassoigne
(dont la Division d'Infanterie de Marine s'illustrera
à Sedan, en 1870, en détruisant à Bazeilles une
Division bavaroise — épisode de la maison des
dernières cartouches) occupe Mytho. Charner re-
noue en outre avec le Cambodge des relations
interrompues.
OCTOBRE-DECEMBRE 1861
— L'amiral Bo-
nard, pour assurer la sécurité de Saïgon contre des
bandes de rebelles et de pirates, fait occuper par
de Vassoigne tout le paya de la rive gauche du
Donaï ainsi que Bien-Hoa et Baria.
MARS-JUIN 1862
— Une agitation géné-
rale en Cochinchine au cours de laquelle Cholon
est incendiée par les rebelles entraîne une série
d'opérations vers l'ouest et l'occupation de Vinh-
Long.
5 JUIN 1862
— Traité de Hué. Privé du riz
de Cochinchine et menacé d'un soulèvement
chrétien, Tu-Duc signe un traité qui nous cède
les trois provinces de Saïgon, Mytho et Bien-Hoa
ainsi que Poulo-Condor et ouvre à notre com-
merce les ports de Tourane, Balat et Quang-An.
Nous rétrocédons Vinh-Long. Le traité nous ac-
corde, en outre, une sorte de protection sur l'An-
nam au cas où son intégrité serait menacée par
des étrangers ou par des insurrections intérieu-
res. L'amiral Bonard devient le premier Gouver-
neur de Cochinchine.
DECEMBRE 1862
— Tu-Duc soutenant en
sous-main les éléments rebelles à notre tutelle,
une insurrection générale éclate en Cochinchine.
Elle est vigoureusement réprimée.
14 AVRIL 1863
— Tu-Duc ratifie définitive-
ment à Hué le traité du 5 juin 1862 qui nous livre
la moitié de la Cochinchine.
SEPTEMBRE 1863
— Tu-Duc envoie à
Paris une ambassade conduite par Phan Than
Giang pour demander la rétrocession des trois
provinces sachant que le gouvernement impérial
engagé dans la difficile et impopulaire expédition
du Mexique hésite à conserver la Cochinchine.
Giang propose un vague protectorat étendu à
toute la Cochinchine, avec occupation limitée à
Saïgon, Cholon et Cap Saint-Jacques.
Les crédits demandés au budget de 1854 pour la
Cochinchine sont supprimés.
Il faut l'action vigoureuse du Ministre de la Marine
Chasseloup-Laubat, de l'amiral de la Grandière,
gouverneur de Cochinchine et la propagande de
quelques officiers tenaces en séjour en France,
pour sauver notre possession et amener le Gou-
vernement à s'en tenir au traité de 1863.
Par la force des choses et la ténacité de quel-
ques hommes,
la croisade religieuse
va se
transformer en une entreprise coloniale.
Cette entreprise sera d'ailleurs une des
plus âprement discutées de la Troisième Répu-
blique, surtout en Indochine derrière laquelle se
profile l'inquiétante silhouette de la Chine.
FEVRIER 1864
— Francis Garnier pro-
clame : "Que la France ne doit pas se proposer
exclusivement pour but l'expansion de son com-
merce et se contenter du mobile unique de l’ap-
pât du gain. Elle a une plus haute mission, celle
Tombeau de Tu Duc

© FNAOM—ACTDM / CNT TDM
4
l'émancipation, de l'appel à la lumière et à la li-
berté des races et des peuples encore esclaves
de l'ignorance et du despotisme"
A l'origine, pour les pionniers — militaires et ex-
plorateurs — il faut le noter, l'action coloniale va
se révéler en Asie comme en Afrique Noire,
comme un moyen de réaliser, dans un monde ar-
riéré, une soif d'idéal, que celui-ci soit religieux,
humanitaire, national ou scientifique.
1866-1867
— Devant l'hostilité de certains
mandarins qui actionnent des bandes armées
contre nous, des opérations minutieusement
préparées d'accord avec le Gouvernement impé-
rial, nous entraînent à occuper toute la basse
Cochinchine repaire de rebelles et de pirates.
Une expédition parcourt la Plaine des Joncs, l'un
de leurs principaux refuges.
L'amiral de la Grandière pacifie, organise
et annexe les trois provinces de l'Ouest Vinh-
Long, Chaudoc et Hatien.
En huit ans, la Cochinchine a été, en totali-
té, placée sous notre souveraineté.
RAPPELONS que l'Empire Khmer d'origine et
civilisation hindoues, constitué au VI
e
siècle s'éten-
dait à toute la Cochinchine, au Cambodge actuel, à
une partie du Siam et du Laos.
La décadence commença au XV
e
siècle. Dès
cette époque, les Annamites et les Thaïs (d'origine
thibétaine), les uns progressant par les côtes, les au-
tres par les vallées de la Meman et du Mékong, enga-
gent contre les Khmers un long conflit qui, à notre ar-
rivée, était sur le point de se terminer par la dispari-
tion du vieil Etat. L'Annam avait, à cette époque, oc-
cupé toute la Cochinchine, le Siam, les provinces occi-
dentales du Cambodge : Siemreap, Sisophon, Bat-
tambang.
1847 — An-Duong, roi du Cambodge, accepte
de payer tribut à l'Annam et au Siam agissant en co-
protecteurs.
1859
— A la mort d'An-Duong, ce n'est
qu'après approbation du Siam, érigé en protecteur,
que son fils Norodom lui succède.
AVRIL 1863
— Considérant que la possession
de la Cochinchine nous donne sur le Cambodge les
anciens droits de suzeraineté de l'Annam, l'amiral
de la Grandière décide pour la sécurité de la Co-
chinchine et l'avenir commercial de Saigon (qu'il
considère comme l'exutoire du Cambodge et du
Laos) de faire valoir nos droits. Il envoie le lieute-
nant de vaisseau Doudart de Lagrée en mission
près de Norodom à Pnomh-Penh avec l'aviso "Gia-
Dinh".
11 AOUT 1863
— Doudart de Lagrée, gagne
la confiance et la sympathie de Norodom et réussi: a
négocier un traité de protectorat que l'amiral de la
Grandière vient signer
à
Oudong le 11 août 1863.
Moyennant notre appui contre les empiéte-
ments du Siam, le roi du Cambodge accorde à nos
nationaux la liberté du commerce et de religion et
nous reconnaît le droit d'installer un Résident à la
cour de Pnomh-Penh. Napoléon III hésite à ratifier
de crainte de s'aliéner les Anglais dont il recherche
l'alliance. Il faut encore toute l'insistance et l'autorité
du Ministre de la Marine Chasseloup-Laubat pour le
décider.
3 JUIN 1864
— Devant ces hésitations, le ver-
satile Norodom accorde, à notre insu, un autre traité
de protectorat aux Siamois. Il accepte de n'être plus
qu'un simple vice-roi, de tenir la couronne royale du
roi du Siam et de payer tribut. Il accepte même une
occupation militaire siamoise. Sous la menace de
Doudart de Lagrée qui fait tirer des salves de tous
les canons de son aviso, Norodom effrayé et crai-
gnant de perdre son royaume, revient au Traité
d'Oudong. Le Siam remet la couronne royale qu'il
détient au représentant de la France qui la rend à
Norodom. Celui-ci se couronne lui-même.
25 JUILLET 1867
— Un traité franco-siamois
reconnaît le protectorat de la France sur le Cam-
bodge, mais le Siam conserve les provinces de Bat-
tambang et de Siemreap. Il les rendra au Cam-
bodge en 1907.
JUIN 1866
— Doudart de Lagrée, avec Fran-
cis Garnier comme adjoint, quitte Saïgon à la tête
d'une petite expédition, pour reconnaître le moyen
et le haut Mékong.
SEPTEMBRE 1866
— II atteint Bassac.
MARS 1867
— II entre à Luang-Prabang et y
séjourne six mois.
18 OCTOBRE 1867
— II pénètre en Chine à
Sze-Mao. Le Mékong devenant impraticable en di-
rection du Thibet, il s'oriente vers le Yunnam en
pleine insurrection à cette époque.
NOVEMBRE 1867
— II atteint le cours supé-
rieur du Song-Koi (Fleuve Rouge) dont Francis Gar-
nier reconnaît la navigabilité qui en fait un débouché
du Yunnam.
Relations avec le Cambodge et le
Laos
Guerrier Khmer

© FNAOM—ACTDM / CNT TDM
5
JANVIER 1868
— Doudart pensant retrouver le
Mékong part pour Tong-Tchouen
par des pistes de
montagne.
MARS 1868
— Epuisé par un abcès au
foie, Doudart de Lagrée meurt à deux jours de
marche du Yang-Tsé-Kiaiig.
Francis Garnier ramène l'expédition à Han-
Keou (où il fait la connaissance du négociant
Jean Dupuis qui devait quelques années plus
tard, chercher à utiliser pour son commerce la
voie du Song-Koi et sera à l'origine de la
conquête du Tonkin), puis Shanghai.
29 JUIN 1868
— Francis Garnier arrive à Sai-
gon. Doudart de Lagrée, l'une des plus attachan-
tes figures de notre épopée coloniale, a ouvert la
voie à notre pénétration au Laos.
1871
— La cour de Hué demande au vice-
roi chinois de Canton aide et assistance pour réta-
blir l'ordre troublé auTonkin par les bandes ar-
mées de pirates chinois, les Pavillons Noirs.
Les autorités chinoises s'adressent à Jean
Dupuis — commerçant français d'Hankéou
— pour
doter d'armement et équipement européens les
troupes régulières chinoises devant agir au Ton-
kin.
1872
— Jean Dupuis, homme d'entreprise,
tempérament ardent, amène à Hanoï une flottille
portant le matériel demandé qu'il compte transpor-
ter en Chine par le Fleuve Rouge.
Le maréchal annamite Nguyen-Tri-Phuong lui in-
terdit d'aller plus loin.
Dupuis occupe Hanoï avec ses mercenaires
et fait appel à l'amiral Dupré, Gouverneur de Co-
chinchine pour débloquer sa cargaison.
1873
— L'amiral Dupré envoie à Hanoï le
lieutenant de vaisseau Francis Garnier — qui, on
l'a vu, a connu Dupuis en Chine et, sans doute,
conçu des projets avec lui pour la pénétration du
Tonkin — avec mission de se livrer à une enquête
sur la situation dans le delta.
30 NOVEMBRE 1873
— Devant les tergiver-
sations des mandarins, d'ailleurs détestés du peu-
ple tonkinois et de leurs troupes, car ils entretien-
nent le désordre pour en profiter, Garnier, avec un
aviso, deux canonnières et cent quatre-vingt-cinq
hommes, enlève d'assaut la forteresse de Hanoï,
occupée par sept mille Annamites. Puis il profite
de la situation politique favorable pour s'étendre
dans le delta avec quelques centaines d'hommes
dont une certaine proportion de troupes indigènes
soigneusement encadrées.
L'aspirant d'Hautefeuille occupe Bac-Ninh,
le sous-lieutenant Trentinian, Phu-Ly, l'enseigne
de vaisseau Balny d'Avricourt, Hung-Yen.
Francis Garnier est tué près de Hanoï, le 22
décembre 1873, ainsi que Balny d'Avricourt.
L'amiral Dupré, qui n'a pas les moyens de
pacifier le Tonkin et qui sait que le Ministère de
Broglie est opposé a son occupation militaire, fait
rappeler à Hanoï les forces françaises du Delta.
Son délégué, l'inspecteur des affaires indigènes
Philastre, signe à Hanoï avec les négociateurs de
la cour de Hué une convention stipulant l'éva-
cuation du Delta.
15 MARS 1874
— Le traité de Saigon place sous
notre entière souveraineté les six provinces de
Cochinchine qui nous appartiennent en fait depuis
1867. Il proclame l'entière indépendance de l'Em-
pereur d'Annam vis-à-vis de toute puissance
étrangère (il vise la Chine) et lui promet, sur sa
demande, la protection militaire française. Tu Duc
s'engage à conformer sa politique extérieure à
celle de la France et à ne signer aucun
traité poli-
tique sans nous en donner connaissance.
Liberté de navigation sur le Fleuve Rouge et
dans chacun des ports ouverts au trafic
(Haïphong - Hai-Duong - Hanoï) où nous pourrons
entretenir un consul et une escorte de cent hom-
mes. Liberté religieuse pour missionnaires et
chrétiens.
La France promet de faire don à Tu-Duc de
cinq vapeurs, cent canons, mille fusils et de met-
tre à sa disposition des instructeurs militaires et
des ingénieurs.
Le traité de Philastre contient en germe le
protectorat français sur l'Annam dans la mesure
où le gouvernement français sera résolu à en as-
surer l'exécution.
Mais en raison de certaines de ses clauses,
ce traité soulève de vives protestations aussi bien
en France qu'en Indochine.
Quant à Jean Dupuis, abandonné après le
traité Philastre, il voit ses navires et marchandises
confisqués par les mandarins tonkinois.
FEVRIER 1882
— Le traité de Saigon, très
critiqué, n'est appliqué ni en Annam ni au Tonkin.
La cour d’Annam s’entend avec les chinois pour
L’Indochine sous la III° République
Jules Ferry
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%