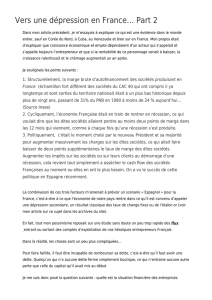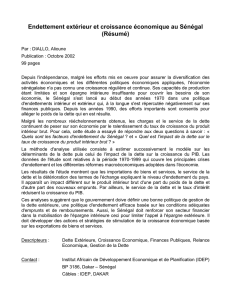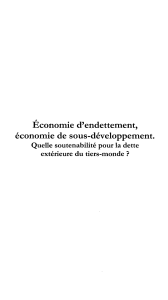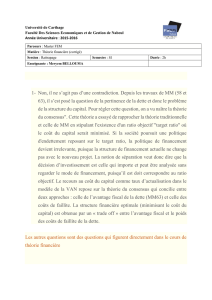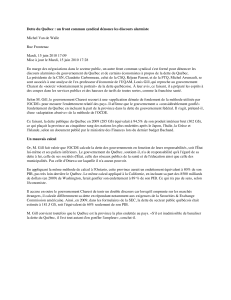Endettement extérieur et efficience productive dans les pays en

Proposition pour la 2ème Conférence Euro-Africaine
en Finance et Economie (CEAFE)
Thème : Economie Internationale
Imed DRINE
IHEC Sousse (Tunisie)
&
Mahmoud Sami NABI *
LEGI - Ecole Polytechnique de Tunisie & IHEC Sousse (Tunisie)
L’endettement extérieur est-il devenu une source d’inefficience économique pour
les pays en développement au cours des dernières décennies? Dans la partie théorique
du papier nous montrons que le surendettement extérieur peut accroître la taille du
secteur informel au dépend d’un secteur formel plus efficient. Par ce canal
l’endettement extérieur diminue l’efficience productive d’une économie. Ensuite, dans
la partie empirique nous utilisons la méthode de la frontière de production
stochastique pour tester l’effet de l’endettement extérieur sur l’efficience productive
d’un échantillon de 28 pays en développement entre 1970 et 2002. Il s’avère que
l’accroissement en niveau de 1% du ratio de la dette extérieure par le PIB réduit
l’efficience productive de 2,5% et que l’augmentation en niveau de 1% de la part de la
dette publique dans l’endettement extérieur augmente l’efficience productive de 1,3%.
Ces résultats sont enfin interprétés sur la base du modèle théorique.
Classification JEL : F34, O17, O40
Mots clés : dette extérieure, efficience productive, secteurs formel et informels
* Auteur chargé de la correspondance. Adresse : LEGI — Ecole Polytechnique de Tunisie
B.P. 743, 2078 - LA MARSA. TUNISIE — Tél. : +216 71 774 611 — Fax : +216 71 748 843
E-mail : [email protected]
Endettement extérieur et efficience productive
dans les pays en développement

1. INTRODUCTION 2
1 Introduction
Au cours des dernières décennies le stock et le service de la dette extérieure des
pays en développement ont augmenté de manière continue.
Fig. 1—Evolution de la dette des pays en développement (source des données : CNUDST)
Considérant un échantillon de 28 pays en développement, nos calculs1montrent
queleratiodeladetteextérieureparlePIBapasséde31,6% aucoursdelapériode
1970 −1974 àenviron60% aucoursdelapériode2000 −2002.En même temps, la
croissance annuelle moyenne a passé de 6,8% à0,22% pour les mêmes périodes. Ces
observations soulèvent la question suivante : L’endettement extérieur est-il devenu
unfreinaudéveloppementpourcespays?
La relation entre l’endettement extérieur et la croissance économique n’est pas
un thème nouveau. Avramovic (1964) établit la théorie du cycle de la dette en dis-
tinguant trois étapes. D’abord, l’épargne intérieure est insuffisante pour satisfaire
les besoins de financement et la dette extérieure permet de financer partiellement les
investissements et de payer les intérêts du stock de la dette. Ensuite, l’épargne in-
térieure augmente et permet de financer une partie importante des investissements,
mais elle est encore insuffisante, d’autant plus que le poids des intérêts et l’amortisse-
ment de la dette se fait sentir. La dette continue donc à croître et ce, jusqu’au seuil
culminant où il cesse d’augmenter. Enfin, la dette amorce son déclin et l’épargne
1Les pays sont présentés dans la partie empirique. Nos calculs se basent sur les statistiques
WDI.

1. INTRODUCTION 3
intérieure est supérieure à l’investissement. Cette théorie est insuffisante vue que
la plus part des pays en développement semblent piégés dans la première étape du
cycle avec une explosion de la dette et des performances économiques médiocres.
Plus récemment, de nouveaux travaux tels que Krugman (1988), Sachs (1989) et
Cohen (1992) ont donné naissance à la théorie de la dette excessive (debt overhang).
Cette théorie établit qu’à partir d’un certain seuil la dette extérieure décourage la
consommation et l’investissement, et par conséquent limite la croissance économique.
Dans une étude empirique portant sur 93 pays en développement sur la période 1969-
1998, Patillo et al. (2002) trouvent un effet non -linéaire de la dette extérieure sur la
croissance. Lorsque le ratio de la dette par le PIB est supérieur à un seuil entre 35%
et 40% l’effet moyen de la dette sur la croissance est négatif alors qu’il est positif
pour un niveau inférieur. Dans un deuxième papier Patillo et al. (2004) ils ana-
lysent empiriquement les canaux à travers lesquels l’endettement extérieur affecte
la croissance économique. Leur étude empirique porte sur un échantillon de 61 pays
en développement entre 1969 et 1998. Ils trouvent que l’impact négatif de la dette
sur la croissance est dû aux effets négatifs sur l’accumulation du capital physique
(1/3 de contribution en moyenne) et aux effetsnégatifssurlaproductivitéglobale
des facteurs (2/3 de contribution en moyenne). L’explication donnée au premier ef-
fet est la suivante : lorsque la dette extérieure devient excessive, les investisseurs
qui anticipent une augmentation progressive des taxes pour le remboursement de la
dette diminuent leurs investissements ce qui ralentie la dynamique d’accumulation
du capital. L’explication donnée au deuxième effet est liée à la baisse de la pro-
ductivité globale des facteurs : le gouvernement peut décider de ne pas réaliser des
réformes économiques difficiles et coûteuses jugeant que les bénéficesfutursenterme
de production nationale plus élevée vont servir les créanciers étrangers. Cette fai-
blesse de l’environnement économique affecte l’efficacité de l’allocation des capitaux
et la qualité des investissements ce qui ralentie la productivité globale.
Dans la partie théorique de ce papier on propose un modèle théorique fournissant
une explication originale aux deux effets identifiés par Patillo et al (2004). Ceci est
fait en introduisant un aspect important des pays en développement qui n’a pas
encore été pris en compte dans la littérature portant sur l’endettement extérieur :
il s’agit du secteur informel de l’économie. Chickering et Salahdine (1991) affirment
que le secteur informel emploie entre 35% et 65% de la population active et produit
entre 20% et 40% du PIB dans les pays en développement. Selon les estimations de
Friedman et al. (2000) la taille du secteur informel dans l’économie est d’environ 68%
en Égypte, 39% en Malaisie, 76% au Nigeria, 71% en Thaïlande, 45% en Tunisie,
etc.
Dans notre modèle un surendettement extérieur peut inciter le gouvernement à
augmenter la taxe sur les bénéfices ce qui augmente la taille du secteur informel et
réduit la taille du secteur formel qui est le plus efficient. Par ce canal l’endettement

2. MODÈLE THÉORIQUE 4
extérieur peut diminuer l’efficience productive de l’économie. C’est ensuite dans la
partie empirique du papier que l’on emploie pour (la première fois à notre connais-
sance) la méthode de la frontière de production stochastique pour tester l’effet de
l’endettement extérieur sur l’efficience productive d’un échantillon de 28 pays en
développement (dont 8 pays africains) entre 1970 et 2002.
2Modèlethéorique
2.1 L’environnement économique
L’horizon de l’économie est infini et le temps est divisé en périodes discrètes
indexées par t=0,1,2, ...La date tcorrespond au début de la période t+1 et à
la findelapériodet. L’économie est dotée d’un secteur de formation du capital
humain et de deux secteurs de production ayant des technologies différentes. Le
premier fabrique un bien de consommation (bien final) à l’aide du capital physique,
du capital humain et du travail. Le deuxième fabrique un bien d’investissement (ou
capital) à l’aide du bien de consommation uniquement.
Le modèle est à générations imbriquées. Chaque génération est composée d’un
continuum d’agents uniformément répartis sur un intervalle [0,1] et vivant trois pé-
riodes. Un agent se forme lorsqu’il est jeune, travaille dans le secteur final lorsqu’il est
adulte et obtient un salaire à la fin de sa deuxième période de vie. On suppose qu’il
ne consomme qu’à la fin de la troisième période et qu’il utilise tout son salaire pour
entreprendre un projet d’investissement (produisant le bien d’investissement). Ce
projet peut être "formel" ou "informel". Dans le cas d’un projet formel, l’entrepre-
neur paye l’impôt au gouvernement et peut bénéficier d’un financement extérieur.
Par contre, un entrepreneur "informel" s’évade de l’imposition en supportant un
coût d’évasion et autofinance l’intégralité de son projet.
2.2 Les technologies de production
2.2.1 Le secteur du bien de consommation
Le bien de consommation est un bien échangeable. Il est produit à partir d’une
combinaison de facteurs substituables : le capital physique, le capital humain et le
travail. Elle est caractérisée par une fonction de production de type Cobb-Douglas
et un cycle de production qui dure une période : Yt=At(Kt)α(Ht)δ(Lt)1−α−δoù
Htreprésente le niveau du capital humain dans l’économie (que l’on peut expri-
mer comme le produit du capital humain par tête et de la population active : htLt.
Cette fonction de production exhibe que les rendements des facteurs de production
soient constants mais intègre une externalité Atqui induit des effets d’échelle sur
les rendements des facteurs. Cette externalité traduit un effet technologique dépen-
dant du stock de capital agrégé kt=Kt/Ltet des dépenses publiques par tête

2. MODÈLE THÉORIQUE 5
disponible depuis la période précédente gt−1=Gt−1/Lt−1de la manière suivante :
At=(gt−1)εk1−α
t.Leparamètreεvérifie0<ε≤1et représente le niveau de l’exter-
nalité des dépenses publiques. Exprimé par tête la production du bien échangeable
est donnée par
yt=(gt−1)εkt(ht)δ(1)
Pour la simplification des calculs on suppose que la dépréciation totale du capital
physique au cours d’une période qui est aussi la durée du cycle de production.
La production est entièrement reversée aux salariés (les adultes) et aux produc-
teurs du bien d’investissement (les entrepreneurs). Les prix des facteurs de produc-
tion sont égales à leur productivités marginales en terme de biens de consommation
et sont donnés par
ρt=α(gt−1)ε(ht)δ(2)
wt=(gt−1)εkt(ht)δ
2.2.2 Le secteur du bien d’investissement
Le bien d’investissement est un bien intermédiaire nécessaire à la production du
bien de consommation. Sa production est obtenue grâce à la réalisation de projets
d’investissement qui peuvent être formels ou informels. La technologie de production
est linéaire avec une productivité (a)pour les projets formels. Les projets informels
sont moins productifs. Cela peut se justifier par le coût d’anti-détection supporté
par l’entrepreneur informel en vue d’éviter d’être détecté par les autorités publiques
(Fortin et al. (1997)). On suppose que les entrepreneurs sont hétérogènes par rap-
port au coût d’anti-sélection. Cela se traduit par des productivités différentes. La
productivité du projet informel réalisé par un agent jest θjaavec θjdistribué sur
[0,1] selon la densité f(θ). Dans le cas où le coût d’anti-détection est nul, le projet
informel a la même productivité que le projet formel (θj=1).
2.3 Les agents et les décisions d’investissement
Chaque génération est constituée d’un continuum [0,1] d’agents. Nous suppo-
sons qu’une génération initiale composée de "vieux" agents ainsi qu’une génération
d’"adultes" coexistent, à la période 0, avec les jeunes agents. Les vieux de la généra-
tion initiale détiennent un stock de capital k0àt=0alors que ses adultes détiennent
un stock de capital k1àt=1.
Un agent de la génération t−2(né à la date t−2) se forme durant sa première
période de vie et se trouve à la date t−1doté d’une unité de travail ayant une
qualification ht−1.Le niveau de la qualification de la génération t−2dépend de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%