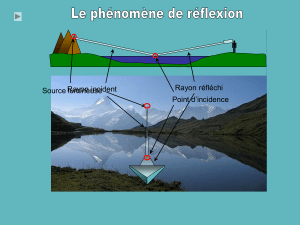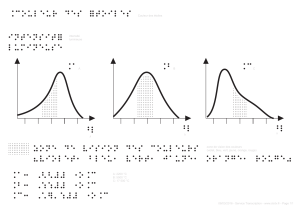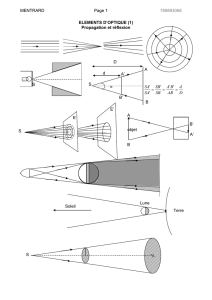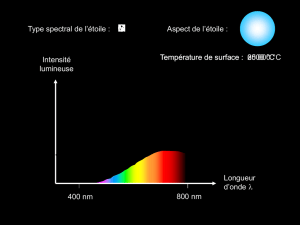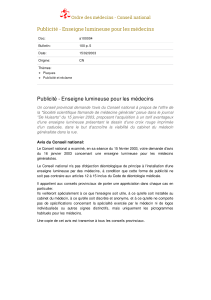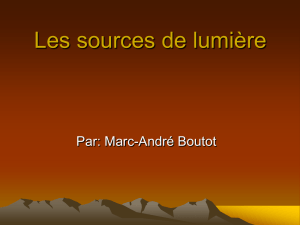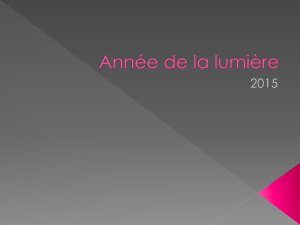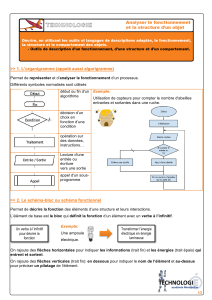LE GALLIC resume de la the se

1
Stéphanie Le Gallic, Les Messages de lumière. La publicité lumineuse à
Paris, Londres et New York depuis la fin du XIXe siècle, Doctorat d’histoire,
Université Paris IV-Sorbonne, (dir. Pr. Pascal Griset), 21 novembre 2014.
Bien que Piccadilly Circus demeure le lieu le plus emblématique de la publicité
lumineuse en Europe, la place n’a fait l’objet d’aucune étude universitaire. Il en est de même
pour Paris. Seul Times Square a suscité quelque attention. Mais, comme c’est généralement
le cas en matière de publicité, l’approche nationale prime sur toute autre perspective. Or, dans
la mesure où l’historiographie américaine domine le sujet, l’impression générale reste celle
d’un support typiquement américain qui se serait exporté en Europe et en Asie. Cette thèse a
permis d’invalider cette croyance commune et de proposer d’autres perspectives qu’une
simple « américanisation » des méthodes publicitaires. Elle analyse donc le processus selon
lequel Times Square est devenu le symbole d’une nouvelle forme de communication urbaine
et décrit comment ce modèle fut repris, adapté, réinterprété, voire rejeté à l’étranger.
Pour résumer cette analyse, nous voudrions faire émerger quelques champs
d’interrogation qui ont surgi et ont pu servir de fil conducteur pour mettre à jour les processus
par lesquels les paysages nocturnes des métropoles occidentales se sont construits depuis la
fin du XIXe siècle. Cette enquête débute dans l’obscurité des rues parisiennes, londoniennes et
new-yorkaises et nous mène jusqu’aux éclats publicitaires des plus grandes métropoles
mondiales, aux allures parfois futuristes.
1- Une innovation à la trajectoire incertaine
Vitrine des grandes marques et des grandes entreprises, la publicité lumineuse se veut,
dès ses origines, avant-gardiste : utilisant l’électricité quand celle-ci n’était pas encore
répandue, imaginant des mécanismes d’animation innovant, intégrant de nouveaux matériaux
comme les tubes luminescents, puis les LED. Encore aujourd’hui, elle symbolise la modernité
urbaine bien qu’il s’agisse d’un support relativement ancien, plongeant ses racines au XIXe
siècle. La publicité lumineuse naquit à New York et fit son apparition à Londres au début des
années 1890. Moins de dix ans plus tard, elle illuminait la place de l’Opéra à Paris. Elle devint
depuis lors un moyen d’expression privilégié pour les annonceurs, rôle qu’elle conserva
jusqu’à nos jours. Pour autant, elle reste le parent pauvre des études publicitaires, sans doute
en raison de son caractère « atypique » puisqu’elle repose sur des dispositifs et des créations

2
ad hoc là où la majeure partie de l’activité publicitaire repose, au contraire, sur une sorte
d’industrialisation et de sérialisation des discours. En cela, elle reste une forme d’artisanat qui
n’a pas empêché ses promoteurs de prospérer et d’étendre leurs activités parfois sur plusieurs
continents, tels le chimiste Georges Claude, l’inventeur des tubes au néon, très actif aux États-
Unis dans les années 1920 et 1930, ou encore Gaétan Deodato, le fondateur de la société
DÉFI-Group, actuel leader mondial de la publicité lumineuse.
Malgré tout, en termes d’innovation, l’étude de la publicité lumineuse montre à quel
point ses cheminements n’ont pas suivi de trajectoire linéaire. La prise en charge du support
fut le fait d’hommes au parcours singulier. Fernand Jacopozzi débuta sa carrière comme
peintre, et ce sont les aléas de sa vie professionnelle qui le conduisirent à produire des
tableaux lumineux qui firent sensation durant l’entre-deux-guerres ; de même, dans ses
mémoires, Gaétan Deodato avoue avoir choisi la voie de la publicité car le bureau qu’on lui
proposait avait plus d’allure que celui offert pour un autre poste... Comme l’illustrent ces
exemples, l’importance de l’humain dans cette histoire particulière est facteur à la fois
d’incertitude dans l’évolution des innovations techniques, et de réussite dans les résultats
obtenus.
Ces hésitations de l’innovation sont renforcées par le poids des différents contextes,
qu’ils soient économiques ou politiques, locaux ou mondiaux, ainsi que par les stratégies,
certes volontaristes, mais parfois indécises des firmes. Ensemble, elles dessinent une histoire
qui n’a rien d’une success story. Bien loin de correspondre à ce qui serait un schéma idéalisé
de l’innovation technologique (invention, diffusion, massification), la publicité lumineuse
illustre le rôle des bifurcations, des hésitations et des remises en cause d’une technologie. Par
exemple, durant les années 1970, l’économie en berne, la concurrence de la télévision et la
montée des préoccupations écologiques semblaient annoncer la fin du support. Son renouveau
des années 1990, tant aux États-Unis, en Asie qu’en Europe, montre qu’il n’en fut rien. Les
transformations successives de la publicité lumineuse témoignent donc bien d’une capacité
d’adaptation des acteurs, mais également d’une fragilité des technologies employées.
2- La co-construction du paysage urbain
M.-E. Chessel avait déjà mené des travaux de recherche sur les acteurs de la publicité
en retraçant la constitution du métier de publicitaire. Dans sa lignée, cette thèse insiste sur le
rôle de ces hommes qui surent capter une technique fondée sur l’électricité et l’éclairage pour
la détourner et lui conférer un nouvel usage. Par la suite, l’institutionnalisation de la publicité
lumineuse se caractérisa par une disparition progressive de ces hommes au profit des

3
entreprises ou même des conglomérats. À cet égard, la structure familiale d’Artkraft Strauss
fait aujourd’hui figure d’exception dans le paysage des sociétés de publicité lumineuse. Ainsi,
non seulement cette thèse enrichit cette catégorie d’acteurs en s’intéressant aux fondateurs et
dirigeants, mais aussi aux employés, aux électriciens ou encore aux souffleurs de verre, mais
elle donne aussi une place aux opposants à la publicité lumineuse et à ses régulateurs. De
plus, en mettant en évidence l’importance des investisseurs immobiliers, l’approche se veut
novatrice et montre que le paysage urbain résulte d’une co-construction complexe faite
d’affrontements, d’alliances, de compromis et de stratégies appelées à évoluer au fil du temps
et en fonction des réactions des autres acteurs.
Or, en terme de paysage urbain, la publicité lumineuse est bien souvent négligée car
perçue comme provisoire : elle n’attire pas le regard des historiens et des urbanistes,
concentrés sur des tendances plus pérennes. En enquêtant sur la construction du paysage
nocturne par la publicité lumineuse, cette thèse entend contribuer à réhabiliter la ville
« ordinaire » par opposition à la ville « monumentale ». Il s’agit-là de mettre à jour la ville
quotidienne, réelle, et de contribuer à éclairer l’histoire sociale des « choses banales » et
parfois même méprisées puisque la publicité lumineuse n’est souvent perçue que comme un
élément de décor superflu, préjudiciable pour la ville et son image. Il est vrai que les
dispositifs une fois démontés ne laissent plus de traces et partir à leur recherche relève parfois
d’un véritable travail d’enquêteur, voire d’archéologue ... Il reste cependant des vestiges de
ces époques révolues, comme le néon éteint, mais toujours visible, de la Compagnie française
du néon au 17, rue des Gobelins dans le treizième arrondissement de Paris.
3- Du local au global
Ensuite, la publicité lumineuse mêle intimement le local et le global.
Incontestablement locale par son implantation dans une ville, un quartier, un bâtiment, son
histoire s’enchâsse également dans un processus menant à la globalisation des marchés. En
effet, plus qu’aucun autre support, la publicité lumineuse est celle des firmes internationales,
soucieuses d’affirmer leur puissance à l’échelle planétaire. Ainsi, le premier « message de
lumière » de Piccadilly Circus représentait la marque française Perrier tandis que la première
publicité lumineuse de Paris figurait la célèbre société américaine Kodak. Aujourd’hui encore,
les marques asiatiques impriment leurs noms sur Times Square, Piccadilly Circus ou le
boulevard périphérique parisien. La publicité lumineuse illustre donc pleinement la
globalisation de l’économie : les marques qu’elle diffuse, les villes et les pays où elle se
répand témoignent de cette contribution active au processus de mondialisation. Il existe une

4
idée très répandue selon laquelle cette dernière créerait un mouvement d’uniformisation. Or, à
travers l’étude de la publicité lumineuse dans les villes occidentales, cette thèse démontre que
loin de créer des paysages urbains uniformes, la publicité lumineuse doit être appréhendée
dans une immense variété des situations en participant à la différenciation des villes. Times
Square n’a aucunement constitué le point de référence pour le développement de la publicité
lumineuse en Europe et, au contraire, le quartier new-yorkais s’est lui-même nourrit de
l’influence de ses consœurs européennes. Ainsi, en proposant d’étudier la publicité lumineuse
dans trois villes mondiales, la thèse met au jour les circulations transatlantiques à travers de
nombreux exemples tels que le projet de la « Maison de la Publicité » d’Oscar Nitzchké dans
les années 1930 qui a permis à l’architecte de se faire connaître aux États-Unis ou encore
l’installation d’un « luminographe » par Jean Carlu à Broadway. Ces exemples, parmi
d’autres, remettent en cause la thèse de l’américanisation, déjà affaiblie par des travaux
antérieurs, notamment ceux de S. Schwartzkopf.
4- Des trajectoires urbaines singulières
Finalement, cette thèse contribue à démontrer l’absence d’un modèle unique de
développement. S’il est vrai qu’aujourd’hui plus que jamais, la publicité lumineuse promeut
la diffusion des marques dans le monde, elle participe dans le même temps à la différenciation
des métropoles, puisque chaque ville adapta la publicité lumineuse à ses propres traditions
urbaines et culturelles. New York offre ainsi l’exemple d’une publicité sanctuarisée au cœur
de la métropole. Son modèle est celui de l’excentricité visuelle, où l’architecture est
quasiment niée au profit de la publicité et des flux électroniques qui la composent. Times
Square incarne le mythe de la ville connectée et multi-écrans. C’est le lieu où la modernité
s’invente et s’exporte, via les conglomérats puissants qui la supportent, tels que
ClearChannel. Au contraire, Paris a choisi une alternative qui a consisté à renoncer
progressivement à ces « messages de lumière » pour valoriser son patrimoine architectural.
Enfin, Londres se situe à certains égards dans une position médiane entre ces deux cas
extrêmes. Visuellement et symboliquement, Piccadilly Circus évoque Times Square : il s’agit
d’un lieu central de rassemblements qui fait partie du patrimoine identitaire de la capitale et
qui comprend de nombreux écrans. Mais dans le même temps, elle s’en démarque
radicalement. Tandis que la ville américaine a créé une enclave dédiée à ce support, Piccadilly
Circus est marquée par une sévère contraction de ses dispositifs : le London Pavillion et le
Criterion ont tous deux cessé depuis longtemps d’accueillir des marques sur leur façade. Par
ailleurs, tandis que les écrans américains offrent du temps de vision aux différents

5
annonceurs, Piccadilly Circus privilégie une certaine pérennité des marques affichées. Il
n’existe donc pas de modèle occidental de publicité lumineuse, mais une pluralité de
situations, à l’image de l’identité singulière de chaque métropole.
Par ailleurs, il serait réducteur d’opposer un modèle américain, central, de type Times
Square à un modèle français, périphérique, de type parisien. Ces deux paradigmes comportent
en effet certaines similitudes. Dans les deux cas, il s’agit d’espaces relativement bondés mais
en mouvement permanent. Le boulevard périphérique supporte ainsi un trafic d’environ
270 000 véhicules par jour, tandis que Times Square compte une des stations de métro les
plus fréquentées de New York où se croisent onze lignes rayonnant vers tous les quartiers
extérieurs à Manhattan. Les comptages effectués par le Business Improvement District (BID)
évaluent ainsi la fréquentation piétonne à environ 1,5 million de passants par jour.
Ensuite, la dimension commerciale domine. Évidente pour Times Square, bordé de
boutiques et de publicités, elle l’est tout autant dans le cas parisien. Si le caractère de « non-
lieu » conféré au boulevard périphérique peut faire oublier un instant cette dimension, un bref
regard sur son passé nous rappelle que dès l’époque des fortifications de Paris, l’enceinte de
Thiers qui cernait la capitale, faisait également office de limite fiscale. L’octroi était perçu
aux portes sur toutes les marchandises, si bien qu’un faubourg marchand s’y était développé.
Or, ce caractère commercial des portes n’a pas fondamentalement changé. Le périphérique a
accru le passage sur les voies radiales en greffant ses sorties sur les portes, et la concentration
commerciale existante s’en est trouvée renforcée tant et si bien que l’implantation des centres
commerciaux, comme celui de la porte de Bagnolet ou de la porte de Bercy, constitue un
phénomène caractéristique de l’importance des portes de Paris. Ces analyses viennent donc
contredire non seulement la thèse de l’uniformisation des villes mais également celle de
modèles qui seraient clairement définis. La singularité des métropoles semble au contraire la
norme.
5- Découpage de la thèse
Le propos est organisé en trois grandes parties. La première, intitulée « de
l’incandescence en publicité : le temps des pionniers » porte sur le premier grand dispositif
technique de la publicité lumineuse, celui de la lampe à incandescence, qui s’imposa de la fin
du XIXe siècle à la fin des années 1920 et qui dessina de nouveaux décors urbains à
destination de l’élite fréquentant les restaurants et les théâtres des quartiers animés.
S’appuyant sur l’électricité, une technologie encore rare et chère, la publicité lumineuse
bénéficia du prestige qui lui était associée et promut surtout des marques de luxe : montres,
 6
6
 7
7
1
/
7
100%