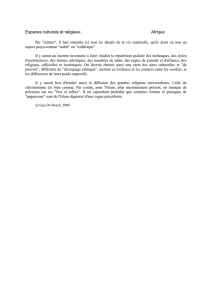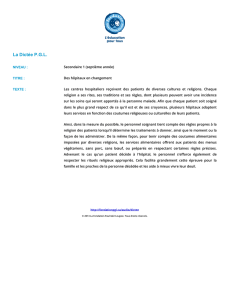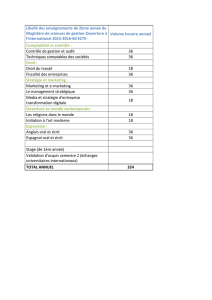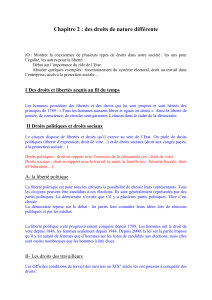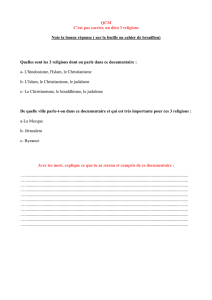Téléchargement patriefailletravail-fintypepad

1
PATRIE FAMILLE TRAVAIL
« Pensées multiples »
Avant-Propos
« Patrie Famille Travail » pourquoi ce titre ? Certainement pas pour réhabiliter Pétain
qui avait cru bon d’en faire sa devise et que mon père a combattu au prix de sa vie* ! Mais
pour rappeler que ces valeurs fondamentales de la société restent des valeurs fondamentales
même après que certains aient cru pouvoir les compromettre au service d’une personne et
d’une politique qui en étaient la négation. L’homme politique qui aurait été en droit d’en faire
sa devise est plutôt de Gaulle qui, lui, les a mises en pratique.
C’était une escroquerie politique et intellectuelle que de vouloir les opposer à « Liberté
Egalité Fraternité » dont, loin de leur être incompatibles, elles sont le complément essentiel.
C’est pourquoi les réflexions politiques qui suivent sont regroupées -un peu artificiellement-
sous ces trois titres.
Il y en a un quatrième, « Dieu », qui peut surprendre dans un livre qui se veut politique
et social, et non philosophique et religieux. Mais on ne peut l’éviter car depuis que l’humanité
existe elle a toujours fait référence à des dieux ou à un Dieu. Philosophiquement et
sociologiquement, il n’y a pas tellement de différence entre le Dieu Râ des Egyptiens, ancêtre
de celui d’Abraham, et l’Etre Suprême de Voltaire, et même les formes diverses de
polythéisme impliquent l’existence d’un monde divin au-dessus du monde humain. Même
l’athéisme moderne a du mal à se reconnaître comme tel, la plupart des athées de nos jours
préférant se présenter comme agnostiques, et la « Philosophie des Lumières » elle-même ne
pouvant nier son origine judéo-chrétienne . Il n’est donc pas possible de mener une réflexion
politique et sociale approfondie sans aborder le problème religieux.
Ces réflexions ne prétendent pas être une nouvelle doctrine politique, philosophique
ou économique (il n’y en a que trop !). Elles essaient de traduire ce qu’un « honnête homme »
de ce temps, parmi beaucoup d’autres, ressent à l’égard de ces doctrines actuellement
régnantes, ou prétendant à régner, dans le monde où il vit. Pas afin de rejeter ou promouvoir
l’une ou l’autre. Mais afin de les relativiser en rappelant qu’aucune doctrine n’a jamais fait le
bonheur de l’humanité, et qu’à toutes les époques ce que l’on appelle faute de mieux le « bon
sens », doit être le guide qui empêche les gouvernants de se laisser égarer par les faiseurs de
doctrines, et de trier le bon grain et l’ivraie dans leurs contenus.
Beaucoup de ce qui est écrit ici a sans doute été dit ou écrit par d’autres mais souvent
dans des ouvrages peu accessibles à des non-spécialistes de la philosophie , de l’économie ou
de la politique. C’est à ces hommes et femmes moyens que sont 99% de nos compatriotes que
ces réflexions s’adressent.
* Paul Petit, fondateur du premier journal clandestin « La France continue » arrêté en 1942 et exécuté en 1944
(cf. Résistance Spirituelle, Gallimard 1947 (épuisé, qques exemplaires chez l’auteur)

2
TABLE DES MATIERES
Avant-Propos 1
I.- PATRIE 3
La gifle 5
Europe des Nations 7
La « Communauté internationale » 9
Droit Romain ou Common Law ? 13
Euratom 15
Le modèle américain 17
Le diable nucléaire 19
Le petit Satan iranien 22
Histoire et morale 24
Morale et politique 26
Gauche et doite 28
Démocratie et partis 31
Egalitarisme et démocratie 33
Parité et V° République 36
La révolution politique nécessaire 37
La révolution informatique 40
Décentralisation 42
Vers la VI° République 45
II- FAMILLE 49
Morale et société 51
Mariage 54
Féminisme 57
Ecoles et Universités 60
Médecine « libérale » 62
Banlieues 65
SOS psychologues 69
Permis de conduire 71
ONG 73
III- TRAVAIL 77
L’or et l’argent 79
Commerce mondial ou assistance 81
Travail et salaire 84
Emploi à vie 86
Richesse et justice sociale 89
Nationalisations 91
La mode des murs 93
Odeurs de pétrole 95
Multinationales et mafias 97
IV- DIEU 101
Dieu ou le Big Bang 103
Dieu ou l’évolution ? 106
Politique et religions 108
La mort de la déesse Raison 111
« Le XXI° siècle sera spirituel… » 112
Laïcité à la française 114
CONCLUSION ? 117

3
I - PATRIE
Le patriotisme fait partie aujourd’hui, en France, des « valeurs ringardes ». Pourquoi ?
Est-ce seulement parce que Pétain a cru pouvoir l’invoquer au service d’une politique de
collaboration avec Hitler ? N’est-ce pas aussi, au-delà des frontières françaises, à cause de la
façon dont les nationalismes allemand et japonais l’ont dévoyé, des millions de morts de la
première guerre mondiale, et de l’anéantissement de Berlin, Dresden, Hambourg, Tokyo,
Hiroshima et Nagasaki ?
Or il faut distinguer le patriotisme du nationalisme. Bien qu’il faille se méfier de tous
les mots en « isme », ce suffixe n’a pas le même sens dans « patriotisme » que dans
« nationalisme », « socialisme », « communisme », « libéralisme », etc… Tous ces derniers
« ismes » désignent des doctrines qui prétendent subordonner toute l’organisation de la
société au dogme principal dont elles se réclament. Le nationalisme de Maurras n’est pas le
patriotisme de de Gaulle.
Le patriotisme n’est pas une doctrine mais un sentiment. C’est le sentiment
d’appartenir à une communauté plus large que la famille, la cité, le métier, etc… mais
cependant suffisamment proche pour que l’on soit prêt à lui sacrifier beaucoup de choses : de
son temps, de son argent, et parfois même sa vie. Ce sentiment très fort se nourrit d’une
histoire et d’une culture partagées, et notamment le plus souvent d’une langue commune qui
est le ciment essentiel d’une nation (avec quelques exceptions notables telles que la Suisse).
Ce sentiment naturel qui ne s’étendait guère au-delà de la cité dans l’Antiquité, s’est
élargi au Moyen-Age, encouragé par les monarchies et principautés qui y voyaient un moyen
de lutter contre leurs forces centrifuges. Il a culminé avec la création des principaux Etats-
Nations actuels au XIX° siècle, pour dégénérer dans les nationalismes totalitaires et
belliqueux du début du XX° siècle.
Est-ce à dire, comme certains le font, qu’il s’agit d’un sentiment dangereux, et qu’il
convient donc d’éradiquer pour ne pas risquer la rechute dans les nationalismes ? Faut-il,
comme certains le proposent, y substituer un « patriotisme européen » ou même une
« citoyenneté mondiale » comme le proposait déjà, il y a 50 ans, Gary Davis ? Mais outre
qu’un sentiment ne se décrète pas, un « nationalisme européen » ne serait-il pas aussi
dangereux pour la paix du monde que ses prédécesseurs nationaux ? Après tout, Hitler ne
voulait-il pas instaurer le « nouvel ordre européen » et Staline l’ « internationale
communiste » ? Les totalitarismes ne sont jamais à court de prétextes, et si on leur enlève
celui de la nation, ils auront vite fait d’en trouver un autre. Il est donc aussi stupide de
condamner les patriotismes nationaux au nom de leurs dérives nationalistes qu’il l’est de
condamner l’Islam au nom de l’islamisme.
La diversité des patriotismes est l’une des grandes richesses de l’humanité. Le
patriotisme allemand n’est pas le même que le français, ni l’anglais, ni le danois, ni le suisse.
Mais tous ces patriotismes, et les cultures qu’ils incarnent, ne cessent d’interagir et de
s’enrichir mutuellement. Le patriotisme américain, qui est d’une nature très différente des
patriotismes européens du fait de l’histoire qu’il incarne, n’est pas, et de loin, le moins ardent,
et le fait de siffler le « star spangled banner » sur un stade de football américain, en admettant
qu’il soit imaginable, susciterait une émeute. « Right or wrong, my country ! »*, ce slogan
* Qu’il ait tort ou raison, c’est mon pays.

4
illustre bien ce patriotisme américain, et montre que, quoi que l’on en dise, ce patriotisme
n’est pas plus à l’abri qu’un autre de la dérive nationaliste.
Et d’ailleurs, en supposant que l’on puisse abolir d’un trait de plume les patries et les
patriotismes, par quoi les remplacerait-on ? Par un retour aux anciens patriotismes
infranationaux, provinces ou cités ? Personne n’y songe sérieusement, tant ce serait une
régression, non seulement politique, mais scientifique et culturelle. Par un « patriotisme
mondial » ? Mais chacun voit bien qu’il ne correspond à aucune réalité : si après 50 ans
d’efforts et d’intégration économique on n’a toujours pas vu naître de « patriotisme
européen » ailleurs que chez quelques militants zélés, comment imaginer le voir apparaître
soudainement au niveau mondial ?
Par rien, répondent beaucoup très sérieusement. On n’a nul besoin de patriotisme,
l’idéologie des droits de l’homme, et l’expansion du commerce libre sont les moyens pour
l’humanité de parvenir à la richesse et à la paix, dans un monde sans frontières. Cette
idéologie nouvelle, qui ne se proclame pas encore comme telle, mais anime déjà nombre
d’initiatives politiques ou non (médecins sans frontières, avocats sans frontières, ONG de
toutes sortes) est éminemment respectable, et porteuse d’espoir à long terme. Mais est-elle
réaliste à court et à moyen terme ? Signifie-t-elle, pour l’immense majorité des habitants de la
planète, quelque chose à quoi ils soient prêts à sacrifier leur temps, leur argent, et leur vie ? Le
fait qu’elle le signifie pour une petite minorité admirable, comme avant elle les communautés
missionnaires, est un bonne chose pour l’humanité. Mais ce cosmopolitisme (qui a toujours
existé à des degrés divers) ne peut, par définition, remplacer le sentiment patriotique en tant
que ciment d’une société. Dans la mesure où il fait appel à une logique de générosité, il
s’apparente davantage à une idéologie philosophique ou religieuse qu’au sentiment social
qu’est le patriotisme.
Or ce sentiment social, et l’invitation au dépassement de l’intérêt individuel immédiat
qu’il permet de susciter sont essentiels au progrès des sociétés. Certes, dans toutes les
sociétés, il existe des personnes prêtes à se dévouer au bien commun, scientifique, social ou
culturel sans souci d’intérêt personnel. Mais ce n’est qu’une infime minorité. Déjà plus
nombreux sont ceux qui sont prêts à le faire « pour la patrie » dans la mesure où ils ont le
sentiment, enraciné dans l’histoire, que leur intérêt personnel est lié à celui de la patrie. Mais,
à tort ou à raison, la plupart d’entre eux n’ont nullement le sentiment, que leur intérêt
personnel soit lié à l’humanité dans son ensemble.
Même si l’on se sent « citoyen du monde », ou même seulement « citoyen européen »
de cœur, la coopération des patriotismes en vue du bien commun européen ou mondial est
préférable, sur le simple plan de l’efficacité et donc du progrès universel, à leur dilution dans
un humanitarisme ou un européanisme bien-pensant mais beaucoup moins mobilisateur. La
taxe d’embarquement au profit du tiers-monde de Chirac est le type même de la fausse bonne
idée. Les citoyens français ne sont pas prêts à accepter des impôts mondiaux s’ajoutant aux
leurs, alors qu’ils sont prêts à accepter que leur Gouvernement consacre, avec l’accord de
leurs députés, des sommes raisonnables pour aider ces pays. Leur patriotisme est
légitimement fier que leur pays soit généreux vis à vis des autres, alors que leur absence de
sentiment d’appartenance à une « patrie » mondiale ou européenne leur fait rejeter l’idée que
ces communautés puissent lever un impôt. Comme disait Pascal, « qui veut faire l’ange fait la
bête ». C’est de l’angélisme de prétendre « décréter » le patriotisme mondial ou européen ou
abolir les patries pour éviter les nationalismes.

5
La gifle
Le non français au référendum européen n’était pas un non à l’Europe, mais une gifle
aux auteurs du projet de constitution, et aux partis « de gouvernement » (comme ils disent)
qui étaient derrière eux. M. Giscard d’Estaing a eu raison de dire, après ce vote et en toute
modestie, qu’il ne serait jamais possible de faire un meilleur projet de constitution que le sien.
C’est exact : il ne sera jamais possible, de faire accepter une « constitution », c’est à dire une
structure fédérale, par des peuples qui ne veulent pas du fédéralisme, autrement que par la
méthode qu’il a adoptée.
Pris entre les intégristes fédéralistes européens, dont il fait partie et qui font la loi à
Bruxelles, qui voulaient une « constitution » afin de trancher définitivement le problème
institutionnel européen en leur faveur, et la majorité des gouvernements et des peuples qui ne
veulent pas d’une Europe fédérale, il a pris le parti de noyer le problème dans un rideau de
brouillard de 700 pages. Il a accumulé dans ces pages tout ce que voulaient et ce que ne
voulaient pas les uns et les autres, sans se soucier des contradictions : il était ainsi possible de
démontrer, en fonction des interlocuteurs, que la constitution était fédérale, ou qu’elle ne
l’était pas, et même comme on a tenté de le faire en France, que la constitution n’était pas une
constitution ! Mais sachant que ces contradictions devraient nécessairement être tranchées par
les institutions, il a pris soin de les composer de manière à être sûr qu’elles trancheraient dans
le sens fédéraliste. La sur-représentation des petits pays, non seulement au Conseil des
Ministres, mais aussi à la Commission , au Parlement, et surtout à la Cour de Justice
(composée d’un membre par Etat et votant à la majorité simple) n’a pas d’autre but. Les voix
additionnées des juges allemand, anglais, espagnol, français, italien et polonais, représentant
les trois quarts de la population européenne, n’auraient pas fait le poids face aux juges
représentant le dernier quart, et c’était cette Cour qui avait le dernier mot sur tout.
Mais s’il y a une chose dont les peuples ont horreur, c’est qu’on les prenne pour des
imbéciles sous prétexte qu’ils ne sont pas des intellectuels. Certes, ils n’ont rien compris au
texte qu’on leur proposait. Mais il ne faut pas oublier que les plus éminents juristes n’y
comprenaient rien non plus. En démocratie les électeurs obéissent davantage à leurs intuitions
qu’à leurs raisonnements. Ils ont senti, plus qu’ils n’ont compris, le piège. Plus que le non à
un texte, ils ont dit le mot de Cambronne à ses auteurs.
En effet, depuis plus d’une génération, la classe politique européenne, droite et gauche
confondues, vit sur la base d’un consensus mou qui lui assure des carrières confortables.
L’élément de base en est l’OTAN : étant admis que les Etats-Unis assurent la sécurité de
l’Europe pour peu qu’elle leur obéisse sur l’essentiel, on se défausse sur eux de la
responsabilité de prendre les décisions de politique étrangère majeures, et surtout de la
nécessité de consacrer des sommes importantes à la Défense. (Si la France en consacre plus
que les autres, c’est qu’elle n’ose pas, vis à vis de son armée, renoncer au niveau auquel de
Gaulle avait réussi à la placer.) Le second est le dogme du libéralisme qui évite d’avoir à
prendre la responsabilité de politiques énergétique ou industrielle coûteuses. Même le courage
de conserver une politique agricole semble maintenant leur manquer. Le troisième,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
1
/
120
100%