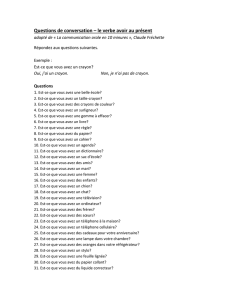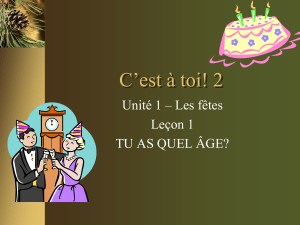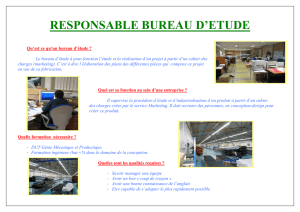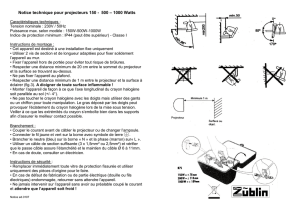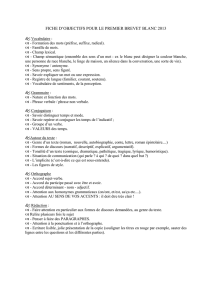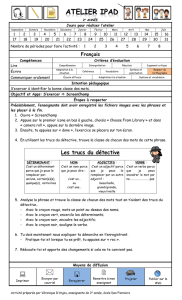Supposons par exemple qu`un parasite dévaste

L'efficacité du marché
Texte 1 : Du café au secteur public
Supposons par exemple qu'un parasite dévaste durablement les plantations de café au Brésil. La
quantité de café disponible pour la consommation va naturellement baisser et il va donc falloir répartir
la pénurie entre les acheteurs d'une manière ou d'une autre. Comment faire? On pourrait imaginer de
confier l'allocation du café à un planificateur qui disposerait des pleins pouvoirs en matière écono-
mique et pourrait donc procéder à toute forme de rationnement qu'il jugerait socialement souhaitable.
Il faut tout d'abord inventorier les ressources en café afin de prendre la mesure exacte des dégâts.
Cela suppose d'inspecter toutes les plantations de café, tâche d'une ampleur considérable et soumise
à la bonne volonté très hypothétique des producteurs de café. Au cas improbable où le gouvernement
réussirait dans cette première étape, il lui faudrait encore décider comment répartir le café disponible
entre les consommateurs. La chose n'est pas simple, plusieurs critères pouvant intervenir. On peut
imaginer par exemple que le gouvernement souhaite réduire l'impact du rationnement du café sur les
foyers les plus pauvres. Il faudrait pour cela connaître les revenus des différents foyers, ce qui n'est
pas encore trop difficile. Les différences de goûts entre consommateurs sont plus problématiques: Si
Pierre est plus amateur de café que Paul, sans doute faut-il lui accorder plus de tickets de rationne-
ment qu'à Pierre; mais comment savoir quels sont leurs goûts? Le gouvernement ne peut pas se con-
tenter d'interroger les consommateurs, puisque chacun d'entre eux aurait tout intérêt à exagérer son
goût pour le café, sachant qu'il serait ainsi moins rationné.
Imaginons néanmoins que le gouvernement dispose d'une information extraordinairement riche sur
les revenus et les goûts des citoyens. Ses difficultés ne feraient, hélas, que commencer. Si le café est
rationné, il est sans doute souhaitable de stimuler la production de substituts possibles comme le thé,
en développant ses plantations. Mais jusqu'où doit-on aller? La réponse dépend probablement de ce
qu'il en coûtera de produire plus de thé, mais aussi, la encore, du goût des différents consommateurs
pour le thé. Et qu'en est-il du sucre que nous utilisons dans notre café? Faut-il réduire sa production,
et de combien ? Et quid des cafetières ? Et les employés qui, à un titre ou à un autre, participent à
l'acheminement du café depuis le producteur jusqu'au consommateur: faut-il les redéployer vers
d'autres activités, et lesquelles? […] la morale en est d'ores et déjà claire : la complexité de l'économie
est telle que le gouvernement ne peut pas prendre à sa charge l'adaptation aux modifications de notre
environnement. Il lui faudrait, nous l'avons vu, disposer d'une connaissance incroyablement détaillée
des situations des uns et des autres, qu'en outre chacun est naturellement porté à lui cacher. Même
s'il parvenait à cette connaissance, il lui faudrait encore des capacités de calcul peu communes pour
traiter cette information et en déduire les décisions à prendre. L'expérience de la planification centrali-
sée dans les pays communistes atteste que la tâche est hors de portée des facultés humaines. En
Union soviétique par exemple, les planificateurs ont dû introduire des prix artificiels dans leurs calculs
pour remplacer ceux dont ils s'étaient bien imprudemment privés. Même ainsi, les tristes perfor-
mances de leur système économique démontrent l'échec de leurs tentatives de remplacement du
marché par le plan.
Qu'en est-il du système de prix dans une économie concurrentielle? Quand les récoltes de café dimi-
nuent, les importateurs de café, qui se font concurrence pour acheter le produit qu'ils vont vendre aux
consommateurs, doivent tout naturellement proposer des prix plus élevés aux producteurs. Le prix du
café augmentera donc. Chaque consommateur décidera ensuite, en fonction de ses goûts et de ses
moyens financiers, de combien il réduira ses achats de café. II pourra aussi choisir de leur substituer
du thé, ce qui poussera le prix de ce dernier à la hausse en raison de la plus forte demande; la pro-
duction du thé devenant plus rentable, des investisseurs seront incités à développer les plantations de
thé. Quant aux cafetières, leur demande fléchissant, leur prix et leur production diminueront.
Chacune de ces modifications du système de prix entraînera avec elle une réallocation des forces
productives des biens dont le prix baisse vers les biens dont le prix augmente; en particulier, la force
de travail se déplacera d'un secteur à l'autre de l'économie en fonction des modifications de la de-
mande de travail induites dans chacun des secteurs. II y a un aspect presque miraculeux dans la fa-
çon dont le système de prix coordonne ainsi les décisions des millions d'agents qui constituent l'éco-
nomie, sans qu'aucun d'eux n'ait à comprendre les mécanismes sous-jacents. Alors qu'un planifica-
teur devrait centraliser toute l'information sur l'économie, le système de prix agrège effectivement
toute cette information sans effort apparent. Il transmet en fait à chaque intervenant toute l'information
dont il a besoin: chaque producteur réagit à une variation des prix en ajustant sa production, et
chaque consommateur y répond en modifiant la composition de ses achats selon ses goûts... Par
ailleurs, le calcul si complexe de l'ensemble des réactions de l'économie à la baisse des récoltes de

café, au lieu d'être effectué par un superordinateur pour le compte du gouvernement, est transformé
en une myriade de petits calculs simples à la charge de chaque agent, un peu comme si l'on avait
remplacé ce superordinateur par un réseau de calculettes de poche dont chacune n'effectue qu'une
petite partie du calcul. De même que chaque calculette peut être programmée pour effectuer une opé-
ration élémentaire et n'attend que l'entrée d'un nombre pour le faire, chaque agent économique n'a
qu'à réagir aux signaux que constituent les prix des différents biens selon ce que lui dicte son intérêt
propre.
[…]Une autre manière de mettre en relief les vertus d'un système de prix est d'examiner le fonction-
nement d'une partie de l'économie qui s'est largement interdit d'y avoir recours. Dans le système de
santé français, la rémunération unitaire des médecins conventionnés (soit le prix de l'acte) est fixée de
manière réglementaire: une consultation de généraliste est tarifée x euros, une consultation de spé-
cialiste y euros, l'extraction d'une dent de sagesse z euros... La rémunération du médecin n'est d'ail-
leurs pas à la charge du patient, qui contribue au financement du système de santé par l'intermédiaire
de cotisations sociales proportionnelles à son salaire. Ni la demande de soins ni l'offre de soins ne
sont donc régies par des prix. De même, le prix des médicaments comme leur taux de rembourse-
ment sont fixés par règlement. On conçoit que, dans ces conditions, aucun des acteurs du système ne
prend véritablement son coût en considération. Cette irresponsabilité généralisée conduit à une multi-
plication des actes médicaux que nous payons tous in fine. […]
L'introduction des trente-cinq heures à l'hôpital a aussi montré les limites du mode de régulation rigide
du système de santé français. Sans que personne ne l'ait apparemment prévu, la réduction du temps
de travail a augmenté considérablement les besoins en infirmières. Sur un marché du travail normal,
les salaires des infirmières auraient nettement progressé, ce qui aurait permis à terme d'attirer de
nouvelles postulantes vers cette profession. En pratique, les salaires sont fixés par les règles de la
fonction publique dans les hôpitaux publics; ce n'est que dans les cliniques privées qu'ils peuvent
s'ajuster, ce qu'ils ont évidemment fait en augmentant. Le résultat évident est que les infirmières dé-
sertent le public pour le privé et que le fonctionnement des hôpitaux publics se dégrade.
La rémunération des enseignants m'offre un dernier exemple. Dans les universités américaines par
exemple, chaque enseignant négocie son salaire avec son employeur. De ce fait, les enseignants qui
disposent d'autres possibilités d'emploi lucratives ont une rémunération élevée. Les juristes, qui peu-
vent être employés comme consultants, ou les économistes, qui peuvent enseigner dans les business
schools, perçoivent des salaires plus élevés que les professeurs de lettres. La France a choisi de
rémunérer tous ses enseignants au même taux, indépendamment de leur spécialité. C'est un choix
éthique parfaitement admissible; mais il a des conséquences sur le recrutement. Ainsi, les étudiants
en mathématiques se sont vu offrir ces dernières années des carrières très bien payées dans la fi-
nance, ce qui a réduit leur intérêt pour la profession d'enseignant. Les difficultés de recrutement des
professeurs de mathématiques, que l'on déplore depuis quinze ans, trouvent sans doute là leur ori-
gine.
B. Salanié, L’économie sans tabou, Ed. Le Pommier
Texte 2 : L’histoire d’un crayon
Une histoire charmante intitulée "Moi, Crayon et ma famille l'Arbre, comme l'a entendu raconter Leo-
nard E. Read", illustre de façon saisissante commet l'échange volontaire permet à des milliers de per-
sonnes de coopérer entre elles. M. Read, par la voix de "Crayon-à-papier - le crayon en bois ordinaire
bien connu de tous les garçons, les filles et les adultes qui savent lire et écrire", commence son his-
toire par l'affirmation fantastique que "pas une seule personne... ne sait comment me faire". Puis il
nous énumère tout ce qui entre dans la fabrication d'un crayon. Tout d'abord, le bois vient d'un arbre,
"un cèdre au fil tout droit qui pousse en Orégon et dans le nord de la Californie". Pour abattre l'arbre et
trainer les grumes jusqu'au chemin de fer, il faut "des scies et des chariots, de la corde et d'autres
outils sans nombre". De nombreuses personnes et des talents infinis participent à leur fabrication :
"l'extraction des minerais, la fabrication de l'acier et son affinage pour le transformer en scies, haches
et en moteurs ; la culture du chanvre et tous les stades de sa transformation en cordes lourdes et
fortes ; la construction des camps de bûcherons, avec leurs lits et leurs réfectoires (...) des milliers de
personnes sans nom avaient participé à chaque tasse de café que buvaient les bûcherons!"
Et M. Read continue en décrivant l'arrivée des grumes à la scierie, le passage de la grume à la
planche, puis le transport des planches de Californie jusqu'à Wilkes-Barn, où a été fabriqué le crayon
qui raconte son histoire. Et il ne s'agit jusque-là que du bois extérieur du crayon. La mine du centre
était au départ du graphite dans une mine de Ceylan, qui, après de nombreux processus complexes,

finit comme mine au centre du crayon.
Le morceau de métal - la virole - près du bout du crayon, est en laiton. "Pensez à toutes les per-
sonnes, dit-il, qui ont extrait des mines ce zinc et ce cuivre ; et à celles qui, à partir de ces produits de
la nature, ont eu les talents de faire cette mince feuille de laiton brillant.
Ce que nous appelons gomme n'est pas du tout de la gomme comme certains le croient. C'est un
produit d'apparence caoutchouteuse obtenu en faisant réagir sur du chlorure de soufre de l'huile de
graines de colza provenant-des Indes néerlandaises (aujourd'hui Indonésie).
"Après tout ceci, dit le crayon, quelqu'un ose-t-il mettre en doute mon affirmation qu'aucune personne
sur cette Terre ne sait comment me faire ?"
Aucune des milliers de personnes impliquées dans la production de ce crayon n'a accompli sa tâche
parce qu'elle avait envie d'un crayon. Certaines d'entre elles n'avaient jamais vu un crayon, et ne sa-
vaient pas à quoi un crayon peut servir. Chacun considérait son travail comme une façon d'obtenir les
biens et les services dont il avait envie, lui - biens et services que nous avions produits, nous, pour
pouvoir obtenir le crayon que nous désirions. Chaque fois que nous allons dans un magasin acheter
un crayon, nous échangeons un petit morceau de nos services pour la quantité infinitésimale de ser-
vices fournie par chacun des milliers d'êtres qui ont contribué à la production du crayon. Il est plus
stupéfiant encore, lorsqu'on y songe, que le crayon ait été produit. Personne, dans aucun service cen-
tral, n'a donné d'ordres à ces milliers de gens. Aucune police militaire n'a fait exécuter les ordres qui
n'ont pas été donnés. Les hommes impliqués dans le crayon vivent dans de nombreux pays, parlent
des langues différentes, pratiquent des religions différentes, se détestent peut-être entre eux - mais
aucune de ces divergences ne les a empêchés de coopérer pour produire un crayon.
Friedman, Milton & Rose (1981), La liberté du choix, Paris, Belfond
1
/
3
100%