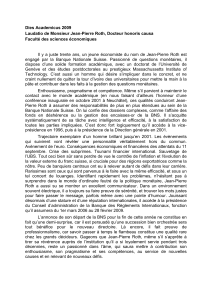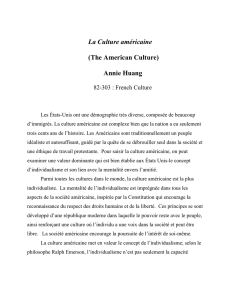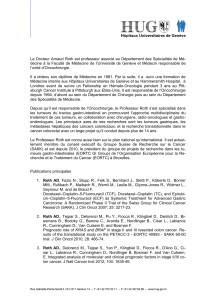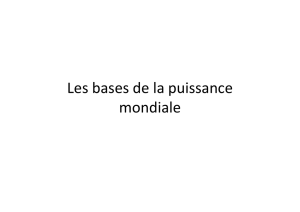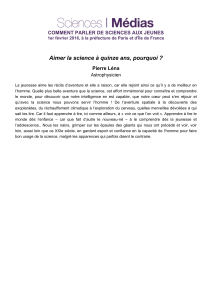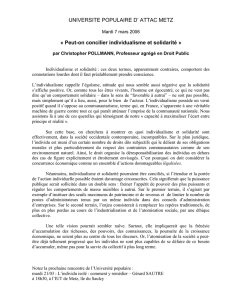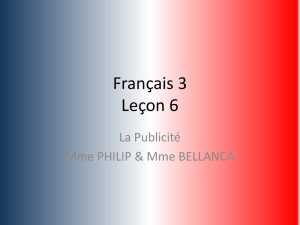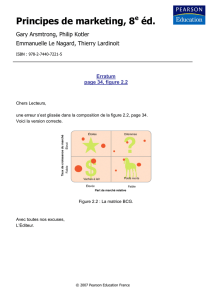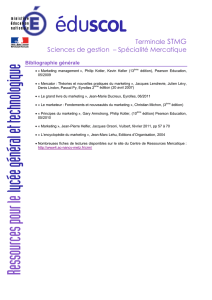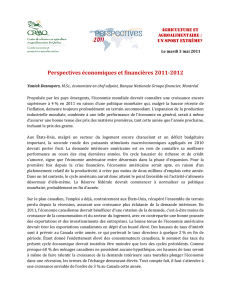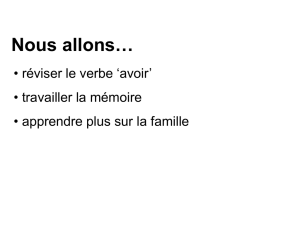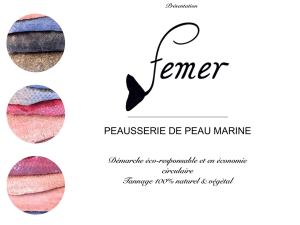Be yourself

Be yourself ! Be classic
L’Amérique de Philip Roth
Les philosophes ont le plus grand besoin de lire des romans s’il est vrai que
la forme romanesque est aujourd’hui la plus riche en legomena, en
échantillons de ces manières communes de penser qui sont la matière
première de la philosophie pratique.
Vincent Descombes, Proust, philosophie du roman, Minuit, 1987, p. 18.
Philip Roth et son double
Philip Roth, né en 1933 à Newark (New Jersey, États-unis), est le romancier de la réalisation
de soi, l’aventure moderne par excellence. Dans un style sarcastique et démystificateur, son
œuvre traite de la construction laborieuse de l’identité personnelle tiraillée entre les
pesanteurs de l’héritage juif familial, les mesquineries de la vie de couple, les appels d’une
sexualité débridée, l’indépendance promise aux jeunes gens par la culture américaine, la
puissance des rumeurs et des réputations.
Philip Roth, s’est inventé des doubles romanesques, héros récurrents de ses fictions : le plus
célèbre est Nathan Zuckerman, qui revient dans dix romans au total, célèbre écrivain juif se
débattant entre les tracasseries de sa vie privée et les exigences de son œuvre. Dans la Trilogie
américaine, Pastorale américaine (1997, prix Pulitzer), J’ai épousé un communiste (1998) et
La Tache (2000), Nathan Zuckerman n’est plus le personnage principal du roman. Il tient le
rôle du témoin-narrateur de ces terribles destins qui dessinent une grande fresque historique et
morale des États-unis depuis la seconde guerre mondiale jusqu’à Bill Clinton.
« Be yourself ! », c’est l’aventure américaine contemporaine, extraordinaire et dérisoire,
qui produit des gens exceptionnels à force de banalité. Quête du Saint Graal pour monsieur
tout-le-monde promise à tous puisque chacun est à lui-même son propre Graal. L’aventure
d’une nation de pionniers dans un monde rétréci, où il n’y a plus de Far West à conquérir,
comme si chacun pouvait espérer désormais trouver en lui-même sa propre frontière à
dépasser. Une poursuite du bonheur qui, pour être gravée au frontispice du Bill of Rights, n’en
comporte pas moins l’irritant vice de forme qui fait du poursuivant et du poursuivi une seule
et même personne.
L’individualisme est la condition de l’homme moderne, qui ne peut compter que sur lui-même
pour s’assurer une place dans l’ordre du monde. Des penseurs comme Tocqueville
1
ou Max
Weber
2
ont porté sur cet individualisme des appréciations contrastées, insistant sur les
formidables espaces de liberté et de créativité qu’ouvrent à l’humanité l’épuisement des
traditions et la contestation des inégalités, ou s’inquiétant au contraire de la fragilité d’un
1
Alexis de Tocqueville (1805-1859), auteur de La Démocratie en Amérique (1835-1840), l’un des pionniers de
la sociologie française.
2
Max Weber (1864-1920), célèbre sociologue allemand fondateur de l’individualisme méthodologique,
spécialiste des religions. Auteur de L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme
1
/
1
100%