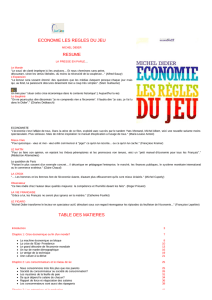Politique Eco

POLITIQUE ECONOMIQUE
COURS N°1
La politique économique s’intéresse à l’intervention de l’économie dans l’Etat : il s’agit donc d’un
sujet très vaste, surtout si l’on veut faire des comparaisons internationales.
La dimension historique est très importante pour la compréhension des politiques économiques :
elle permet de saisir continuités et discontinuités de cette pratique depuis sa naissance.
Le débat théorique, lui, sert à éclairer le sens des décisions politiques.
Musgrave distingue 3 fonctions dans la politique économique :
Fonction de stabilisation conjoncturelle : comme Keynes, Musgrave pense que face à
l’incertitude l’intervention d’un agent extérieur- l’Etat –peut être bénéfique. Il faut
bien rappeler que Keynes raisonnait à court terme.
Rôle sur l’allocation des ressources : la régulation marchande ne suffisant pas à
assurer l’équilibre, il faut un agent extérieur qui propose des biens et services
supplémentaires. En outre, il y a un problème dans l’allocation des facteurs de
production : le marché ne fournit pas les quantités de capital et de travail nécessaires
au bon fonctionnement de l’économie. Ainsi, l’Etat crée des emplois publics, régule
le travail.
Rôle de répartition et de redistribution des revenus : l’Etat intervient par le biais de la
fiscalité.
ATTENTION : répartition et redistribution ne sont pas la même chose !
Répartition : elle est primaire, liée à la répartition productive.
Redistribution : elle concerne les revenus de transfert.
Problème : il est toujours difficile, en politique économique, de séparer politiques conjoncturelle et
structurelle. Il y a interpénétration entre les deux : par exemple, les mesures structurelles ont aussi
un effet à court terme.
INTRODUCTION
Les termes du débat qui existe autour de la question de l’intervention de l’Etat sont ceux de
légitimité et d’efficacité.
Différentes catégories d’acteurs sont concernées : hommes et partis politiques, entreprises
(Medef…), société civile (associations, syndicats, opinion…)…
Il existe deux types de rapports concernant les théories :
-les rapports entre théories politiques elles-mêmes (ex : Marx/Ricardo),
-les rapports entre théorie et pratique (ex : l’industrialisation voulue par Napoléon III a été
inspirée par les théories de St Simon).
Friedman : « l’Etat c’est pas la solution, c’est le problème »…
Keynes n’est pas le seul « créateur » de la politique économique.
Il existe 4 grands types d’analyse sur le rôle de l’Etat :
Celle qui se développe au XIXème siècle, la plus répandue, de l’harmonie et de
l’équilibre assurés par le marché. Smith et Walras sont à la base de cette théorie.
Cependant ces deux auteurs ne sont pas complètement libéraux, vont théoriser un
rôle de l’Etat.
Les « années d’or » de la politique économique, des années 1930 aux années 1970,
voient Keynes, puis la synthèse néoclassique, triompher. La synthèse néoclassique

est l’intégration des thèses keynésiennes dans les grands équilibres. Tout au long de
ces années, l’intervention de l’Etat est très régulière.
Depuis les années 1970, l’intervention de l’Etat est remise en cause, surtout par des
théories venant des USA.
Depuis les années 1990, on assiste à un retour du débat sur le rôle de l’Etat, avec des
théories principalement américaines (croissance endogène) et françaises
(régulationnistes et conventionnistes ). Les activités non marchandes sont valorisées
par ces théories.
I- LE MODELE HYPOTHETIQUE DE CONCURRENCE PURE
A la fin du XVIIIème siècle, certains économistes critiquent le système cloisonné et hiérarchisé mis
en place par l’Ancien Régime : ce dernier freinerait le développement économique. L’affirmation
des libertés économiques est revendiquée : libertés d’entreprise, de commerce, de travail… Il s’agit
là des 3 grandes libertés économiques.
Smith va théoriser la division du travail pour enrichir le souverain et le peuple. De plus, il évoque le
rôle de la « main invisible », qui fait converger intérêts individuels et intérêt général.
Pour Smith, l’économie politique a 2 objets :
-assurer au peuple des moyens de subsistance,
-fournir à la communauté un service public !!
Smith avait donc bien pensé un rôle de l’Etat !
Le souverain, lui, aurait 3 devoirs :
Protéger le peuple et assurer la sécurité. Les troupes de défense doivent émaner de
l’Etat, et non pas du privé ( débat encore actuel, cf Irak…).
Bâtir une justice dotée de juges payés par l’Etat.
Elaborer des travaux publics : il faut des infrastructures permettant le bon
développement du commerce (transports…), la poste, la monnaie. En outre, l’Etat doit
éduquer la jeunesse afin de lutter contre corruption, superstition, ignorance ; ces
comportements empêchent un comportement économique adéquat.
De plus, l’éducation est la solution à l’abrutissement que la division du travail- dit Smith –
provoque.
En somme, Smith n’ignore pas le rôle de l’intervention de l’Etat.
Walras pense que l’équilibre général est assuré par l’interdépendance des trois marchés. Il est
conscient que cette hypothèse est loin de la réalité, mais estime qu’il s’agit d’un idéal vers lequel il
faut tendre. Or pour s’en rapprocher, une certaine intervention publique est nécessaire.
Walras distingue aussi 2 types de monopoles :
- monopole naturel : il concerne tout ce qui est limité dans la nature, comme la terre,
- monopole transitoire : il est provoqué par l’innovation. Mais si la concurrence pure et
parfaite fonctionne bien, l monopole cessera d’exister.
L’Etat, lui, se doit d’intervenir face aux situations de rente (=monopole). Pour ce, il dispose de 2
armes principales :
- la réglementation pour les monopoles transitoires,
- la nationalisation pour les monopoles naturels (sols, chemins de fer…).
Seul l’Etat renonce à s’approprier la rente pour la redistribuer aux consommateurs. Ainsi, son rôle
est d’assurer un fonctionnement plus concurrentiel du marché.
Walras mentionne également l’ « égalité des positions » : il faut combattre l’inégalité entre
hommes, tout le monde doit partir avec les mêmes atouts. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui
l’égalité des chances.

Par ailleurs, l’Etat doit intervenir sur le marché du travail pour assurer la mobilité du travail,
puisque les capitaux sont mobiles. Il doit aussi intervenir sur le temps, la journée de travail ! S’il y a
trop d’inégalités au niveau des salaires, la concurrence est faussée.
Dans le modèle de Walras, la concurrence est donc idéale ; vu qu’elle n’existe pas dans la réalité,
l’Etat doit prendre des mesures.
II- LA « DEFAILLANCE DU MARCHE »
En période de guerre, l’intervention de l’Etat s’intensifie.
La crise de 1848, due au non ajustement entre agriculture et industrie, a mené Louis Blanc à
préconiser- en avance sur son temps –l’intervention de l’Etat sur le marché du travail.
Marx dénonce l’intervention de l’Etat (qui représente le capitalisme) ; il n’a donc pas de théorie de
la politique économique.
Cependant, les thèses marxistes-léninistes vont inspirer le planisme des années 1920-1930.
A la fin du XIXème siècle, c’est la grande dépression (qui n’a touché la France que relativement,
par rapport à d’autres pays) : cette crise va conduire à la promotion du protectionnisme.
F. List ( de l’école historique allemande, parmi les inspirateurs de Bismark) plaide pour la
protection des industries naissantes.
Depuis la fin du XIXème siècle, il y a une intervention rampante. Keynes va la formaliser, la
théoriser, mais ne l’invente pas de toute pièce !!
Dans les années 1950, les néoclassiques reprendront les thèses de Keynes.
A) J. M. KEYNES
Contrairement aux classiques, Keynes pense que le chômage peut être un phénomène involontaire,
lié à une insuffisance de la demande effective. Ni les entrepreneurs, ni les ménages peuvent contrer
ce phénomène. Seul l’Etat, agent extérieur au marché, est en mesure d’inverser ce cercle vicieux.
Ainsi, Keynes plaide une intervention conjoncturelle de l’Etat pour rétablir concurrence et équilibre.
Keynes est favorable à un peu d’inflation, à condition qu’elle demeure maîtrisée, car c’est un
facteur important pour la croissance : les entrepreneurs n’investissent que s’ils pensent que leurs
prix vont augmenter.
L’inégalité entre revenus freine elle aussi la croissance ; en effet, les hauts revenus ont une faible
propension à consommer.
Les analyses de Keynes sont à la base de la construction de la comptabilité nationale (concepts
d’agent, d’agrégats…).
Taux de croissance, taux d’inflation, taux de chômage et équilibre extérieur forment le carré
magique, qui est à la base d’une politique économique cherchant une croissance équilibrée.
Pendant toutes les années 1970, on cherchera toujours à assurer le maintien de ces 4 éléments.
B) SYNTHESES NEOCLASSIQUES
Pour les néoclassiques, une politique économique est nécessaire, mais elle ne doit pas rompre les
équilibres.
J. Hicks (l’inventeur des courbes IS-LM…) soutient que :
- pour que la politique de relance budgétaire soit maximale, il faut que l’investissement privé
soit peu sensible au taux d’intérêt. Si l’Etat investit, le taux d’intérêt risque d’augmenter. Or il ne
faut surtout pas que les personnes privées arrêtent d’investir.

- la politique budgétaire est inefficace si la demande de monnaie par les ménages n’est pas
élastique au taux d’intérêt. Le ménage ne doit pas avoir de préférence pour l’épargne pour qu’une
telle politique marche.
Au final, le sort de toutes ces politiques dépend de l’économie réelle ; le comportement des
ménages et des entrepreneurs est déterminant.
Les néoclassiques, de façon plus générale, posent des limites à l’efficacité des politiques
conjoncturelles (monétaire, budgétaire).
Phillips, lui, établit une corrélation entre taux de chômage et niveau des salaires. Lorsque l’inflation
gonfle, le chômage baisse, et inversement.
Pour lui, une politique de relance est bien possible, mais ne doit jamais être inflationniste. Pour ce,
il est nécessaire de limiter la hausse du taux de salaire (cf politique de rigueur en 1983).
Sur les monopoles naturels, les néoclassiques reprennent Walras. En plus, ils définissent la notion
d’externalité : il s’agit d’un effet indirect et non intentionnel, où la consommation ou la production
d’un acteur modifie la fonction d’utilité d’un autre acteur, sans que cela se reflète sur le prix. Par
exemple, le pêcheur est pénalisé par le rejet de pollution de l’usine dans la rivière…
Dans les années 1960 se produit un fort essor des biens collectifs. Les néoclassiques intègrent ce
nouvel élément avec la théorie des biens collectifs :
- non exclusion d’usage (cf défense nationale),
- non rivalité : la consommation de l’un ne peut réduire celle de l’autre.
Les néoclassiques ont donc plus construit une fonction de préférence collective qu’une somme des
préférences individuelles.
Les « 30 glorieuses » ont affiné la pratique des politiques conjoncturelles.
COURS N°2
III- LA DEFAILLANCE DE L’ ETAT : « REMISE EN CAUSE DE SA LEGITIMITE ET
DE SON EFFICACITE »
Vers la fin des années 1970, les pays qui ont les frontières ouvertes rencontrent des problèmes, avec
la hausse de la pression extérieure. Dans ces années, on assiste également à de grandes innovations
technologiques, qui permettent d’améliorer la production sans créer plus d’emploi.
De plus, le rapport de force entre créanciers et débiteurs s’inverse : l’inflation et le bas taux d’intérêt
réel incitent les emprunteurs à demander plus d’argent.
Le rapport entre salariés et employeurs change aussi ; le taux de chômage augmente.
Tous ces éléments finissent par interroger l’intervention de l’Etat.
La stagflation des années 1980 va discréditer la Courbe de Phillips : taux de chômage et taux
d’inflation augmentent ensemble.
A nouveau, forte contestation de l’intervention publique ; seul le marché est vu comme le meilleur
allocataire des ressources.
Rappel : le marché n’est pas un acteur ! C’est un lieu fictif de régulation, d’allocation, de
rencontre entre offre et demande.
On retourne à la pensée de Bastiat : « Etat, grande fiction sociale à partir de laquelle chacun
s’efforce de vivre aux dépens des autres ».
L’école autrichienne compte surtout F. Hayek. Ce dernier pense qu’il est inutile de chercher un
optimum social ; seul le marché peut trouver les solutions, le prix étant le signal permettant aux
agents économiques de corriger leurs erreurs.
Hayek réduit le keynésianisme à une drogue ayant provoqué une euphorie éphémère, qui ne peut
alimenter durablement une croissance équilibrée.

La pensée libertarienne, plus radicale, conteste l’Etat même dans sa fonction régalienne (proposition
de milices privées pour la défense).
Friedman, de l’Ecole de Chicago, critique tout d’abord la courbe de Phillips ; celle-ci n’est valable
qu’à très court terme, car après le taux de chômage devient insensible à l’inflation.
Friedman parle également d’un taux de chômage naturel, toujours présent dans toute société.
De plus, la monnaie est neutre ; toute injection monétaire est donc inflationniste. C’est une critique
du multiplicateur keynésien. Friedman prône des politiques monétaires restrictives.
Un autre problème est celui des anticipations adaptatives : Friedman, au contraire du plus radical
Hayek, pense que les individus peuvent corriger leurs anticipations grâce à leur expérience.
Le rôle de l’Etat est juste d’assurer un environnement stable pour permettre le bon déroulement du
marché.
Les banques centrales doivent être indépendantes, assurer la discipline monétaire. La dépense
publique doit être stabilisée.
Pour Laffer, « trop d’impôts tuent l’impôt » : au bout d’un moment, les gens risquent de ne plus
déclarer leurs impôts.
Le monétarisme va inspirer des thérapies de choc : au Chili, au R-U avec Tchatcher, aux USA avec
Reagan…
Ecole des anticipations rationnelles
Cette école se développe aux USA, avec R. Lucas, T. Sargent.
Pour ces auteurs, l’économie n’est pas une machine : elle est faite par des acteurs qui essayent
d’anticiper les décisions des responsables de la politique économique.
Il y a donc une double réponse de la part des acteurs de l’économie : celle à la politique
économique réelle et celle à la politique économique future anticipée. L’individu utilise toutes ses
informations pour adapter ses anticipations, est capable de se projeter dans le futur.
L’ Etat, lui, n’est qu’un acteur parmi d’autres qui- comme tout le monde –essaye d’adapter son
comportement. Mais les politiques économiques perturbent les autres acteurs ; du coup, les
incertitudes et les effets inattendus augmentent.
L’analyse keynésienne est targuée de trop mécanique par ces auteurs. Cette théorie est une critique
des politiques économiques, qui ne sont efficaces qu’à des conditions très déterminées.
Théorie des choix publics
Cette théorie remet en cause la fonction de préférence collective ; il est impossible de définir
l’intérêt général, de passer de la rationalité individuelle à celle collective.
La démocratie représentative, elle, n’est qu’une forme de lutte pour le pouvoir.
Le paradoxe de Condorcet montre que les individus peuvent choisir en comparant la solution
optimale, mais qu’on ne peut transposer ceci au niveau de toute une société. Il y a trop de
difficultés pour déterminer la préférence collective, la somme des préférences individuelles étant
insuffisante.
Il faut donc privilégier la démocratie indirecte, avec le report sur des représentants. Il faut qu’il y
ait des hommes politiques disposant d’une certaine marge de manœuvre.
Dans l’Ecole des choix publics, on parle de « marché politique ». Il n’y a pas de raisons pour que
l’individu se comporte de façons différentes en consommateur ou en électeur. Tout simplement, on
compare toujours le prix, la satisfaction. Le citoyen, par exemple, compare les impôts payés aux
services qui sont mis à sa disposition en retour.
L’élu, supposé rationnel, maximise ses avantages, en cherchant avant tout sa réélection. Les
objectifs économiques ne sont donc que des intermédiaires pour une future réélection. L’homme
politique tend à choisir une politique inefficace, mais populaire !
C’est une lutte collective pour le pouvoir, menée par différents groupes de pression.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
1
/
59
100%