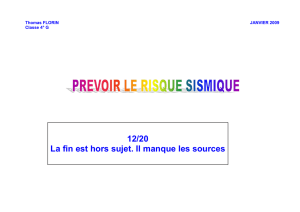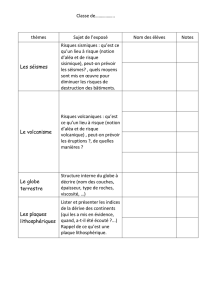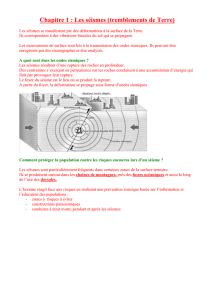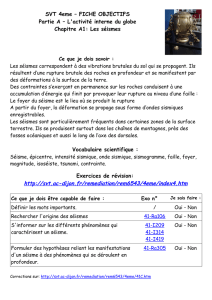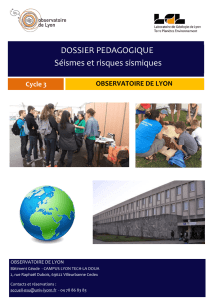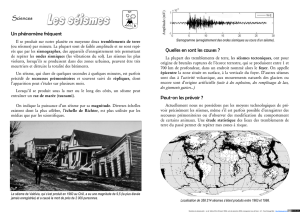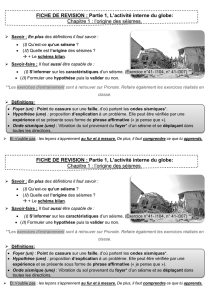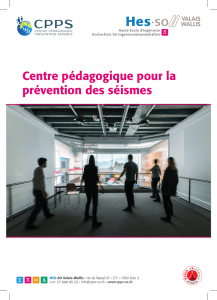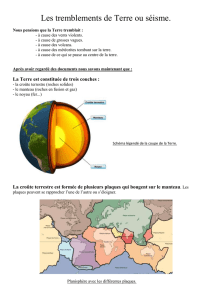Travail complet au format pdf

Gymnase Auguste Piccard Freya-Merret Girault
Travail de Maturité 2007 3m8
Date de reddition: 12 novembre 2007
La Suisse, à l'abri des séismes?
Maître responsable : M. Vincent DeCoulon
Gymnase Auguste Piccard

La Suisse, à l'abri des séismes? Travail de maturité 2007
Freya-Merret Girault
-1/46-
1. INTRODUCTION .................................................................... 3
2. LES SEISMES SUR LA TERRE ........................................................ 4
2.1. Explication du phénomène....................................................... 4
2.2. Les effets d'un tremblement de terre......................................... 4
2.2.1. Effets de site .......................................................................6
2.2.2. Effets induits .......................................................................7
2.3. L'aléa sismique.....................................................................10
3. LA SISMICITE EN SUISSE ..........................................................12
3.1. Les zones actives..................................................................12
3.1.1. Les Alpes .......................................................................... 13
3.1.2. La région baloise................................................................. 14
3.2. Le sous-sol helvétique ...........................................................15
3.2.1. Les roches......................................................................... 15
3.3. Les risques..........................................................................16
3.3.1. Les mesures de prévention ..................................................... 18
3.3.2. Le Microzonage................................................................... 23
3.3.2.a Les lifelines ..........................................................................24
3.3.2.b Ouvrages "normaux" ................................................................25
3.3.2.c L'aménagement du territoire .....................................................25
3.3.2.d Les sites étudiés ....................................................................25
3.3.3. Le sauvetage ..................................................................... 27
3.3.4. Les ouvrages spéciaux........................................................... 27
3.3.4.a Les barrages .........................................................................27
3.3.4.b Les centrales nucléaires ...........................................................28
3.3.4.c Les dépôts souterrains de déchets radioactifs.................................29
3.3.4.d L'industrie ............................................................................31
3.4. Assurés contre les séismes?.....................................................31
3.5. La sismologie .......................................................................32
3.5.1. Le Service sismologique suisse................................................. 32
3.5.2. La paléosismologie............................................................... 33
3.6. Historique...........................................................................34
3.6.1. Bâle, 1356......................................................................... 38
3.6.2. Sierre, 1946....................................................................... 39
3.7. La Géothermie .....................................................................40
4. CONCLUSION .....................................................................44
5. GLOSSAIRE .......................................................................45
6. BIBLIOGRAPHIE...................................................................46
6.1. Littérature..........................................................................46
6.2. Sites Internet.......................................................................46

La Suisse, à l'abri des séismes? Travail de maturité 2007
Freya-Merret Girault
-2/46-
Un grand merci à mon tuteur M. DeCoulon pour m'avoir suivie tout au long de mon
travail.
J'aimerais remercier également Dr. Corinne Lacave, sismologue chez Résonance SA,
pour toutes les informations précieuses qu'elle m'a fournies.
Mes remerciements vont aussi au Dr. Pierino Lestuzzi, pour son accueil dans ses
locaux à l'EPFL, et pour sa présentation, notamment du simulateur de séismes.
Merci également à toutes les tierces personnes, en particulier ma famille, qui ont
aidé à la réalisation de ce Travail de Maturité.

La Suisse, à l'abri des séismes? Travail de maturité 2007
Freya-Merret Girault
-3/46-
1. Introduction
La Suisse est, à l'échelle mondiale, un pays peu connu pour ses catastrophes
sismiques. En effet, la plupart des tremblements ne sont même pas perçus par la
population, et la faible activité sismique du XXe siècle a conduit à la croyance que
seul de faibles secousses pouvaient avoir lieu dans le pays. Pourtant, le danger
reste considérable et un événement d'une grande ampleur reste très probable.
Ce danger naturel est néanmoins largement négligé, malgré le risque qu'il
représente pour la population et les bâtiments. C'est en effet le seul danger
naturel qui n'ait pas encore été réellement pris en compte par une loi, alors
qu'aucun autre risque naturel ne peut générer autant de dégât à grande échelle et
dans un intervalle de temps si court. La sécurité parasismique des ouvrages
helvétiques est également inférieure aux normes, celles-ci n'étant pas obligatoires.
De plus, la grande majorité des bâtiments du pays ne sont pas assurés contre les
dommages sismiques.
Tout cela est cependant en train d'évoluer. Des mesures de prévention ont été
édictées par la Confédération, et les sols suisses font office d'une étude
approfondie, bien que cette étude peine à déboucher sur des actes et des décisions
concrètes et reste très scientifique.
Ce travail est divisé en deux parties. La première sert d'introduction aux séismes,
et se penche principalement sur les effets qu'ils peuvent engendrer. Plus
techniques, ces premières pages aident à la compréhension de la suite du travail.
La deuxième partie touche le vif du sujet et est entièrement axée sur la situation
de ces dernières années en Suisse. Quelles sont les régions sismiquement actives?
Quel est le risque encouru par la population et les biens? Que faire pour diminuer
ce risque? Ces questions représentent le fil rouge de ce dossier, auquel s'ajoute
encore le problème de la couverture des infrastructures en cas de séismes. Je vais
également parler du Service sismologique suisse, et me pencher sur l'histoire
sismique de notre pays. Finalement, je vais traiter de la géothermie, cette
pratique si récente et si prometteuse, mais qui comporte un désavantage certain
sur un plan sismique.
Mes motivations pour réaliser ce travail sont principalement dues à l'actualité du
sujet. De plus, c'est un thème qui nous concerne de près, nous, habitants de la
Suisse. Cette proximité, à la fois géographique et temporelle, ne m'a rendu que
plus curieuse. La géologie et la géopolitique sont par ailleurs des matières qui
m'intéressent particulièrement.

La Suisse, à l'abri des séismes? Travail de maturité 2007
Freya-Merret Girault
-4/46-
2. Les séismes sur la terre
2.1. Explication du phénomène
Les tremblements de terre proviennent dans une grande majorité des cas d'un
déplacement de deux plaques tectoniques séparées par des failles, également
appelées des discontinuités tectoniques, qui se trouvent en profondeur. Ces failles
peuvent être verticales, horizontales ou inclinées, et de taille plus ou moins grande
(allant de quelques centimètres à quelques milliers de kilomètres). Grâce à celles-
ci, les masses rocheuses cassantes peuvent se déplacer en coulissant, en se
chevauchant ou en se séparant l'une par rapport à l'autre. Les mouvements de
compartiments rocheux saccadés ne se font généralement pas sur toute la longueur
de la faille, mais seulement dans une zone bien précise appelée la "surface de
rupture". L'énergie qui s'est alors accumulée dans cette zone se libère brutalement
lorsqu'elle atteint le seuil de rupture mécanique des roches. Des ondes sismiques
de natures et de vitesses variées sont ainsi générées et parcourent des chemins
différents pour atteindre un site en surface où elles vont soumettre le sol à des
mouvements divers. Celui-ci oscille principalement sur le plan horizontal, bien que
des oscillations verticales de moindre
importance puissent également avoir
lieu.
Si la surface de rupture est petite, le
mouvement des masses rocheuses
demeure en profondeur, même si la
faille est visible à la surface de la
Terre. Mais plus la surface de rupture
est grande, plus le séisme est fort, et
si cette surface est extrêmement
importante (à partir d'une magnitude
d'environ 6.5), elle peut atteindre le
sol terrestre, et ainsi celui-ci sera
impliqué même dans les mouvements
les plus superficiels.
"Un tremblement de terre résulte de la
libération brusque d'énergie à partir d'une
surface de rupture en profondeur."
Tiré du Principe pour l’établissement et
l’utilisation d’études de microzonage en
Suisse.
2.2. Les effets d'un tremblement de terre
Les effets d'un séisme ainsi que sa force sont notés au moyen de deux systèmes
d'échelle indiquant d'une part la magnitude, et d'autre part l'intensité du séisme.
La magnitude est une valeur permettant de quantifier l'énergie libérée à la source
d'un séisme grâce à des enregistrements, et dont l'échelle la plus couramment
utilisée est celle de Richter. L'intensité, elle, est fondée sur l'observation des
changements visibles sur des constructions ou dans la nature, ainsi que sur la
perception des êtres humains. C'est en réalité une évaluation des dégâts traitée
statistiquement, où l'échelle EMS 98 est la plus courante.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
1
/
48
100%