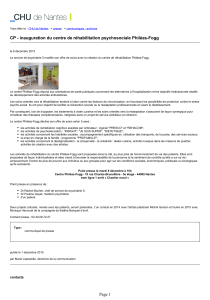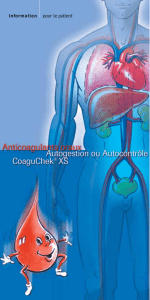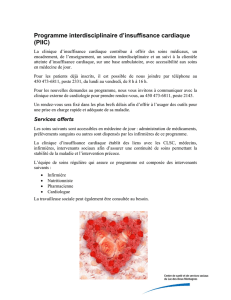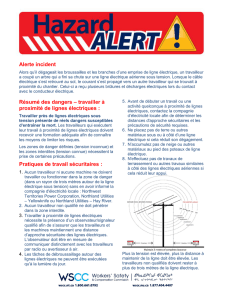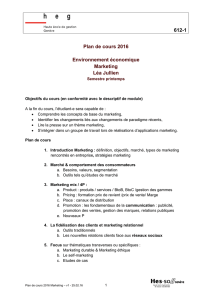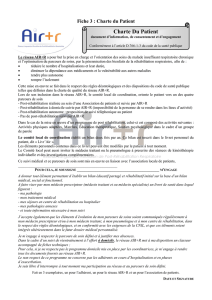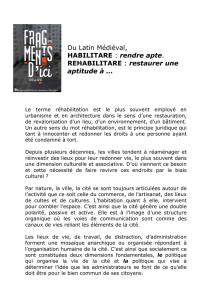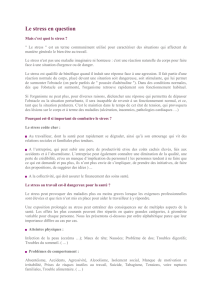Soumission à la Commission d`Ethique de la Recherche Clinique de

1/11
Soumission à la Commission d’Ethique de la Recherche Clinique de la Faculté
de Médecine de Lausanne
(Toutes les désignations de personnes ou de titres doivent être comprises comme incluant indifféremment le
genre masculin ou féminin).
1. Titre de l’étude
Stratégie interdisciplinaire d’intervention sur le lieu de travail pour les pathologies
musculosquelettiques chroniques, étude principale faisant suite à la phase pilote.
2. Date de l’envoi du protocole et date prévue pour le début de l’étude
Envoi du protocole : mai 2006
Recrutement des premiers patients (début du projet de recherche) : juin 2006
3. Nom et signature de l’investigateur responsable et de ses collaborateurs
Signatures
Investigateur responsable :
Prof. Brigitta Danuser .....................................
Directrice
Institut universitaire romand de Santé au Travail
Rue du Bugnon 19–1005 Lausanne
Tél.: 021 314 74 21, Fax : 021 314 74 30
e-mail : brigitta.da[email protected]
Collaborateurs de l’équipe lausannoise:
o Unité Rachis et Réhabilitation (URR) du service de rhumatologie, médecine
physique et réhabilitation (RMR), Hôpital Nestlé, Av. Pierre-Decker 5, 1011
Lausanne-CHUV
Tél.: 021 314 15 03
Dr Pierre de Goumoëns .....................................
o Unité Rachis et Réhabilitation (URR) de l’hôpital orthopédique de Suisse
Romande, av. Pierre-Decker 4, 1011 Lausanne-CHUV
Tél.: 021 545 06 27
Dr Michael Norberg .....................................
o Secteur médecine du travail de l’Institut universitaire romand de Santé au Travail,
Rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne
Tél.: 021 314 74 21, Fax : 021 314 74 30
Dr Catherine Lazor-Blanchet .....................................
o Secteur ergonomie de l’Institut universitaire romand de Santé au Travail, Rue du
Bugnon 19, 1005 Lausanne
Tél.: 021 314 74 21, Fax : 021 314 74 30
Sandrine Corbaz-Kurth .....................................
Fabienne Kern .....................................
Viviane Gonik .....................................

2/11
o Correspondants pour l’entreprise participant à l’étude
Dr Claude Witz, médecin d’entreprise
Mme Sandrine Leuba, infirmière de santé au travail
Collaborateurs de l’équipe zurichoise :
o Departement Rheumatologie und Institut für Physikalische Medizin,
Universitätsspital Zürich: Dr Andreas Klipstein.
o Zentrum für Organisations und Arbeitswissenschaften, ETHZ: Thomas Läubli
Le projet est également soumis en parallèle à la commission d’éthique de Zurich.
Entreprise participant à l'étude pour le recrutement par l’équipe lausannoise: COOP REV
Suisse Romande, Renens. Des contacts avec d’autres entreprises sont en cours (CHUV,
Migros, Bobst,…) en vue d’atteindre le nombre d’employés nécessaire à cette recherche
(13 500).
Lieux où l’étude sera réalisée : Unité Réhabilitation Rachis, en association avec l’IST
(secteurs médecine du travail et ergonomie) pour la partie réalisée en Suisse Romande.
4. Mise en perspective de l’étude
Cette étude a reçu le soutien du FNS (subside no 2214) et fait suite à la soumission au comité
d’éthique de la phase pilote. Elle constitue la deuxième étape d'une étude s’inscrivant dans le
programme national de recherche PNR 53 “Santé musculosquelettique-douleurs chroniques”.
L’étude randomisée, en aveugle, sera destinée à comparer l’efficacité du traitement classique
avec celle d’une stratégie d’intervention interdisciplinaire. Les deux méthodes seront alors
comparées en terme de capacité de travail retrouvée et de taux de retour au travail.
Le protocole d’intervention de l’étude sera appliqué à 240 patients souffrant de douleurs au
niveau lombaire, au niveau cervical ou au niveau des épaules.
Deux groupes de recherche mèneront cette étude en parallèle. Ces groupes sont composés de
deux centres de rhumatologie et réhabilitation (URR Lausanne et USZ) et de deux instituts
suisses s’occupant de santé au travail (IST Lausanne et ZOA ETHZ).
4.1. Etat des connaissances
Les troubles musculosquelettiques (TMS) en lien avec le travail, dont les lombalgies et
cervicalgies font partie, représentent un problème de santé récurrent et coûteux dans les
pays industrialisés. Selon la troisième enquête européenne sur les conditions de travail
réalisée en 2000, il ressort que les problèmes de santé liés au travail les plus fréquents sont
les douleurs du dos (30%), le stress (28%) et les douleurs des membres (25%).
En Suisse, le coût des troubles musculosquelettiques liés au travail est estimé entre 2 et 4
mia CHF par année. Une faible proportion de patients en incapacité de travail de plus de 3
mois, entraîne des coûts élevés et un absentéisme au travail prolongé. Ces mêmes patients
présentent également un risque élevé d’invalidité : en effet, plus la durée de l’incapacité
de travail se prolonge, plus le taux de réintégration professionnelle est bas.
Bien qu’il y ait eu des progrès importants dans la compréhension des causes et des
processus de chronicisation de la maladie, la prise en charge ainsi que le retour au travail

3/11
des patients souffrant de troubles musculosquelettiques chroniques demeurent encore
insatisfaisants. Des études récentes semblent indiquer qu’une réhabilitation réussie des
troubles musculosquelettiques nécessite une intervention interdisciplinaire, associant des
compétences en rhumatologie, médecine du travail, psychologie et ergonomie.
4.2. But de l’étude
Le but de cette étude, contrôlée, randomisée, en aveugle, est de comparer l’efficacité d’un
traitement interdisciplinaire par rapport au traitement classique.
Le protocole interdisciplinaire sera appliqué à 240 patients au total, dont 120 seront
recrutés par l'équipe lausannoise et les 120 autres par l’équipe zurichoise. Un groupe
contrôle sera constitué. Si plusieurs personnes ayant des contacts professionnels sont
sélectionnées, elles seront mises dans le même groupe. Le groupe contrôle aura un suivi
par le médecin traitant qui recevra les informations nécessaires après les diverses
évaluations. Les patients du groupe contrôle bénéficieront d’un traitement classique de
physiothérapie ainsi que de l’attention soutenue par l’équipe de recherche.
4.3. Objectifs
L’étude permettra de:
évaluer l’efficacité d’une stratégie interdisciplinaire de réinsertion professionnelle
pour des employés en arrêt maladie suite à de problèmes de TMS dorsaux,
élaborer de nouvelles stratégies pour la prise en charge des personnes souffrant de
lombalgies/cervicalgies,
évaluer les déterminants individuels et professionnels en terme de facteurs de risques
et de facteurs de protection,
édicter des recommandations pour les instances officielles et les entreprises,
diminuer l’absentéisme et les coûts pour l’entreprise et pour la société.
4.4. Justification
Les troubles musculosquelettiques sont une source importante de morbidité,
d’absentéisme et engendrent des coûts économiques directs et indirects élevés.
L'évolution des troubles musculosquelettiques est généralement favorable dans les 6
premières semaines après l’apparition des douleurs. En revanche, la proportion de retour
au travail décroît considérablement en cas de chronicisation des symptômes : environ 42%
des personnes en arrêt de travail de plus de 6 mois pour lombalgies n’auront pas repris le
travail à un an et seront à l’invalidité.
Des revues systématiques récentes semblent indiquer l’efficacité de programmes
interdisciplinaires associant des mesures de réhabilitation en unité spécialisée, une prise
en charge psychologique et une intervention sur le lieu de travail.
Effectuer une étude scientifique sur la recherche de l’efficacité d’une telle intervention en
Suisse apparaît nécessaire.

4/11
5. Plan général
A. Sélection
Institut universitaire
romand de Santé au
Travail (IST), secteur
médecine du travail
C1. groupe d’intervention
interdisciplinaire
service URR + IST secteur
ergonomie
C2. groupe
contrôle
E. Evaluation
5 mois
8 mois
B. Examen de la
ligne de base et
randomisation
Service URR CHUV
F. Analyse finale et
synthèse
service URR + IST
14 mois

5/11
5.1. Planification et procédures
Le nombre prévu de patients pour l’étude interventionnelle est de 240 au total, soit 120
patients recrutés à Lausanne et 120 à Zurich.
L’inclusion des patient(e)s dans l’étude sera réalisée entre juin 2006 et mai 2008.
5.1.1 Stratégie de sélection
Première sélection
Le système de management d’absentéisme des entreprises ayant accepté de
participer à cette étude sera utilisé pour effectuer une première sélection des
travailleurs. Dans l’entreprise participante, le service du personnel annonce
systématiquement à l'équipe médicale de l'entreprise (infirmière et médecin
d'entreprise) toute absence > 20 jours consécutifs. L’équipe médicale de
l’entreprise effectuera la première sélection sur la base des critères suivants:
personne en arrêt de travail à 50% au minimum, d’une durée > 20 jours
ouvrables mais < 6 mois, sans interruption, pour cause de maladie,
être âgé de moins de 58 ans,
effectuer un travail physique léger à lourd (pas de travail de bureau),
pas de reprise du travail à 100% prévue dans les 2 semaines suivant le contact.
Aucune donnée concernant cette personne ne sera transmise aux responsables de
l'étude tant que le travailleur n’aura pas été informé et n'aura pas donné son
accord.
Pour ce faire, les travailleurs qui correspondent aux critères d’inclusion ci-dessus
recevront de la part de l'infirmière de l'entreprise, par courrier à leur adresse
personnelle, un pack de formulaires codés :
un formulaire d'information brève sur le questionnaire destiné au travailleur
(cf. annexe 1, blanc),
un formulaire de consentement écrit du travailleur concernant la transmission
des données et son accord pour être contacté par téléphone (cf. annexe 2, rose),
un questionnaire concernant la/les cause(s) principale(s) de l'incapacité de
travail en cours (cf. annexe 3, vert).
Le travailleur aura la liberté de retourner ou non, sous enveloppe-réponse pré-
affranchie, le formulaire de consentement (rose) et le questionnaire (vert) au
responsable de l’étude pilote. Dès réception de ces documents, le travailleur sera
contacté par téléphone afin d’effectuer la deuxième sélection.
Deuxième sélection
Critères d’inclusion
tout travailleur en arrêt de travail en raison de douleurs du dos, de la nuque ou
des épaules (sauf critère d'exclusion),
qui accepte de prendre part à l’étude,
qui a des connaissances linguistiques suffisantes pour lire et remplir des
questionnaires lors de l'examen à la ligne de base,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%