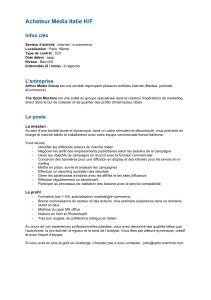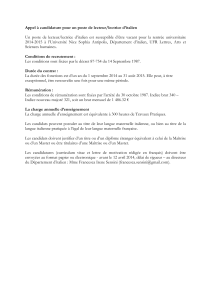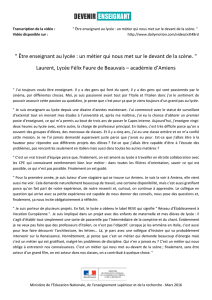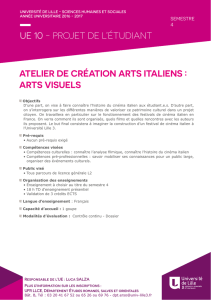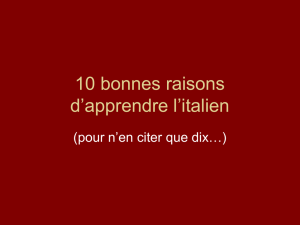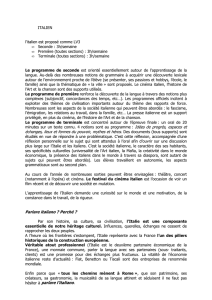FARRE Carole

Création d’un outil d’évaluation des élèves en Italien
dans un site expérimental en langues vivantes
PRESENTATION
Ce travail a été réalisé par l’école élémentaire de Saint-Marcellin en Forez dans la Loire.
Il a regroupé Michèle NICOLI (Conseillère Pédagogique Départementale, Langues Vivantes), Maryse ZOFFOLI
(Intervenante extérieure en Italien), Marcel FAURE, Marco FARRE, Armel NOIRY (professeurs des écoles) et
Maurice BEDOIN (coordonnateur de l’équipe responsable de l’accompagnement auprès du rectorat).
ETAT DES LIEUX
L’école primaire publique de la Paix de Saint-Marcellin en Forez a été choisie pour devenir en septembre 2003,
site expérimental dans l’enseignement des langues vivantes (Italien-Anglais) à l’école primaire.
L’enseignement de l’italien avait commencé quelques années plus tôt, dans ce village de 4000 habitants, jumelé
avec le village de Marta situé dans la province de Viterbo, en Italie.
Des échanges par courrier électronique dans un premier temps, et physiques par la suite ont permis aux
enseignants français et italiens de collaborer et de permettre aux élèves marcellinois d’être confrontés,
pendant une semaine, à la vie quotidienne de leurs copains italiens et de pouvoir pratiquer cette langue étrangère
qu’ils apprenaient à l’école. A l ‘heure actuelle 3 échanges ont eu lieu (mai 2001, mai 2003 et mai 2005) mais les
enseignants souhaiteraient les généraliser et les programmer tous les ans (même si du côté italien, « le
mamme italiane» ont du mal à laisser partir leurs enfants).
La motivation a été forte et des progrès indéniables ont été notés par les enseignants concernés. Ce
complément à l’enseignement permet aux jeunes de construire un « projet de sens ». Ils apprennent et on leur
donne la possibilité de réinvestir concrètement en « communiquant et en élargissant leur horizon pour construire
un projet européen d’espoir et d’avenir ».
Restait à confirmer en mettant en place une évaluation pour vérifier les compétences acquises par les élèves ou
celles qui devaient l’objet d’une remise en question.
SITE EXPERIMENTAL DANS L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES : ANGLAIS/ITALIEN
Depuis octobre 2003, les élèves de l’école (à partir du CE2) bénéficient de cet enseignement de la façon
suivante :
- CE2 ITALIEN deux séances de 45 minutes par semaine
- CM1 ITALIEN deux séances de 45 minutes par semaine
- CM2 ITALIEN une séance de 30 minutes par semaine
ANGLAIS deux séances de 45 minutes par semaine
Cette configuration est conforme aux programmes d’enseignement des langues étrangères au cycle des
approfondissements (BO Hors série N°4 du 29 août 2002), des programmes de l’école élémentaire (Qu’apprend-
on à l’école élémentaire ? Horaires et programmes de 2002) qui préconisent 1H30 à 2H d’enseignement des
langues vivantes et du cadre européen de référence (utilisateur élémentaire A1 pour un élève de l’école
primaire).

Les élèves qui partent en 6ème ont ensuite la possibilité de poursuivre cet enseignement bi-langue dans leur
collège de secteur et ce jusqu’en classe de 3ème.
Nota bene : Les élèves et leurs parents sont informés de cet engagement sur ces deux langues jusqu’à la classe
de 3ème du collège. IL n’est pas non plus envisageable de commencer une 3ème langue étrangère en classe de 4ème.
Outil d’évaluation
La création d’un support d’évaluation des « acquisitions des compétences permettant l’usage efficace d’une
langue autre que la langue française » a été réalisé par l’équipe.
Cet outil se présente sous la forme d’un texte « La festa del compleanno » (pouvant être lu par l’enseignant ou
écouté à partir du document enregistré). Il propose, non seulement l’évaluation d’un travail intellectuel
(réinvestissement linguistique lié à l’apprentissage), mais il intègre aussi une dimension culturelle.
Le texte est découpé en 3 plages distinctes. A la suite de l’écoute et selon un protocole établi, les élèves sont
évalués par une série d’activités :
a) 6 activités de compréhension orale destinées à être passées par tous les élèves du groupe classe.
b) 2 activités de compréhension et d’expression orale passées (dans le cas de l’école de Saint-Marcellin en
Forez) uniquement par un panel de quelques élèves (6 par classe : deux élèves « en difficulté », deux
élèves « supposés moyens » et deux élèves « plus à l’aise »).
La première évaluation s’est déroulée en mai-juin 2005. Elle a été suivie, bien évidemment, par une analyse
des résultats.
D’autres analyses seront effectuées dans les années à venir pour comparaison des résultats obtenus avec des
élèves ayant eu un enseignement sur 3 années scolaires.
Certaines questions « rassembleuses » se sont posées aux enseignants du dispositif :
- Qu’apprend réellement un élève de primaire en langue étrangère et que retient-il ?
- Existe-t-il des incidences entre langue maternelle et langues vivantes ?
- Y a-t-il transfert de compétences d’une langue à l’autre ?
- Y a-t-il un âge idéal pour apprendre les langues vivantes ?
- De quelle façon conduit-on les apprentissages ?...
QUELQUES ELEMENTS DE REPONSE…
DU COTE DES ENFANTS
Les réflexions sur les relations qui existent entre la langue maternelle et la langue étudiée sont vivement
encouragées par les enseignants. En italien, par exemple, les élèves notent des similitudes. Voici quelques unes
de leurs réflexions :
Cycle des apprentissages fondamentaux
Domaines
Horaire minimum
Horaire maximum
Maîtrise du langage et de la langue française
9 h
10 h
Vivre ensemble
0h30 débat hebdomadaire
0h30 débat hebdomadaire
Mathématiques
5 h
5 h 30
Découvrir le monde
3 h
3 h 30
Langue étrangère ou régionale
1 h
2 h
Éducation artistique
3 h
3 h
Éducation physique et sportive
3 h
3 h

- C’est plus facile en italien parce que quand on parle, on entend si c’est pluriel ou singulier alors qu’en
français, souvent on n'entend rien :
i ragazzi pour les garçons… gli alunni pour les élèves…
Ils notent que c’est aussi le cas, certaines fois, pour les verbes :
le ragazze parlano pour les filles parlent…
- Ils réalisent que, bien souvent, la structure de la phrase italienne « ressemble » à celle du français :
Mi chiamo Julien pour Je m’appelle Julien (Sujet + verbe : structure similaire)…
- Ils prennent conscience de racines communes dans l’étymologie de certains mots :
scuola pour école (mais aussi scolaire, scolarité…)
Ils notent aussi des différences :
- Les italiens utilisent le pronom personnel devant le verbe uniquement pour insister mais rarement dans
une discussion.
- « Il y a » en français peut-être suivi du singulier ou du pluriel, alors qu’en italien, le verbe s’accorde soit
au singulier soit au pluriel :
c’è una donna ci sono due ucelli
A noter que certains élèves ont fait des parallèles avec l’anglais qu’ils étudient aussi et ont remarqué que
pour ce dernier exemple on pouvait noter des ressemblances avec l’italien :
there is a boy there are two girls
DU COTE DES ENSEIGNANTS
Enseigner les langues vivantes, c’est remettre très souvent en cause son enseignement avec le souci de faire
participer un maximum d’élèves. En effet les langues vivantes se pratiquant essentiellement à l’oral et dans des
classes dont les effectifs dépassent souvent 25 élèves, se pose le problème du temps consacré à la pratique
linguistique orale par chacun des élèves. En prenant sur soi et en acceptant que les élèves s’aident mutuellement,
on peut imaginer de travailler en groupes. Dans ce cas-là, l’enseignant ne pouvant être présent avec tous les
élèves en même temps, (réajustement de la diction par exemple), il doit offrir aux élèves la possibilité de
prendre en main leur apprentissage soit en s’auto corrigeant, soit en guidant les copains. S’installe alors un
climat d’entraide qui permet sûrement des progrès indéniables.
Les discussions avec des collègues professeurs au collège et nos expériences propres nous font aussi penser que
l’enseignement des langues vivantes semble beaucoup plus efficace à l’école élémentaire lorsque l’enfant est plus
réceptif et moins préoccupé par le « qu’en dira-t-on » des copains du collège. En règle générale, il est plus actif
et plus naturel. Quant à parler d’un âge idéal pour apprendre une langue étrangère ? Sûrement le plus tôt
possible…
Ce qui nous importe, au risque de se répéter, est que l’enfant devienne acteur de cet enseignement, qu’il
s’approprie des structures pour mieux les réinvestir dans des situations de communication, même si celles-ci
sont créées en classe, alors qu’elles sont réelles lors d’un échange physique (nos 3 expériences dans ce domaine,
en 2001, en 2003 et en 2005 nous l’ont montré).
Citons aussi Christian PUREN, professeur des universités à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne qui, lors
de son intervention du mardi 13 octobre 2005 à l’IUFM de Saint-Etienne expliquait :
« Il faut privilégier la communication si l’on veut voir nos enfants communiquer… »
Il pousse les enseignants à « faire réfléchir sur la langue… »
Nous n’avons pas encore trouvé la réponse à toutes nos questions mais ce travail de réflexion nous a permis de
progresser dans notre pratique pédagogique. Nous espérons être sur la bonne voie !

Documents à disposition :
1) La festa del compleanno texte de l’évaluation pouvant être lu
2) La festa del compleanno, document enregistré en 3 parties : ouverture 1ère partie, ouverture 2ème
partie, ouverture 3ème partie.
3) Document du maître (évaluation de tous les élèves) avec protocole et consignes de passation.
4) Document du maître (évaluation individuelle) avec protocole et consignes de passation.
5) Document de l’élève (évaluation de tous les élèves) avec feuillets à photocopier
6) Document de l’élève (évaluation individuelle)
7) barème de notation
8) Analyse, commentaires et résultats de l’évaluation 2005 à l’école de la Paix de Saint-Marcellin en
Forez
CONTACTS
Maurice Bedoin, accompagnateur maurice.bedoin@wanadoo.fr
1
/
4
100%