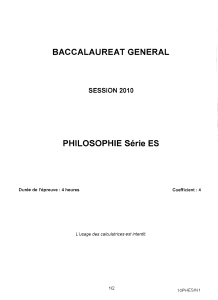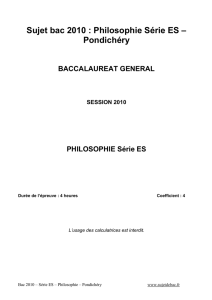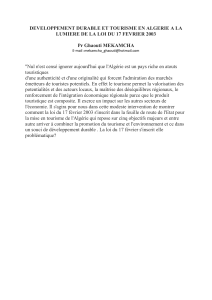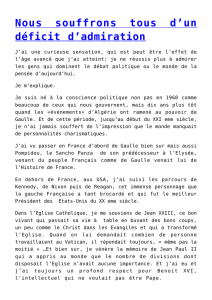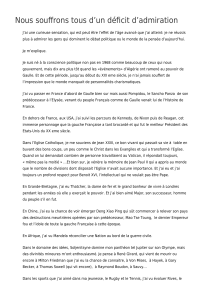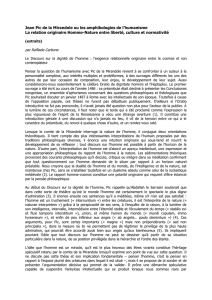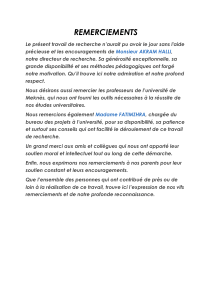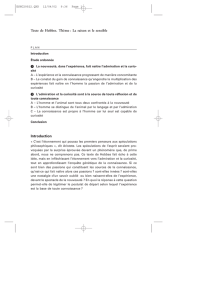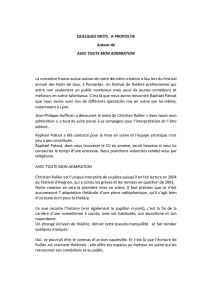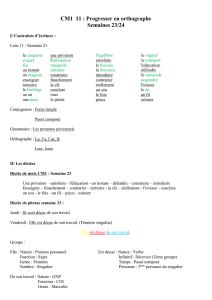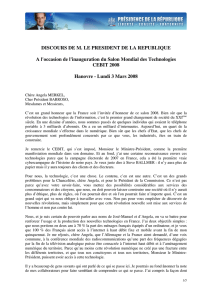Histoire philosophique de l`admiration - E

Cercle de lecture « On admire le monde à travers ce qu’on aime » (Lamartine)
Avril 2005
Philosophie
L’ ADMIRATION
Définitions :
1) Etonnement devant quelque chose d’extraordinaire ou d’imprévu
« C’est une chose admirable, que tous les grands hommes ont quelque
petit grain de folie (Molière)
« Une rivière aux eaux admirablement claires » (Gide)
2) Sentiment de joie et d’épanouissement devant ce qu’on juge
supérieurement beau ou grand
« Il y a dans l’admiration on ne sait quoi de fortifiant » (V. Hugo)
« Nous aimons toujours ceux qui nous admirent » (La Rochefoucault)
« Les portraits de Saint-Simon écrits par lui sans qu’il s’admire » (Proust)
« Admirons les grands maîtres, ne les imitons point » (V. Hugo)
Expressions : - être saisi, transporté d’admiration - exciter, soulever l’admiration -
- un portrait admirable de vérité - forcer l’admiration - être muet d’admiration -
Histoire philosophique de l’admiration
La notion d’admiration est exprimée pour la première fois en Grèce antique ;
elle apparaît comme la base de la réflexion et de la philosophie.
Platon, dans son dialogue intitulé Théétète, fait dire à Socrate, dont les propos
ont frappé d’étonnement son interlocuteur : « C’est la vraie marque d’un philosophe
que le sentiment d’étonnement que tu éprouves ».
Dans la mythologie grecque, c’est Thaumas, l’Emerveillement, qui a engendré
Iris, l’arc-en-ciel, la messagère des dieux, le lien qui relie la terre au ciel, l’image de
la philosophie même. D’où le nom grec de thaumazein, étonnement, émerveillement,
que l’on nomme en français « admiration ».
« Sans émerveillement ou admiration devant le logos, le discours rationnel et
ses difficultés, et sans cet ébranlement intérieur qui nous fait choir de nos
convictions, nulle pensée ne saurait se développer ».
Platon ira même plus loin, jusqu’à une admiration-contemplation, terme de la
réflexion dialectique, qui conduit l’âme à contempler les Idées même des choses,
dans leur pureté originelle.
Avec l’avènement du christianisme, les valeurs du monde grec disparurent
peu à peu et le sentiment d’admiration connut une éclipse durant dix siècles ; la
nouvelle religion en effet diffusa une conception du monde différente, basée sur les
notions d’adoration et d’imitation.
L’attitude du croyant n’est pas l’admiration, mais plutôt, selon la tradition
médiévale, l’imitation du Christ, les saints étant des modèles intermédiaires. …/…

2 Si les saints doivent être imités, c’est dans leur comportement, dans le fait
qu’ils incarnent les vertus chrétiennes ; il suffit de se soumettre à leur exemple. Or
l’admiration n’est pas une soumission, mais un acte de liberté comme l’ont conçu
les positivistes et les philosophes du 18e siècle.
C’est dans cet esprit qu’Auguste Comte a substitué aux noms des saints, dans
son calendrier positiviste, les noms d’hommes célèbres marquant l’âge positif et
l’avènement de « la religion de l’Humanité ».
Cette conception moderne, toujours présente, s’est manifestée par excellence
dans le monument du Panthéon.
Sans chercher à définir le sentiment d’admiration, Pascal constate que
« l’admiration est le propre de l’homme, puisque les bêtes ne s’admirent point ; un
cheval n’admire pas son compagnon ».
Pour Descartes, l’admiration est « la première de toutes les passions, une
subite surprise de l’âme qui fait qu’elle porte à considérer avec attention les objets
qui lui semblent rares et extraordinaires » (Traité des passions de l’âme).
Descartes prend ici l’admiration en son sens d’étonnement devant la chose
nouvelle. Il appelle « estime » l’admiration que l’on porte à une personne ; pour
lui, ce qui est digne d’admiration en tout homme, c’est son libre-arbitre et la
maîtrise de la volonté, facultés qui nous rendent semblables à Dieu : « Le Seigneur
a fait trois merveilles : les choses de rien, le libre-arbitre et l’Homme-Dieu ».
Mais l’étonnement est l’aspect négatif et stérile de l’admiration ; il y a une
manière stupide de s’étonner de tout et d’en rester là.
La vraie admiration doit être le point de départ de la passion et de la
réflexion et se muer en une connaissance des secrets du monde.
Kant a pu dire en ce sens que l’admiration est « un étonnement toujours
renaissant ; c’est dans la nécessité de ce qui est final et constitué…que réside le
fondement de cette grande admiration de la nature ».
Spinoza, à l’inverse de Descartes, ne considère pas l’admiration comme un
sentiment, une émotion qui mettrait l’esprit en mouvement vers la connaissance, mais
plutôt comme « un type particulier de représentation d’une chose, caractérisée par
sa fixité et qui est la manifestation de l’ignorance et la porte ouverte à toutes les
superstitions ».
Quant à la joie que donne la connaissance, Spinoza ne la nomme pas
« admiration », mais « béatitude » ou « vertu ».
Tendances actuelles de l’admiration
Hannah Arendt, dans son analyse « La condition de l’homme moderne »,
indique que la conception antique, désintéressée de l’admiration a laissé place à des
rapports humains basés sur l’intérêt commercial et la publicité. …/…

3 Elle voit, dans le phénomène social qu’est l’élection d’individualités diverses
au titre de « génies » la manifestation du triomphe d’une forme nouvelle de société,
aveugle - dans ses admirations mêmes – aux personnes et seulement sensible à
ses produits et à ses œuvres.
Selon elle « l’idolâtrie du génie recouvre la même dégradation de la personne
humaine que tous les grands principes de la société commerciale ; c’est l’innocence
perdue de l’admiration, dans une société du spectacle où réalité, argent et regard ne
font plus qu’un, et où admirer devient une forme de capitalisation, qui attend ses
intérêts ».
Il existe surtout des formes dévoyées de l’admiration collective : l’idolâtrie, le
culte de la personnalité ou l’exaltation de l’homme supérieur, l’acclamation fanatique
par les foules d’un dictateur et l’adhésion à sa mégalomanie (Hitler, Staline, Mao…).
L’admiration n’est donc pas forcément l’admirable ; le jugement ou la morale doivent
tempérer ce sentiment d’exaltation et en indiquer les limites raisonnables.
« Il y a une innocence de l’admiration : la connaît celui qui ne s’est pas
encore avisé qu’on pourrait lui aussi l’admirer un jour » ( Nietzsche ).
Psychologie de l’admiration
« Dis moi qui tu admires et je te dirai qui tu es ».
Proust, interrogé, posa la question de l’admiration dans le temps : quand
admire-t-on ? Il est hanté par le sentiment de l’éphémère du plaisir esthétique ; la
chose qu’on voudrait admirer n’est plus là quand le temps est venu de la
contemplation dans le calme. Il prend ainsi l’exemple du danseur Nijinski :
« Mais cette impression de beauté que vous voudriez approfondir n’est pas
faite pour durer. Ne chercher pas à aller au-delà du plaisir étonné que la salle
éblouissante, les costumes bleus, le jardin féerique au fond vous ont donné, ne
souffrez pas de ne pas le prolonger, car c’est cela seulement qu’il a voulu vous
communiquer ; bientôt l’effet de lumière va changer, les costumes bleus seront
remplacés par d’autres, son but est atteint s’il vous a donné du ravissement et du
regret. Ce danseur de génie a fait cette mimique qui vous semble inspirée, mais
déjà son corps a pris une autre attitude, il ne doit en garder aucune et si quand il
salue à la fin vous l’applaudissez à tout rompre pour signifier le plaisir continu
qu’il vous a donné, il a atteint sa gloire de danseur » ( Proust - A l’ombre des jeunes
filles en fleurs ).
Proust fera les mêmes observations à propos de « la Berma » (Sarah Bernard)
lors d’une représentation de Phèdre à la Comédie Française.
Proust observe également que l’œuvre nouvelle de génie n’est pas reconnue
immédiatement comme un chef-d’œuvre, car elle dérange par sa nouveauté même. Il
écrit à propos de la célèbre « sonate de Vinteuil » : « ce qui est cause qu’une œuvre
de génie est difficilement admirée tout de suite, c’est que celui qui l’a écrite est
extraordinaire, que peu de gens lui ressemblent. C’est son œuvre elle-même qui, en
fécondant les rares esprits capables de la comprendre, les fera croître et multiplier.
Il faut que l’œuvre crée elle-même sa postérité ». …/…

4 Pour admirer, il faut être deux. Narcisse, épris de sa propre image reflétée dans
une fontaine, languit de désespoir devant son idole insaisissable ; il est condamné à
mourir et à se transformer en fleur des enfers qui porte son nom.
L’admiration dépend des idéaux du moi ; certaines personnes seront
admiratives devant un chercheur ou un écrivain, mais indifférentes devant un grand
sportif qu’elles jugeront certes remarquable, mais pas admirable.
Le beau et le bien font partie des idéaux de tout sujet, mais les critères de ces
valeurs différent selon les individus.
L’admiration de l’élève pour son professeur : selon Lacan, cette admiration
« au stade du miroir » a pour fonction première « d’établir la relation avec une
image certes supérieure, mais à laquelle on voudrait s’identifier, ne serait-ce que
pour se constituer ». Il n’y a rien de soumis dans cette attitude ; l’admiration est
d’ailleurs assez égoïste : « en lui, c’est moi que je voyais » (fonction de miroir –
admirer, c’est toujours se mirer un peu ).
Les artistes ou les penseurs, ceux qui expriment le mieux la condition humaine,
ont toujours admiré d’autres artistes, penseurs ou créateurs, dans leur champ
d’activités ou dans un autre.
Nous prendrons l’exemple de l’admiration de Van Gogh pour Millet : les
deux artistes ont la même dévotion pour le Christ ; le semeur, la gerbe sont les
symboles de l’aspiration vers l’infini ; mais, comme Millet, Van Gogh fait passer son
sentiment religieux par la peinture sans recourir à des sujets directement religieux.
Van Gogh admire Millet pour son labeur acharné, sa vie simple dans une
chaumière avec sa femme et ses huit enfants et sa foi traduite simplement par la
représentation de travaux des champs : L’homme à la houe, à la silhouette et au
visage abrutis de fatigue, montre l’homme voué à gagner sa vie à la sueur de son
front ; Le Semeur est chargé d’espoir ; d’un geste auguste, il déploie au-dessus de la
terre retournée les graines d’or, semence sacrée qui va la fertiliser.
Le perroquet de Flaubert est un bon exemple d’admiration passionnée pour
un animal, magistralement décrit par l’écrivain dans sa nouvelle « Un cœur simple » :
la servante Félicité s’éprend d’un perroquet Loulou, « oiseau radoteur digne de sa
bêtise » ; à la mort de l’animal, elle le fait empailler et l’honore comme une relique
sacrée, sanctifiée et confondue avec une image du Saint-Esprit :
« Le Père, pour s’énoncer, n’avait pu choisir une colombe puisque ces bêtes-
là n’ont pas de voix, mais plutôt un ancêtre de Loulou .
Félicité contracta l’habitude idolâtre de dire ses oraisons agenouillée devant
le perroquet ; quelquefois, le soleil entrait par la lucarne, frappait son œil de verre
et en faisait jaillir un grand rayon lumineux qui la mettait en extase.
En apothéose, le jour de la Fête-Dieu, la servante au grand cœur, en agonie,
croira s’élever dans les cieux entrouverts comme emportée par un perroquet
gigantesque, planant au dessus de sa tête ».
D.GERARDIN
*Fiche établie d’après l’ouvrage « L’admiration » coll. Autrement 1999.
1
/
4
100%