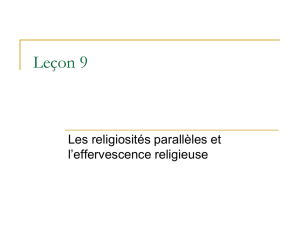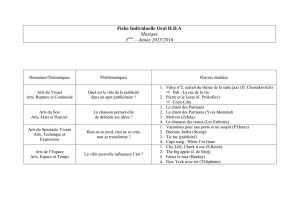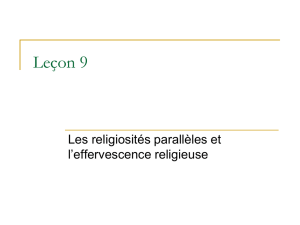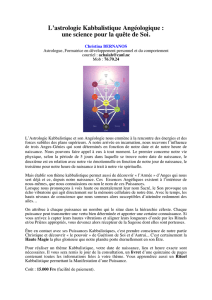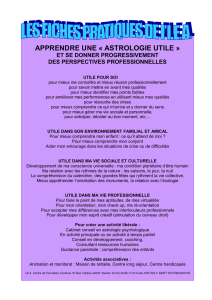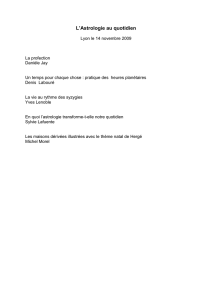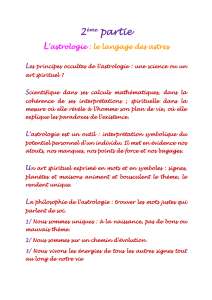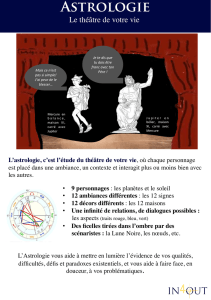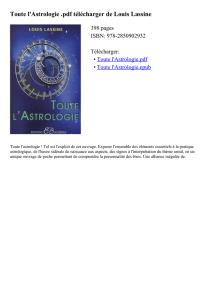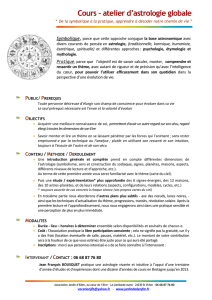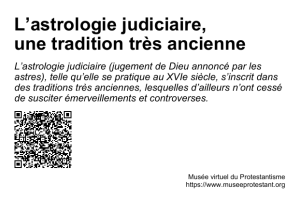Lyon, le 13 mars 1995 - gspr

Lyon, le 13 mars 1995
Marianne Doury
Docteur en Sciences du Langage (Université Lumière-Lyon 2)
55 rue Ney, 69006 Lyon
Tél. : 78 52 62 95
Monsieur Mayet,
Je vous fais parvenir une première version (qui, je l’espère, vous conviendra) de ma
contribution au dossier sur les parasciences que votre magazine élabore. Je me tiens à votre
disposition pour toute modification éventuelle.
Cordialement,
Marianne Doury
Article pour Sciences et Avenir
ARTICLE PRINCIPAL :
Le débat sur les parasciences : un dialogue de sourds.
La polémique sur ce qu’il est convenu d’appeler les “parasciences” constitue un des
principaux “marronniers” des médias. Pour peu que l’actualité marque un creux, télévision et
grande presse s’emparent des “parasciences” pour raviver, le temps d’une émission ou d’un
dossier, la querelle qui oppose leurs défenseurs aux rationalistes qui les dénoncent.
La récurrence de ce débat dans les médias tient sans doute en partie à deux caractéristiques :
la violence des affrontements auxquels il donne lieu, et l’état de stagnation des
argumentations qui s’y développent, et qui promet une pérennité illimitée de la polémique.
Les débats télévisés constituent sans doute un objet fort déroutant pour les théoriciens de
l’argumentation qui nourrissent une vision souvent idéaliste des discours argumentés, vus
comme un mode de discussion rationnelle visant au consensus. En effet, une des règles de
fonctionnement des débats télévisés – et la polémique sur les parasciences ne fait pas
exception – est que les invités maintiennent, du début à la fin de l’interaction, leurs positions
de débat ; ils ne sont pas là pour se mettre d’accord, mais, au mieux, pour convaincre une
partie des téléspectateurs. A-t-on jamais vu les candidats à l’élection présidentielle, lors du
débat entre les deux tours, partir bras dessus bras dessous après s’être affrontés pendant
l’émission, et décider d’une candidature commune ? Mais si, lors des débats sur les
“parasciences”, les positions des invités sont irréductibles, c’est aussi, en dehors des
contraintes imposées par le dispositif médiatique, parce qu’aucun des objets de discussion ne
fait l’objet d’un consensus minimum.
Les premiers désaccords apparaissent lorsqu’il s’agit, pour les partisans des parasciences,
d’admettre le droit à la parole de leurs interlocuteurs. Lors d’un débat sur l’astrologie, E.
Teissier s’indigne de la condamnation de l’astrologie par G. Charpak : « moi je ne comprends
pas, il est physicien, qu’il reste dans la physique, il ne connaît pas l’astrologie alors qu’il ne
la condamne pas ! ». Il est clair que ce type de négociation se résout généralement en faveur
des partisans des “parasciences” : quoi de plus naturel, pour parler d’astrologie, que d’inviter
un astrologue ? En revanche, la légitimité de la présence d’un scientifique, même d’un

astronome, sur un plateau consacré à l’astrologie, relève toujours d’un déplacement de
compétence ; et c’est une première faiblesse de la position des adversaires des parasciences
dans les débats médiatisés.
Le désaccord entre partisans et adversaires des parasciences se retrouve à bien d’autres
niveaux ; en particulier, les parties en présence proposent des interprétations divergentes du
débat qui les oppose. Pour les adversaires des parasciences, il s’agit du combat entre l’ombre
et la lumière, l’obscurantisme et la pensée rationnelle, les charlatans et les démystificateurs.
Cette image qu’ils renvoient du débat, caractérisée par un manichéisme auquel ils échappent
rarement, confère une place bien inconfortable aux téléspectateurs attirés par les parasciences
; ils se voient taxés de “gogos”, de crédules – ou au mieux, quand les rationalistes cherchent à
ménager leur susceptibilité, de victimes. A l’inverse, les défenseurs médiatiques des
parasciences flattent leurs partisans ; pour eux, les scientifiques ou rationalistes opposés aux
parasciences entrent dans la droite lignée des accusateurs de Galilée, qui, en leur temps,
n’avaient pas su reconnaître le génial découvreur de la rotondité de la Terre, et s’étaient
accrochés à leurs préjugés déjà obsolètes afin de préserver leurs privilèges et leur pouvoir.
Ainsi, face à un astronome qui nie la possibilité d’une influence des astres sur les destins
individuels, E. Teissier s’exclame : « et Galilée, alors ? Et Galilée ? ». Quant au public, il ne
lui reste qu’à choisir son camp : celui de la censure, de l’Inquisition (ou, selon les termes des
partisans des parasciences, de la “science officielle”), ou celui des partisans éclairés des
découvreurs modernes.
Désaccord encore, lorsque les débatteurs s’attachent à définir l’objet de la discussion. Les
partisans des parasciences considèrent comme acquis ce que leurs adversaires contestent ; et
chacun de chercher à faire peser sur l’autre la lourde charge de la preuve. Si, pour les
“rationalistes”, c’est à ceux qui affirment que « les cochons volent à la pleine lune »
d’apporter la preuve de leurs allégations, les défenseurs des parasciences développent une
rhétorique de l’acquis, et présentent comme incontestables l’existence des phénomènes “para”
ou l’efficacité des “mancies” (astrologie, morphopsychologie, etc.). A qui incombe alors la
tâche d’argumenter ? A ceux qui affirment, ou à ceux qui rejettent ?
Enfin, et c’est peut-être là le véritable coeur du débat, comment peut-on argumenter ? Existe-
t-il des moyens de preuve (argumentatifs ou scientifiques) que les deux parties en présence
seraient prêts à admettre ? Bien souvent, les partisans des parasciences étayent leurs dires par
des témoignages attestant d’expériences vécues. Ce type de preuve est remarquablement bien
adapté au dispositif médiatique ; il peut assurer une dimension spectaculaire, émotionnelle. Il
prend la forme d’un récit informel, accessible à tous, imputable à un individu en chair et en
os, prêt à attester de l’authenticité de l’expérience qu’il a vécue. Comment résister au
témoignage de cette femme qui, lors de l’émission “Bas les masques”, racontait sa douleur à
la mort de son époux, et l’immense bonheur d’avoir pu entrer en contact avec lui après sa
mort, par le biais d’un magnétophone ? Face à de tels récits, les adversaires des parasciences,
invoquant une éthique scientifique, contestent la validité de tels moyens de preuve. Les
témoignages sont-ils fiables ? L’expérience particulière relatée est-elle généralisable ? Pour
eux, seule une expérimentation en laboratoire, selon un protocole répondant aux exigences de
la démarche logico-expérimentale, serait concluante. Mais, contrairement aux témoignages,
de tels moyens de preuve ne sont guère télégéniques ; et dès que la discussion s’engage sur les
résultats d’une expérimentation précise, c’est l’animateur qui s’empresse de mettre le holà :
« ne soyez pas trop techniques », dit Tina Kieffer à ses invités qui engagent imprudemment
une discussion sur le protocole d’expérimentation des médecines parallèles. Les débats
télévisés adoptent un profil bas, et posent par avance que le “téléspectateur moyen” ne peut
pas suivre une discussion un peu technique. Résultat : seuls sont recevables les arguments
développés par les partisans des “parasciences”. Et même lorsque le défenseur d’une
parascience met en avant les conclusions d’une expérimentation scientifique (comme le font
souvent Y. Lignon pour la parapsychologie ou E. Teissier pour l’astrologie), les contraintes
imposées par le genre “débat télévisé” interdisent que le protocole d’expérimentation soit
discuté, et la seule ressource des adversaires des parasciences est d’invoquer à leur tour les

résultats d’une expérimentation contradictoire ; bien malin le téléspectateur qui arrivera à se
forger une opinion à partir de l’invocation de divers travaux, qui tous se réclament de la
science et qui, dans le débat, fonctionnent bien plus souvent comme des arguments d’autorité
que comme de véritables preuves.
« Raisonner avec les astrologues, c’est boxer avec un oreiller de plumes : on l’enfonce en un
point, il se regonfle ailleurs », dit Michel Rouzé, ardent pourfendeur des parasciences. « Les
controverses continuelles que l’on connaît dans ce milieu ne servent à rien ; on ne pourra
jamais forcer quelqu’un à croire ce qu’il ne veut pas croire », affirme Rémy Chauvin, non
moins ardent défenseur des phénomènes paranormaux. « Un dialogue de sourds », voilà
l’évaluation que portent sur le débat tant les partisans que les adversaires des parasciences.
Mais un dialogue de sourds très télégénique : l’objet en est intriguant, les affrontements y sont
spectaculaires, le débat reste “grand public”. C’est peut-être parce qu’il constitue le stéréotype
des débats télévisés que le débat sur les parasciences occupera encore longtemps nos écrans.
3 ENCADRES :
Les adversaires des parasciences à la recherche d’une légitimité
Les partisans des parasciences constituent les invités “de plein droit” des émissions
consacrées à ce sujet. En revanche, la légitimité de la présence des adversaires des
parasciences est beaucoup plus incertaine. Si l’astronome E. Schatzman, interviewé pour
l’émission de J.-L. Delarue consacrée à l’astrologie, bénéficie d’une légitimité “statutaire”, sa
légitimité “thématique” ne va pas de soi. C’est bien un scientifique reconnu, mais pas un
astrologue : sa contribution au débat relève nécessairement d’un déplacement de compétence.
Encore plus problématique est le statut des invités “militants”, qui s’opposent par conviction
aux parasciences, mais qui ne peuvent mettre en avant un statut d’expert ou de témoin pour
justifier leur droit à prendre la parole. Tout récemment, A. Gillot-Pétré, auteur d’un ouvrage
sur les “charlatans du ciel”, s’est vu invectivé par J.-P. Petit, chercheur au CNRS convaincu
de la présence d’extraterrestres sur Terre. « Je n’ai peut-être pas vos diplômes, mais je ne suis
pas un imbécile », s’est-il exclamé, résistant aux tentatives de J.-P. Petit pour le réduire au
silence. Mais l’intelligence, à la télévision, a besoin de garants ; et l’intime conviction est un
bien faible argument pour qui veut s’attaquer aux parasciences.
Vulgarisation scientifique et parascientifique
Tant les partisans des parasciences que les scientifiques qui s’y opposent se réclament d’un
corps de savoir ésotérique, sur lequel ils appuient leur argumentation. Mais les émissions
auxquelles ils participent sont “grand public” : toutes les conditions sont réunies pour que les
débatteurs se livrent à une activité discursive d’explication, de traduction de savoirs élaborés
par des “spécialistes” afin de les rendre accessibles aux téléspectateurs “profanes”. En bref, il
faut vulgariser.
« Les ondes, ce sont tout simplement ce que l’on reçoit par exemple des galaxies, des étoiles ,
et même de certaines planètes », explique D. Ballereau, astronome, dans un débat sur
l’astrologie.
« Les signes sont comptés sur le zodiaque à partir du point vernal, c’est-à-dire du point où le
soleil apparaît au printemps », explique C. Michelot, médecin homéopathe et astrologue.
Les propriétés du discours de vulgarisation se retrouvent quasiment à l’identique chez les
partisans des parasciences et chez leurs pourfendeurs. Il n’existe aucun critère formel qui
permettrait de distinguer une vulgarisation scientifique d’une vulgarisation parascientifique.
Le genre “débat télévisé” mène-t-il forcément à un processus de nivellement des discours au
cours duquel se perdrait ce qui fait la démarche scientifique ? Quelle que soit la réponse
qu’on y propose, c’est une question qu’il faut se poser si l’on cherche à “dire la science” à la
télévision.

Témoignage et violence
Une grande partie de l’argumentation des partisans des parasciences repose sur des
témoignages qui visent à attester de l’existence d’un phénomène ou de l’efficacité d’une
technique “para”. Et les réfutations auxquelles ils donnent lieu sont potentiellement
extrêmement violentes. En effet, un témoignage a la valeur de celui qui le porte ; contester le
témoignage, c’est contester le témoin. Et la suspicion qui pèse sur le témoin est d’autant plus
lourde que le récit qu’il produit est exceptionnel : on ne doute guère de la santé mentale du
témoin d’un accident de voiture, mais on s’interroge déjà plus sérieusement s’il s’agit d’une
collision de soucoupes volantes. « Étiez-vous à jeun ? », demande M. Dumas à son invité,
après que celui-ci ait raconté comment il s’est retrouvé au volant de sa voiture avec deux
extraterrestres sur la banquette arrière. « Pauvre fou », soupirent les invités de T. Kieffer
devant le récit d’un témoin “contacté” par les “frères de lumière”. Au mieux, ce sont les
conditions matérielles de la perception qui sont contestées. Au pire, le témoin est traité
d’affabulateur, d’ivrogne, ou de fou.
C’est une caractéristique du débat sur les parasciences que les discussions sur les faits glissent
immanquablement vers des réfutations ad hominem (sur la personne) ; comment s’étonner
alors de la violence qui le caractérise si souvent ?
1
/
4
100%