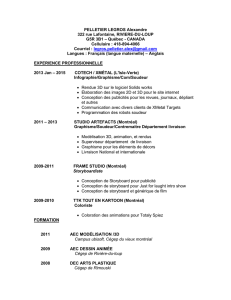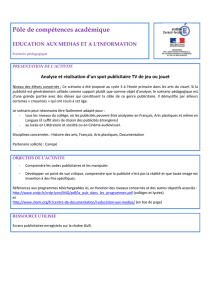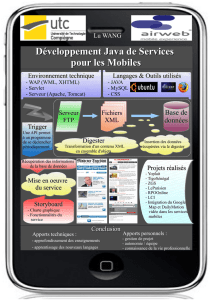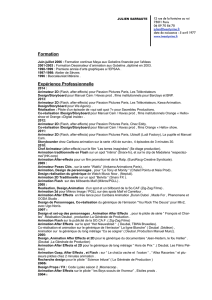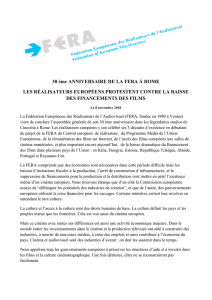Téléchargement entretien_avec_maxime_rebire

Entretien avec
Maxime Rebière
Quel a été votre
parcours ?
J’ai suivi une formation
à l’école Boulle qui
prépare à
l’architecture d’intérieur. Ensuite je
suis passé rapidement par les
Arts Déco et ai intégré le milieu de la
publicité dans les années 80 dans le
secteur du storyboard. Un jour on
m’a prévenu que Jean-Jacques Annaud
cherchait un storyboardeur pour
son film L’Amant. C’est ainsi que j’ai
intégré le milieu du cinéma. Puis les
choses se sont enchaînées
doucement, par le bouche à oreille.
Comment se fait-il que le métier de storyboardeur qui a toujours existé en France (tout au
moins depuis les années 50) connaisse actuellement un regain d’intérêt ?
Je crois que le storyboard existe depuis toujours, mais qu’il était pris en charge par les réalisateurs
eux-mêmes. Ils faisaient leurs propres croquis, leurs esquisses pour partager ce qu’ils avaient en
tête avec producteur et équipes techniques. Par exemple Fellini matérialisait ses idées par de
petits dessins pour donner ses intentions. C’est à partir des années quatre vingt dix que des
réalisateurs ont commencé à voguer entre publicité et cinéma et qu’ils ont été en contact avec des
storyboardeurs qui jusque-là ne travaillaient que pour la publicité. Par exemple Annaud est un
cinéaste qui a d’abord travaillé pour la publicité. Lorsqu’il s’est tourné vers le cinéma, il a gardé les
techniques qu’il avait précédemment pratiquées. Dans les années 1980, avec des amis qui travaillaient eux aussi dans la publicité,
nous avions tenté de faire une incursion dans le cinéma, entre autre avec un article en 1985 dans Le Technicien du film où nous
expliquions notre métier. Il n’y a pas eu à l’époque de retombées, les milieux étant alors très cloisonnés.
A quel moment de la préparation du film fait-on appel à vos services ?
L’étape storyboard intervient très en amont d’un projet, alors que le réalisateur et la production sont en train d’élaborer le plan de
travail. En effet, le storyboard permet d’évaluer la complexité des scènes, de visualiser l’étendue du projet, de pouvoir en étudier les
coûts avec les intervenants extérieurs.
Par exemple on peut évaluer grâce au storyboard les moyens techniques à mobiliser pour une cascade. Cela permet de faire des
choix avant même que le budget soit définitif.
Les différentes équipes peuvent estimer grâce au storyboard la faisabilité d’une scène. C’est une base de discussion en amont du
tournage pour évaluer solutions et coûts. Il leur permet aussi d’avoir des références. Lorsque j’ai travaillé sur Arsène Lupin, j’avais
remarqué dans certains tableaux que des femmes de la haute société portaient des bijoux dans les cheveux. Dans mes dessins de la
comtesse au casino, j’avais intégré ce détail que j’ai retrouvé sur les photos du tournage. Cela m’a fait plaisir que le costumier le
remarque. Cela prouve que le storyboard a pu l’aider dans son travail personnel de recherche. C’est assez gratifiant, car on ne sait
jamais vraiment comment notre travail est perçu, lu et interprété par les équipes techniques.
Par ailleurs le cinéma utilise aujourd’hui des technologies de pointe comme le numérique qui nécessitent obligatoirement une étape de
dessins.
Enfin lorsque des films ont du mal à se monter, des dossiers sont élaborés, sonstitués de dessins représentant les scènes clefs qui
donnent l’esprit, le ton du film. Dernièrement j’ai été contacté par la production d’un film encore actuellement en projet. Des photos de
repérage avaient déjà été effectuées, photos qui m’ont aidé pour ma partie. Le tout fait partie du dossier et donne une idée de l’action
et des paysages. Ce dossier permet la recherche de financements. Cela n’est pas véritablement du storyboard, mais s’y apparente
dans le sens où cela permet de définir une image du film.
Travaillez-vous plus pour le producteur ou pour le réalisateur ?
C’est une étape de production, mais c’est avec le réalisateur que je travaille, c’est une retranscription de sa vision des choses. On
cherche ensemble une image symbolique pour représenter une scène. Ces esquisses donnent un ton. C’est sa vision du film mais mes
suggestions peuvent lui permettre de fixer sur le papier des choses qu’il avait en tête et qui n’étaient pas toujours très arrêtées.
Vous est-il arrivé de storyboarder tout un film ?

Rarement, d’abord parce que certaines scènes ne le nécessitent pas. Par exemple une scène avec champ contre-champ entre deux
personnages dans un décor " simple ", ne nécessite pas d’être
storyboardée. On intervient surtout lorsqu’il y a des effets spéciaux, des
cascades, des scènes lourdes avec beaucoup de figuration, des scènes
qui se situent dans des lieux géographiques compliqués qu’il faut
visualiser précisément.
Sept ans au Tibet est le seul film que j’ai entièrement storyboardé. Pour
des raisons diplomatiques le tournage avait été interdit en Inde et se
faisait essentiellement en Argentine. Une deuxième équipe, dirigée par
Valli qui préparait Himalaya, était présente au Népal et devait filmer des
plans où les personnages principaux n’étaient pas reconnaissables.
Pour que ces plans soient raccords avec ce qui était tourné à quelques
milliers de kilomètres, ils avaient besoin d’une trace concrète, en
l’occurrence le storyboard.
Personnellement êtes-vous attaché à un style cinématographique,
à des metteurs en scène ?
Les films qui nécessitent des storyboards, sont des films à effets,
rarement des films d’auteur, intimistes. Il est vrai que les films qui peuvent m’émouvoir ne sont pas toujours ceux qui ont besoin de
mon travail. L’intérêt de mon travail réside beaucoup dans les rencontres et celles-ci peuvent être enrichissantes sur des films que je
n’irai a priori pas voir en salle.
Une des plus belles rencontres que j’ai pu faire a été celle avec Diane Kurys. Après une première rencontre pour un projet qui n’a
finalement pas abouti, elle m’a à nouveau contacté pour Les Enfants du siècle. Elle était face à une scène qui lui posait problème,
qu’elle ne savait pas comment envisager, les visions de Musset sous opium. Petit à petit je me suis investi dans ce projet auquel j’étais
très sensible. Nous avons parcouru Paris ensemble. Je lui ai montré des quartiers qu’elle ne connaissait pas et qui pouvaient convenir
au film. De fil en aiguille, je me suis vu proposer, alors que la production n’était même pas commencée, de mettre en forme ses
inspirations. J’ai élaboré un petit cahier reprenant les scènes clefs du film avec les différentes inspirations picturales qui pouvaient
aider à une meilleure compréhension de ce qu’elle avait en tête. Par ailleurs, parce que je travaille pour la maison de couture Lacroix,
j’ai proposé à Diane de travailler avec celui-ci. Elle lui a transmis un scénario, il a accepté de collaborer avec nous. Les liens se sont
tissés ainsi au fur et à mesure et je suis devenu une sorte de directeur artistique. J’ai fait tous les repérages avec Diane, ai participé au
tournage. Ça a été une vraie collaboration, une expérience très particulière, rare et très riche. J’ai fait des recherches, me suis
immergé dans des documentations, c’était fascinant.
Le storyboard a un côté bande dessinée. Est-ce quelque chose qui vous a attiré ?
Non. Le côté laborieux, dessiner avec une vraie régularité, ne m’a jamais attiré. Je n’avais pas la
patience. J’étais plus attiré par la recherche graphique que pouvait avoir à l’époque Loustal. Je
n’avais pas non plus l’envie de raconter des histoires, de scénariser les choses. Peut-être aurait-il
fallu une rencontre particulière qui n’a pas eu lieu. Aujourd’hui je travaille beaucoup sur les costumes,
j’ai par exemple travaillé pendant deux mois avec Catherine Leterrier sur les croquis de costumes de
Jeanne d’Arc. Sur Vatel, j’ai travaillé avec l’équipe décoration sur l’élaboration des plats etc.
Vous ne vous cantonnez donc pas qu’aux storyboards ?
On ne peut pas vivre avec cette seule activité. C’est un métier qui attire beaucoup de monde, or il n’y
a pas assez de films qui nécessitent d’être dessinés en amont et la production cinématographique
française actuelle ne va pas très bien. C’est souvent un poste que des producteurs préfèrent éviter
pour de simples raisons d’économie.
Adaptez-vous votre style aux différents projets dont vous êtes en charge ?
Le style du storyboard est en général assez enlevé, je ne rentre pas dans un univers de détails. Ce
sont des croquis, mais selon le sujet, je ne traite pas de la même manière. Il peut y avoir des
intentions très précises, de lumière par exemple. Dans un film historique, il y a un imaginaire très
précis, des costumes, une idée de l’époque qui rentre en jeu. Mes dessins du Pianiste ne sont pas les
mêmes que pour Mauvais esprit où il fallait être par exemple très précis sur les expressions du bébé. Le Pianiste était plus travaillé,
plus angoissant à cause du scénario. Evidemment lorsqu’on traite d’un projet pareil on est impliqué dans l’histoire. Il a fallu que je
dessine quelques scènes lourdes d’émotion, par exemple celle où les nazis viennent chercher une famille juive et jettent le grand-père
en fauteuil roulant par la fenêtre. Tout cela influe sur mon style. On ne peut pas dessiner de façon légère ce genre de film.
Pour un projet comme celui de Les ailes du courage, premier film de fiction pour un écran en imax, c’est à dire un écran haut de 7
mètres, il fallait envisager l’image de façon très inhabituelle. On ne peut pas envisager un gros plan de la même façon qu’en 35mm. Un
détail en plan très serré est impossible, il faut absolument de l’air sur les côtés. Il a fallu donc penser le film d’une toute autre façon et
le storyboard a permis de mieux visualiser tout cela, d’autant plus que le film était en trois dimensions.

Que deviennent vos dessins originaux, une fois le tournage terminé ?
C’est une propriété matérielle qui appartient au dessinateur. De toute façon parce que la plupart
sont élaborés au crayon, je ne peux même pas les photocopier, la qualité s’en ressentirait. Pour
les distribuer, je dois d’abord les scanner.
Les nouvelles technologies numériques ont-elles changé votre manière de travailler ?
Personnellement non. J’utilise toujours papier et crayons. Je travaille en direct avec quelqu’un,
c’est donc spontané. Je ne me vois pas assis derrière un ordinateur. Je fais mes croquis face au
réalisateur, même si je les retravaille par la suite. Il m’est arrivé d’utiliser photoshop pour donner
par exemple des valeurs de plan ou des lumières, mais c’est assez rare. D’autant plus qu’on
travaille souvent dans l’urgence. Je sais qu’il existe des logiciels de storyboard, mais je ne me
suis jamais vraiment penché sur ces outils.
Quel est votre statut ?
Lorsque j’ai débuté je travaillais pour la publicité où le statut d’intermittent n’existait pas. J’ai donc conservé depuis un statut
d’indépendant qui me convient bien et qui jusqu’à présent m’a permis de vivre correctement. Il y a des intermittents dans le milieu de
l’animation car ils travaillent longtemps et souvent enchaînent des tournages. Au cinéma nous ne sommes contactés que pour
quelques séquences et cela ne justifierait pas le statut d’intermittent.
Quelles sont les qualités d’un bon storyboardeur ?
La première est d’avoir un sens cinématographique du cadre. Il y a des choses très difficiles à transmettre par le dessin comme les
notions de flou. La déformation qu’on peut obtenir par différents objectifs est compliquée à rendre en image. Il faut avoir des notions
d’images dans l’espace. Il faut aussi savoir être à l’écoute d’un imaginaire, être prêt à l’échange. Le storyboardeur est un scénariste de
l’image.
Vous est-il arrivé de ne pas pouvoir rentrer dans l’imaginaire d’un réalisateur ?
Il m’est effectivement arrivé de ne pas comprendre ce que voulaient des réalisateurs qui par exemple me demandaient des choses en
me donnant des exemples de dessins qui me paraissaient contradictoires. Mais je dirai que c’est plus des personnalités avec
lesquelles je n’ai pas accroché, que des imaginaires que je n’aurais pas compris.
Propos recueillis par Cécile Blanc le 3 février 2004
Le métier de storyboardeur aujourd'hui, par Sophie Kovess Brun
En France, un grand pas a été franchi en 1999 avec la naissance de la FNSBF. L’espoir pour les storyboardeurs d’être enfin
représentés et défendus correctement dans l’industrie filmique. Symboliquement, cette date cristallise une prise de conscience
générale : le cinéma français ne peut se passer de ce corps de métier. Budgets délirants, recours quasi systématique aux effets
spéciaux… les sociétés de productions ont en effet tout intérêt à soutenir cette profession. Même si le storyboardeur va davantage
collaborer avec le réalisateur, son travail reste une trace vivante du bon déroulement et de la transparence d’une mise en scène à
venir. Grâce à cette technique, le producteur suit pas à pas les choix et les hésitations de découpage du réalisateur. D’emblée au cœur
des tourments, le storyboardeur se doit alors d’être d’une discrétion absolue et d’une sagesse exemplaire.
Avant d’aller plus loin, rappelons que le choix de storyboarder un film ne se pose pas dans les mêmes termes selon les genres. En
animation, le storyboard est obligatoire, tout comme en publicité, et pour n’importe quel passage de long métrage comportant des
effets spéciaux. Pour certains courts métrages, téléfilms, documentaires, reportages et longs métrages dépourvus de trucages, le
storyboard est facultatif. Nous pouvons dans ces champs précis parler du goût du réalisateur pour cet outil de pré production : un
véritable choix méthodologique se pose à lui.
Dans l’imaginaire collectif, il semblerait que le storyboard soit une technique américaine encore peu répandue en France. Et pourtant,
devant cette sommaire classification, on se rend bien compte combien les storyboardeurs doivent être sollicités. Ainsi la profession ne
vit-elle pas exactement dans la romance d’un grand réalisateur colérique et indécis, comme parfois on tente de nous le faire croire. La
plupart d’entre eux travaillent régulièrement pour de grandes maisons et naviguent volontiers entre la publicité, l’animation, la bande
dessinée, le cinéma, toutes les disciplines nécessitant une préparation graphique importante, faisant appel à des notions de
découpage, de rythme.
En amont, un phénomène persiste : la France s’américanise en produisant des films de plus en plus coûteux. Une grosse production,
hormis son budget, se définit par sa lourde préparation. Dans ce cas, un storyboard est d’office associé au projet, toujours selon le
modèle américain. Ce phénomène n’exclut en rien un emploi intimiste (auteuriste) du storyboard comme pense-bête ou outil de
communication par certains cinéastes qui vont parfois jusqu’à dessiner eux-mêmes leurs planches. Ces deux tendances ne sont en
rien antagonistes, bien au contraire, mais la réalité économique est celle des grosses commandes et des genres où le storyboard n’est

pas un choix mais une nécessité. Voilà ce qui maintient et développe la profession. Se pose alors naturellement la question de
l’enseignement pour assurer la relève et une meilleure exploitation de cette technique venue, qu’on le veuille ou non, tout droit de
Hollywood. C’est pourquoi le débat sur l’évident anglicisme du mot storyboard semble tout à fait déplacé, «scénarimage» ne portant
pas en lui l’histoire d’un outil né outre-Atlantique.
Une actualité ?
Le storyboard n’a pas échappé au progrès technique. Il entretient d’ailleurs un rapport très intime avec les nouvelles
techniques filmiques, qu’il s’efforce d’illustrer au mieux. Mais il absorbe aussi dans son fonctionnement propre ces
mêmes innovations. Ainsi, des logiciels de storyboard apparaissent, de plus en plus perfectionnés, avec notamment des
versions permettant une animation des dessins. Dessins qui sont parfois réalisés sur palette graphique, grâce à des
programmes perfectionnés imitant le trait à main levée. Mais la plus grande révolution reste l’apparition, avec le scan et
l’appareil photo numérique, de l’importation de toutes sortes de fichiers images, offrant des possibilités illimitées de
métissage entre photos du réel et dessins nés de l’imaginaire. Autrement dit, un décor réel peut être intégré en arrière-
plan, tandis que le personnage principal reste dessiné. On pourrait d’ailleurs imaginer que le storyboardeur parte de la
photo de l’acteur choisi pour créer une animation du personnage dans ce décor. Enfin, les outils proposés par les
nouveaux logiciels de storyboard ouvrent la palette des paramètres filmiques capables d’être contenus par une planche.
Ainsi le "flouté", maintenant largement utilisé, permet de traduire l’emploi de la longue focale, de même qu’en plaçant la
caméra dans un schéma (vue aérienne) l’image correspondante est aussitôt calculée et créée par le programme. Des
logiciels pourront peut-être, dans un futur proche, partir du scénario et du découpage technique pour réaliser le
storyboard correspondant, sans l’aide d’un dessinateur. Cette perspective occulte évidemment le rôle parfois
"thérapeutique" du storyboardeur, qui, selon certains (voir l’interview de Lionel Pouchard), aide les réalisateurs à formuler
leur mise en scène, à résoudre des problèmes de découpage. Ce pouvoir d’"accoucheur" reste une facette importante du
métier, qui s’articule souvent entre une phase d’élaboration solitaire et une phase de discussion avec le metteur en
scène. D’ailleurs, cette dimension peut parfois amener à réfléchir sur la paternité de certaines idées de découpage : qui
en est véritablement à l’origine ? La collaboration entre Lam Lee et Annaud en montre toute l’ambiguïté.
De fait la technologie et son évolution sont largement absorbées par certains storyboardeurs, sans réellement menacer
leur rôle dans l’industrie filmique.
Vers une vulgarisation, un enseignement du storyboard ?
Actuellement, on assiste à une sorte de business du storyboard. D’un côté, des professionnels animés par une
authentique volonté de présenter leur métier ; de l’autre, des financiers conscients du potentiel non exploité autour de ce
métier méconnu (mal connu ?), qui se disputent le marché. Résultat, des manuels ont vu le jour. Apparaissent alors des
stars du métier, telle Marcie Begleiter, dont le livre est devenu une sorte de bible aux États-Unis et qui organise de
véritables tournées. La France, moins réactive, suit néanmoins la tendance avec l’apparition cette année d’une revue
intitulée Storyboard. Nul doute qu’une génération tout entière sera très vite mise au parfum de cette technique. Bientôt, les
écoles de cinéma auront intégré cette discipline et l’enseigneront aux futurs techniciens dans la plus grande indifférence.
Le storyboard n’est désormais plus une curiosité, il est sorti de l’ombre pour notre plus grand plaisir ! Reste à présent à
lui offrir la place qu’il mérite sur le banc des éléments génétiques (appartenant à la genèse) d’un projet filmique.
La place du storyboardeur dans l’équipe filmique
La notion d’Atelier introduite récemment par François Thomas et Jean-Pierre Berthomé se penche sur la fabrication d’un
film. Du cinéma d’auteur, avec notamment en France la Nouvelle Vague, où seul le nom du réalisateur trône fièrement, à
celui jadis des studios où les producteurs se partageaient la vedette avec les stars sous contrat, l’industrie filmique n’a
jamais su assumer pleinement l’intrigante paternité de ses "usines à rêve". Ainsi, dans l’atelier, tout comme dans chez un
peintre de la Renaissance, de nombreux corps de métiers s’activent autour du maître, pour donner naissance à une ou
plusieurs œuvres à la fois. Si le maître décide des grands traits et fait office d’autorité, il répartit les tâches et délègue
volontiers à ses seconds. Parfois, il s’absente pour prospecter, laissant alors son équipe avancer les projets en suivant
ses instructions.
Le storyboardeur s’est depuis toujours inscrit dans cette équipe, tout comme les chefs opérateurs et les chefs
décorateurs. Il sait que son travail, tel l’apprenti, participe non pas à sa propre renommée, mais à celle de l’atelier.

1
/
5
100%