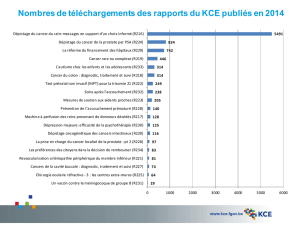27/04/2016 MARANDEL Marina D1 CR : CHAPON Julie BQ

BIOMEDECINE QUANTITATIVE – Dépistage
27/04/2016
MARANDEL Marina D1
CR : CHAPON Julie
BQ
Professeur CHAUDET
16 pages
Dépistage : éléments quantitatifs justifiant de sa mise en place et de son évaluation
A. Définition
Le dépistage est une action de prévention secondaire en santé publique (son rôle est de diminuer la
prévalence de la maladie ou de ses complications).
Il s'agit de détecter dans une population qui semble en bonne santé des personnes présentant :
– soit une maladie inapparente,
– soit un risque élevé pour une maladie donnée afin de pratiquer des examens complémentaires
ou d'appliquer des mesures préventives.
Le dépistage ne constitue pas un diagnostic. Il faut bien faire la différence entre ce que fait le dépistage et ce
que fait le diagnostic, le dépistage est un « tri » des patients.
Les sujets dépistés doivent obligatoirement suivre une démarche diagnostique permettant d'affirmer
l'existence de la maladie et éventuellement entamer un traitement.
1/17
Plan
A. Définition
B. Mesure de la performance des tests
I. Qualités intrinsèques
II. Qualités extrinsèques
C. Programme de dépistage et stratégies
I. Critères complémentaires du test
II. Biais de dépistage
III. Critère de choix d'un programme
IV. Évaluation du programme

BIOMEDECINE QUANTITATIVE – Dépistage
Le dépistage n'est pas le diagnostic
Test de dépistage Test diagnostic
- sur des personnes asymptomatiques
- pas de certitude diagnostique /!\
- individuel ou collectif
- sur des groupes à risque
- pas de décision thérapeutique
- aide à la décision de santé publique
- sur des personnes symptomatiques
- certitude diagnostique
- individuel
- sur patients
- débouche sur une décision thérapeutique
- aide à la décision diagnostique
Avantages
L'objectif est d'identifier le plus tôt possible un individu malade, permettant ainsi d'améliorer le pronostic de la
maladie. Donc on ne dépiste pas une maladie pour laquelle on n'a pas de traitement, cela ne servirait qu'à
angoisser le patient.
Ceci permet un allègement de la thérapeutique (la détection d'un cancer à un stade précoce permet de le
soigner plus facilement que s'il y a déjà des métastases).
Le dépistage entraîne une diminution de la prévalence de la maladie ou des complications (traitement des
malades), mais si on diminue les complications et que la principale complication est le décès, ceci veut en fait
dire qu'on augmente la prévalence de la maladie.
Il entraîne enfin une diminution de l'incidence de la maladie (dépistage des risques). CR : c'est le cas quand
par exemple quand on fait de la prévention primaire (dépistage des comportements à risque...).
Inconvénients
Il existe un effet iatrogène sur les personnes détectées à tort (faux positifs) : si on dit à une patiente qu'on
suspecte un cancer du sein à cause d'une image douteuse, on va lui créer de l'angoisse.
Mais il faut bien connaître les statistiques, car même si le test est positif, on n'est pas forcément malade (par
exemple, le test peut être positif mais seulement 10 positifs sur 100 sont des vrais malades).
Le dépistage entraîne un allongement du temps de la maladie même sans retard du décès ou de la guérison
(accroissement de la prévalence).
Il y a le problème de fausse réassurance des individus malades non détectés.
Il existe des risques liés au tests (par exemple l'exposition aux rayons X).
Il faut prendre en compte les conséquences psychologiques et sociales du dépistage. CR : les personnes
prennent conscience qu'elles appartiennent à des groupes à risque, elles réalisent le risque potentiel d'être
atteintes.
2/17

BIOMEDECINE QUANTITATIVE – Dépistage
B. Mesure de la performance des tests
I. Qualités intrinsèques
Problème de la qualité
L'objectif est de caractériser comme malades les individus malades et comme non malades les individus sains.
Le problème est que le dépistage n'est pas une procédure diagnostique.
Le dépistage n'est pas un reflet de l'état du patient, il permet de faire une déduction de l'étiquetage du patient
en fonction du résultat du test.
Le problème est que le test n'est pas parfait :
–seront considérés positifs la plupart des malades et une petite partie des individus sains
→ vrais et faux positifs.
–seront considérés non malades une grande partie des individus sains et une petite partie des
individus malades
→ vrais et faux négatifs.
Qualités intrinsèques Qualité extrinsèques
Les qualités intrinsèques d'un test : ce sont les probabilités que le test ait raison lorsqu'il dit qu'il est positif ou
négatif.
• La capacité à identifier les malades est la Sensibilité (Se) : c'est la probabilité que le test soit positif
si la personne est malade.
Proba ([Test+]/[M+])
• La capacité à identifier les non malades est la Spécificité (Sp) : c'est la probabilité que le test
soit négatif si la personne n'est pas malade.
Proba ([Test-]/[M-])
Ceci nécessite une méthode de référence permettant de connaître le statut malade / non malade des personnes
afin d'établir les qualités du test. CR : cette méthode de référence est aussi appelée Gold Standard.
3/17

BIOMEDECINE QUANTITATIVE – Dépistage
Calcul de la sensibilité et la spécificité
Ces valeurs sont des estimations, il faut donc définir un intervalle de confiance.
Exemple : On tire 100 malades et 100 non malades, on trouve 96 tests positifs chez les malades et 90 tests
négatifs chez les non malades → Se = 96% et Sp = 90%.
On estime alors l'intervalle de confiance :
•IC de la sensibilité M : effectif des malades
•IC de la spécificité
S : effectif des sujets sains
Influence de la taille de l'échantillon
4/17

BIOMEDECINE QUANTITATIVE – Dépistage
Ici, nous avons la même sensibilité de 90% pour 3 échantillons de tailles différentes (50, 500 et 5000). Lorsque
l'on regarde l'intervalle de confiance, on voit que quand on passe de l'échantillon de 50 à l'échantillon de 500,
l'intervalle de confiance diminue (il passe de [82;98] à [87;92]). De même lorsque l'on passe de 500 à 5000
individus, cet intervalle diminue, mais la différence est plus faible.
→ Lorsque la taille de l'échantillon augmente, l'intervalle de confiance diminue
Ceci montre qu'il faut avoir des échantillons de taille conséquente pour avoir un intervalle de confiance de
qualité, mais que l'on n'a pas besoin d'avoir des effectifs énormes. (Plus on augmente l'effectif, moins la
différence d'intervalle diminue).
Problème du seuil de positivité
Le test est souvent exprimé sous la forme soit d'une quantité (dosage), soit d'une valeur sur une
échelle ordinale.
Or on doit rentre un résultat binaire : le test est positif ou négatif.
Donc il faut trancher entre positif et négatif, et cela nécessite de déterminer un seuil de positivité qui impacte
énormément les qualités intrinsèques du test.
Seuil : cas du test parfait
Ici, les populations malades et non malades
sont totalement disjointes :
• Le test est négatif chez les sujets sains.
• Le test est positif chez les malades.
Seuil : cas habituel
Nous avons une distribution pour les sujets sains
avec une tendance centrale et des variations
individuelles, et une distribution pour les sujets
malades avec également une tendance centrale
et des variations individuelles. Ces distributions se
croisent.
Le problème est que l'on doit déterminer un seuil au
d dessus duquel le test est positif et en dessous duquel
il est négatif.
Or le fait de donner un seuil, nous donne 4 groupes de sujets : en plus des vrais positifs (VP) et des vrais
négatifs (VN), on retrouve des faux positifs (FP) qui sont des non malades se retrouvant dans la zone
test positif et des faux négatifs (FN) qui sont des malades se retrouvant dans la zone test négatif.
5/17
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%