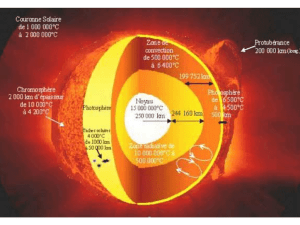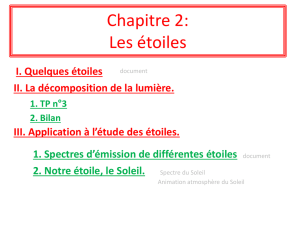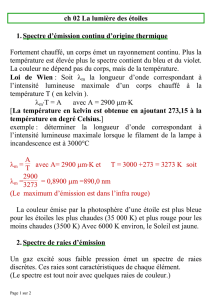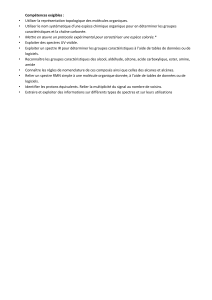Des spectres messagers de la lumière

Seconde – Sciences Physiques et Chimiques Activité 2.2
1ère Partie : L’Univers – Chapitre 2 Correction
1
Des spectres messagers de la lumière
La lumière est parfois le seul élément d’information dont nous disposons : c’est le cas pour les étoiles, y compris
le Soleil. En y regardant de plus près, il y a plusieurs types de spectres lumineux, et ces derniers ne sont pas
avares en informations.
1 – Spectres continus d’origine thermique
1.1 – Au laboratoire
A l’aide du spectroscope, observer le spectre d’une ampoule à incandescence
alimentée par un courant électrique plus ou moins intense.
Noter vos observations.
Remarque : principe de fonctionnement de la lampe à incandescence
En 1879, Thomas Edison invente et commercialise un ampoule à filament
de carbone, un peu après Joseph Swan (qui a moins bien protégé son
invention). Un filament, aujourd’hui généralement en tungstène, est
chauffé par effet Joule (comme les résistances électriques des fours, des
grille-pains ou des radiateurs) lorsqu’il est traversé par un courant
électrique. La température du filament est d’autant plus grande que
l’intensité du courant est élevée ; le filament s’amenuise à mesure qu’il
chauffe (sublimation) et finit par se rompre et l’ampoule par s’obscurcir
(dépôt de tungstène). Dans ce type d’ampoules, 95 % de l’énergie
électrique fournie sont convertis en chaleur alors que les 5 % restant
seulement sont convertis en énergie lumineuse.
Les ampoules halogènes (ci-dessous) contiennent un gaz qui protège le
filament et reculent sa fusion.
Ainsi, plus le filament est chaud et plus le spectre de sa lumière s’enrichit de couleurs bleues à
violettes.
faible intensité
température
croissante
n’apparaissent qu’à intensité élevée

Seconde – Sciences Physiques et Chimiques Activité 2.2
1ère Partie : L’Univers – Chapitre 2 Correction
2
1.2 – Le thermomètre des étoiles
Pour une température supérieure à 2 000°C, toutes les
radiations visibles sont présentes dans le spectre, mais elles
n’ont pas la même luminosité. La couleur dominante max
d’un spectre continu, c’est-à-dire la couleur la plus
lumineuse (dont l’intensité est la plus forte), renseigne sur
la température de la source : une dominante rouge
correspond à une température de 3 000°C environ (fer en
forge). Il faut atteindre plusieurs dizaines de milliers de
degrés Celsius pour observer une dominante bleue.
En ce qui concerne notre Soleil, la lumière qu’il émet peut
être considérée comme jaune ou blanche ; le Soleil est une
boule de matière extrêmement chaude, dont la lumière
contient toutes les radiations du violet au rouge, avec une
dominante jaune-vert (vers 560 nm).
Quelle(s) information(s) peut-on déduire de la couleur des étoiles ?
La couleur des étoiles renseigne sur leur température de surface : toutes sont blanches, mais elles ont
une dominante caractéristique de cette température plus ou moins élevée. Rigel a une température de
surface de 10 000 degrés et émet principalement dans l’UV ; sa teinte est bleutée. Bételgeuse a une
température de surface de 3 000 degrés et émet principalement dans l’IR ; sa teinte est rougeâtre. Le
Soleil, lui, a une température de surface de 5 500 degrés, et émet une lumière blanche à dominante
jaune-vert.
Spectres de « corps noir »
La température est indiquée en kelvins (K), sachant que
T(K) = T(°C) + 273
Le peintre hollandais Vincent Van Gogh écrivait en 1888 à sa sœur :
«Je veux maintenant absolument peindre un ciel étoilé. Souvent
il me semble que la nuit est encore plus richement colorée que le
jour, colorée des violets, des bleus et des verts les plus intenses.
Lorsque tu y feras attention tu verras que certains étoiles sont
citronnées, d’autres ont des feux roses, vers, bleus, myosotis. Et
sans insister davantage, il est évident que pour peindre un ciel
étoilé il ne suffise point du tout de mettre des points blancs sur
du noir bleu. »
Peu après, il peignait, au bord du Rhône, en Arles, le premier de ses
ciels étoilés (72,5x92cm, musée d’Orsay, Paris).
La belle constellation hivernale d’Orion, repérable
entre mille par ses feux et son baudrier (trois étoiles
alignées, Alnitak, Alnilam, Mintaka).
Les plus brillantes sont la supergéante rouge alpha
Orionis (Bételgeuse), en haut, et la supergéante bleue
beta Orionis (Rigel), en bas.

Seconde – Sciences Physiques et Chimiques Activité 2.2
1ère Partie : L’Univers – Chapitre 2 Correction
3
2 – Des spectres de raies
2.1 – Spectres de raies d’émission
Lampes dites « à économie d’énergie », « à basse
consommation » ou encore « fluocompactes ».
Le spectre obtenu en regardant les tubes néons qui éclairent la salle de classe est « bizarre » : la
plupart des couleurs sont présentes, mais le spectre n’est pas continu : les couleurs sont séparées par
du noir, comme s’il en manquait…
Le tube néon, inventé par Georges Claude au début du XXème siècle, est formé d’une ampoule de
gaz ; à l’origine, le gaz néon était à l’origine de la couleur rouge de ces ampoules ; aujourd’hui,
l’ampoule contient généralement un mélange de gaz dont de la vapeur de mercure Hg(g) – d’où la
nécessité de les recycler correctement.
Le principe de fonctionnement est proche de celui de l’éclair : entre les électrodes métalliques, un
forte différence de potentiel – assurée par un circuit électronique appelé ballast, petit boîtier qui
accompagne chaque tube néon – rend le gaz conducteur et provoque des décharges électriques au
sein du gaz. Lors de ces décharges, les atomes de gaz reçoivent un excédent d’énergie qu’ils
restituent rapidement sous forme d’énergie lumineuse. La couche de phosphore qui tapisse le verre
(et donne sa couleur blanche à l’ampoule) permet de supprimer la composante UV (185-254 nm) de la
lumière émise par le gaz.
Les ampoules fluocompactes ne sont que des néons miniatures et repliés ; au-dessus du culot, le
boîtier plastique est le ballast.
Le tube néon n’est aujourd’hui généralement plus rempli de gaz néon (qui générait une lumière
rougeâtre) ; on utilise des vapeurs de mercure et/ou de cadmium, mais on pourrait réaliser une
lampe à partir de n’importe quel gaz. Ci-dessous, la lumière de trois lampes, au néon (Ne), au
sodium (Na) et au mercure (Hg).
Qu’observe-t-on ?
Que contiennent ces ampoules ?
Pourquoi faut-il prendre soin de les recycler
correctement ?

Seconde – Sciences Physiques et Chimiques Activité 2.2
1ère Partie : L’Univers – Chapitre 2 Correction
4
On peut noter que ces spectres présentent des raies (la lumière ne contient que certaines couleurs) et
que ces raies diffèrent d’un gaz à l’autre : elles en sont a priori caractéristiques.
Le spectre de raies d’émission d’un gaz en constitue une signature, une carte d’identité.
2.2 – Spectres de raies d’absorption
Sur le mécanisme d’absorption
Sur un rétroprojecteur, muni d’une fente en carton, on
place une cuve contenant une solution fuschia de
permanganate de potassium et une cuve d’eau. Un réseau
(ou un prisme) placé au niveau de la lentille du rétro
permet la décomposition de la lumière après passage par
les deux cuves. Alors que l’on retrouve toutes les couleurs
de la lumière blanche produite par le rétro à travers la
cuve d’eau, la partie centrale du spectre a disparu après
passage par la solution de permanganate : cette dernière a
absorbé les couleurs manquantes, et on obtient un spectre
de bandes d’absorption.
La solution laisse passer les couleurs bleues et rouges qui
lui confèrent sa couleur fuschia.
Si les gaz sont capables d’émettre de la lumière lorsqu’ils sont excités, ils peuvent également absorber
en partie la lumière avec laquelle on les éclaire.
Chose remarquable, l’absorption se fait exactement pour les longueurs d’onde qu’ils sont
susceptibles d’émettre : spectres d’émission et d’absorption sont donc complémentaires, comme le
montre l’exemple de l’oxygène ci-dessus.
Ne
Na
Hg
Ici, on retrouve le spectre de raies d
’
émission de l
’
oxygène en
décomposant la lumière issue d’une lampe remplie de ce gaz
et allumée.
L
à, on éclaire en lumière blanche une ampoule (éteinte)
contenant du gaz oxygène : cette dernière absorbe certaines
couleurs qui se retrouvent manquantes sur le spectre obtenu.
On parle d’un spectre de raies d’absorption.

Seconde – Sciences Physiques et Chimiques Activité 2.2
1ère Partie : L’Univers – Chapitre 2 Correction
5
En conclusion, on distingue trois principaux types de spectres (lois de Kirchhoff).
2.3 – Applications en astrophysique
L’arc-en-ciel n’est autre que le spectre de la lumière solaire. Toutefois, avec un système dispersif plus
précis que les gouttes d’eau de l’atmosphère, on découvre des détails insoupçonnés.
C’est Fraunhofer qui le premier observa des raies sombres dans le spectre du Soleil au XIXème siècle.
Une étoile est une source primaire de lumière : elle produit sa propre lumière, contrairement à la
Lune, par exemple, qui est une source secondaire de lumière (elle diffuse la lumière solaire).
Chose surprenante, le spectre d’une étoile, comme le Soleil, est un spectre de raies d’absorption : plus
de 30 000 raies sombres peuvent être observées ! Comment est-ce possible ?
Réfléchissons sur le trajet emprunté par la lumière solaire avant de nous parvenir : partant du Soleil,
la lumière traverse un milieu gazeux : notre atmosphère, responsable de raies d’absorption dites raies
telluriques ; ces raies sont bien connues, et ont en fait déjà été retirées du spectre ci-dessus… Les raies
d’absorption restantes peuvent être interprétées à l’aide de la structure de l’étoile.
Spectre du Soleil (résolution moyenne)
S
pectre
continu
S
pectre
d
e raies d
’
émission
S
pectre
de raies d
’
absorption
Le Soleil est le siège de réactions
nucléaires à très haute température en son
cœur ; ces réactions conduisent à la
production d’une lumière parfaitement
blanche au niveau de la photosphère, mais
cette lumière traverse les couches externes
(chromosphère et couronne) avant de
nous parvenir : ce sont ces milieux gazeux
qui sont responsables des raies
d’absorption observées ! C’est une chance :
la position de ces raies devrait permettre
d’en déduire la composition de ces
couches…
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%