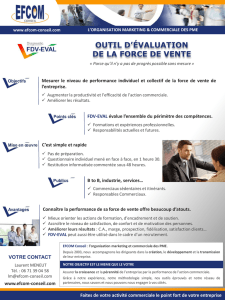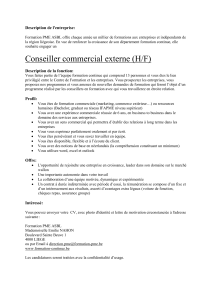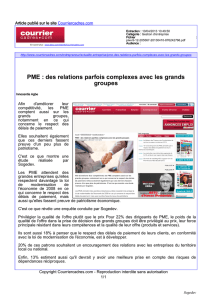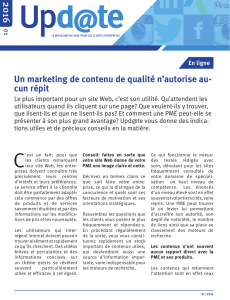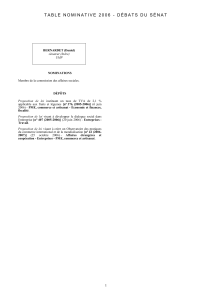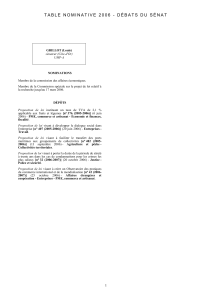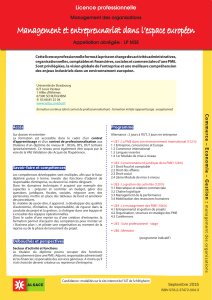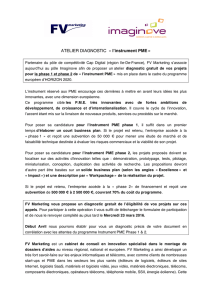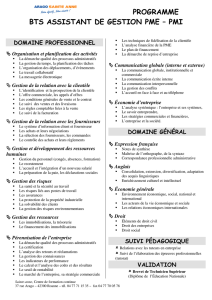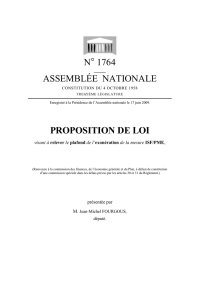Rôle de l`innovation dans l`amélioration de la qualité du

Rôle de l’innovation dans
l’amélioration de la qualité du
management et de l’organisation
des PME internationales
marocaines
Kaoutar BENYETHO
Doctorante
Laboratoire MADEO
Ecole Supérieure de Technologie d’Oujda (Maroc)
Mail: kaoutar_beny@yahoo.fr
Tel : 0677379946

Kaoutar BENYETHO 486
Dossiers de Recherches en Economie et Gestion : Numéro spécial : Décembre 2014
Résumé :
L’innovation ne constitue plus un choix, mais plutôt une nécessité absolue
dans la dynamique et le développement économique des organisations. Elle
représente l’une des qualités essentielles pour réussir à l’international. Outre
l’innovation technologique qui s’intéresse à la création ou l’amélioration des
produits et des processus de production, l’innovation organisationnelle permet la
restructuration et le développement de l’organisation des entreprises.
L’objectif de cette recherche est de vérifier si les PME internationales
marocaines donnent plus d’importance à l’innovation organisationnelle par
rapport aux PME nationales, en se basant sur un échantillon de 26 PME
marocaines.
Mots-clés : Innovation organisationnelle, internationalisation, PME
marocaines.
ROLE OF INNOVATION IN IMPROVING THE QUALITY OF MANAGEMENT
AND ORGANIZATION OF INTERNATIONAL MOROCCAN SMEs
Abstract:
Innovation is no longer a choice but an absolute necessity in the dynamic
and economic development of organizations. It represents one of the essential
qualities to succeed internationally. In addition to technological innovation that
focuses on the creation or improvement of products and production processes,
organizational innovation allows the restructuring and development of the
business organization.
The objective of this research is to determine whether the Moroccan
international SMEs give more importance to organizational innovation in relation
to national SMEs, based on a sample of 26 Moroccan SMEs.
Keywords: Organizational innovation, internationalization, Moroccan SMEs.

Rôle de l’innovation dans l’amélioration de la qualité du management… 487
Introduction
L’innovation est considérée comme l’un des principaux moteurs de la
compétitivité et du développement économique et social des organisations et des
PME en particulier.
En effet, il s’agit pour les entreprises de chercher à se différencier, en
mettant en œuvre des projets bien étudiés, à croitre, à échapper à la pression sur
les prix, en proposant aux consommateurs des expériences nouvelles et
surprenantes.
Boyer (1993)
avance que les entreprises qui réussissent sur leurs marchés
locaux échouent sur les marchés à l’exportation essentiellement parce qu’elles
auraient essayé d’y appliquer la même stratégie. En revanche, celles qui ont réussi
(ou qui sont en passe de réussir) appliquent une stratégie axée sur la qualité et
l’innovation qui ne leur permettrait sans doute pas de se développer sur un plan
local (Leroy et Torrès 2001).
L’innovation n’est pas uniquement la conception et le développement de
nouveaux produits et services, certes essentiels pour relancer la demande, en
allant au devant des attentes des clients, ou en créant de nouveaux marchés. Mais
l’innovation s’étend aussi aux améliorations apportées à l’organisation de la
fabrication, de la distribution, ou même de la conception en vue de développer la
capacité concurrentielle, la rentabilité, et/ou de rendre plus efficiente
l’organisation de l’entreprise concernée (Lemaire 1997).
Le présent travail s’intéresse à l’innovation organisationnelle qui touche à la
structure de l'entreprise, son organisation du travail et aux relations avec les
partenaires extérieurs.
Qu’en est-il des PME internationales marocaines ? S’intéressent-elles à
l’innovation organisationnelle? Existe-t-il des différences quand à l’organisation
entre les PME nationales marocaines et celles opérantes à l’international?
D’où la problématique suivante :
L’innovation organisationnelle constitue-t-elle une composante primordiale
au développement et à l’amélioration de la qualité du management et
d’organisation des PME marocaines à l’international ?

Kaoutar BENYETHO 488
Dossiers de Recherches en Economie et Gestion : Numéro spécial : Décembre 2014
1. Fondements théoriques :
1.1. Cadre théorique de l’internationalisation des PME
L’approche par les étapes ou les stage models constituent la base de
toute recherche concernant l’internationalisation en général et les PME en
particulier.
Cette approche considère l’internationalisation comme un processus
incrémentale et séquentiel, composé d’un ensemble d’étapes variant selon les
auteurs.
Deux voies d’analyse de l’internationalisation sont proposées dans cette
approche: le modèle Uppsala et les modèles d’Innovation :
Modèle Uppsala / U-Model
Johanson et Vahlne, dans un article publié en 1977, « The
internationalization process of the firm – a model of knowledge development and
increasing foreign commitments », ont montré à travers les résultats des études
empiriques antérieurs de Johanson et Wiedersheim-Paul (1975) effectués sur 4
entreprises industrielles suédoises (Sandvik, Atlas Copco, Facit et Volvo), que :
Plus l’expérience de l’entreprise sur les marchés d’accueil augmente,
plus elle engage d’avantage de ressources.
Les entreprises cherchent les marchés et pays psychiquement proches
pour exporter et s’y implanter, afin de minimiser la prise de risque. On parle alors
de la notion de distance psychique.
D’un autre côté, selon le U-model, le processus de l’internationalisation est
scindé en quatre étapes (Johanson et Wiedersheim-Paul 1975, cités par Sarrailh
2010) :
Activités d’exportations irrégulières et opportunistes ;
Exportation via un agent indépendant ;
Implantation d’une succursale/filiale de vente ;
Production dans le pays étranger.
Modèles d’Innovation / I-model
Le I-model regroupe plusieurs modèles, dont le plus connu est celui élaboré
par Bilkey et Tésar (1977), Cavusgil (1980), Reid (1981) et czinkota (1982).

Rôle de l’innovation dans l’amélioration de la qualité du management… 489
Ces auteurs considèrent l’internationalisation comme une innovation pour
la firme, ou un processus similaire aux étapes d’adoption d’un nouveau produit ou
de nouvelles technologies (Bouslama et Mbarki 2008).
D’une part, l’I-model selon Bilkey et Tesar (1977) cités par Le pennec (2009)
est fondé sur les mêmes principes de l’U-model, puisqu’il représente
l’internationalisation comme un processus linéaire, et souligne l’importance de la
distance psychique.
D’autre part, même si les modèles de la théorie d’innovation partagent tous
les mêmes concepts de base, il existe des différences quant aux nombre d’étapes
du processus d’internationalisation et au niveau du mécanisme initiateur du
comportement international de la firme (Ageron et Hault 2002, Andersen 1993,
cités par Bouslama et Mbarki 2008).
Mais malgré leur apports et poids évidents pendant les trois dernières
décennies, les théories d’internationalisation par étapes ont essuyé de
nombreuses critiques, parmi elles:
L’existence d’autres facteurs qui incitent les entreprises à
s’internationaliser (opportunités sur le marché visé, ressources et capacités de la
firme, compétences du dirigeant…), ce qui remis en cause et dépasse la notion de
distance psychique et celle d’expérience sur le marché d’accueil selon O’Grady et
Lane (1996) et de Evans et Mavondo (2002) cités par Cheriet (2008);
Axinn, Matthyssens, (2002) remettent en cause l’ensemble du processus
séquentiel d’internationalisation : « les travaux actuels tendent à remettre en
cause la portée générale des modèles d’Uppsala (U Model et I Model) car les
exceptions apparaissent aussi nombreuses que les comportements conformes à
ces modèles » (cités par Laghzaoui 2009);
Pour Wolff et Pett (2000) cités par Allali (2003), cette approche étapiste
est une voie très fréquemment utilisée dans l’internationalisation des PME.
Cependant, font-ils remarquer avec raison, beaucoup de PME naissent
internationales. Pour les désigner, Torrès (2004) reprend les appellations
d’International New Venture ou de Global Start-up. De même, certaines firmes
quand bien même elles ne naissent pas internationales, peuvent «brûler» des
étapes en sautant de l’exportation par exemple à la création d’une filiale à part
entière. D’autres choisiront sciemment de rester au stade de l’exportation.
Ces limites ont permis l’émergence d’autres approches notamment :
l’approche économique, la théorie des ressources et des compétences, l’approche
par les réseaux et la théorie de l’entreprenariat international.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%