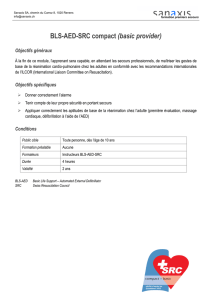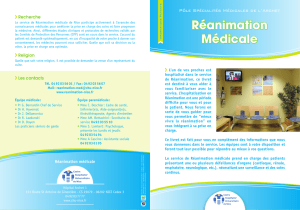Douleur en réanimation

DOULEUR EN RÉANIMATION
J-F. Payen, J-M. Pellat, C. Broux, C. Jacquot.
Département d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital Michallon, BP 217, 38043 Grenoble.
INTRODUCTION
Des progrès notables ont été réalisés ces 10 dernières années dans la prise en charge
de la douleur, qu’elle soit aiguë ou chronique, postopératoire, traumatique ou médicale,
chez l’enfant comme chez l’adulte. Il reste néanmoins des terrains peu explorés, en
particulier celui de la douleur en réanimation. Or, la douleur en réanimation est fréquente,
souvent intense, d’évaluation difcile chez le patient sédaté et ventilé.
1. ÉTAT DES LIEUX
Il est connu depuis longtemps que de nombreux patients gardent des souvenirs désa-
gréables de leur séjour en réanimation malgré les efforts importants des équipes soignantes
pour humaniser les soins. Cinq jours après leur sortie de réanimation post-chirurgicale,
63% des patients ont décrit leur douleur comme modérée à sévère [1]. Près de la moitié
d’une cohorte de 5 000 patients a rapporté avoir eu une expérience douloureuse pendant
son séjour en réanimation, et pour 15 % des patients, cette douleur était qualiée de
sévère [2]. La douleur, mais aussi le manque de sommeil, l’anxiété, des cauchemars et
des hallucinations sont les souvenirs les plus désagréables, évoqués par près de 70 %
des patients [3].
Les causes de douleur sont nombreuses en réanimation (Tableau I). L’aspiration
trachéale, l’ablation des drains thoraciques et la mobilisation du patient sont les gestes les
plus douloureux, avec des valeurs d’EVA comprises entre 30 et 100 mm [4, 5]. Comme
en période postopératoire, la douleur en réanimation a un fond continu auquel s’ajoutent
des pics douloureux lors de procédures douloureuses. Quelle que soit sa cause et son
mécanisme (excès de nociception, douleur neuropathique), la douleur en réanimation
peut être dangereuse, puisqu’elle peut conduire à des états d’agitation extrême, source
d’extubations accidentelles ou d’ablations inopinées de cathéters et de sondes [6].
An de limiter au maximum ces souvenirs désagréables et situations à risque, et aussi
de faciliter certains gestes, le recours aux médicaments hypnotiques et analgésiques est
devenu la règle en réanimation. Sous l’impulsion des sociétés savantes, des recomman-
dations ont été récemment éditées concernant l’emploi des agents sédatifs, analgésiques

MAPAR 2003
434
Questions pour un champion en réanimation 435
et myorelaxants. Les enquêtes les plus récentes font état de plus de 50 % des patients
sous sédation et analgésie en Europe et jusqu’à 90 % aux USA.
La sédation et l’analgésie comprennent habituellement l’association d’un hypnotique
(midazolam ou propofol) et d’un morphinique (morphine, fentanyl ou sufentanil), en
administration intraveineuse continue. Cependant, les posologies de ces agents sont déter-
minées le plus souvent de manière empirique, à la demande du personnel soignant [7], ce
qui expose le patient à un risque de surdosage. En réanimation, un surdosage peut conduire
à un allongement de la durée de ventilation mécanique et de la durée de séjour.
Aussi, l’enjeu actuel est d’adapter la posologie des analgésiques (et des hypnotiques)
aux besoins réels du patient. Pour cela, il faut disposer d’outils objectifs permettant de
mesurer le niveau adéquat d’analgésie chez le patient et améliorer notre connaissance
de la pharmacologie de ces agents en réanimation.
2. ÉVALUATION DE LA DOULEUR EN RÉANIMATION
Il est impératif de distinguer douleur et agitation, et pour cela, d’utiliser des outils
d’évaluation bien distincts. De nombreuses échelles de mesure du niveau de sédation
existent, la plus connue et la plus ancienne étant l’échelle de Ramsay. D’autres échelles
de sédation ont été proposées, dont la pertinence a été récemment analysée [8].
Cependant, la sédation n’est pas l’analgésie, et l’évaluation de la sédation ou de
l’agitation ne comporte pas habituellement de stimulus douloureux. A l’heure actuelle,
il n’y a pas de méthode unique pour évaluer la douleur en réanimation chez l’adulte.
Cependant, des outils existent, qui peuvent être classés en 3 catégories : auto-évaluation,
hétéro-évaluation, et mesure de paramètres physiologiques.
Tableau I
Principales causes de douleur en réanimation.
Liées à la pathologie initiale
Sans acte chirurgical • Foyers de fractures non stabilisés.
• Lésions de parties molles (œdème, brûlure).
• Para-ostéo-arthropathies neurogènes (POAN).
Avec acte chirurgical • Chirurgie thoracique, abdominale, ostéoarticulaire.
Liées aux soins
• Soins des plaies et des incisions chirurgicales.
• Pose de cathéter artériel.
• Pose de sonde urinaire et nasogastrique.
• Pose et ablation de drain thoracique.
• Aspiration trachéale, ventilation mécanique.
• Kinésithérapie, mobilisation, toilette.
• Posture, immobilisation prolongée.
Liées au patient
• Angoisse, sensation d’impuissance.
• Milieu socio-culturel.
• Expérience antérieure de la douleur.

MAPAR 2003
434
Questions pour un champion en réanimation 435
2.1. AUTOÉVALUATION
Chez le patient coopérant et communiquant, l’évaluation de sa douleur par auto-éva-
luation est évidemment la méthode la plus able (EVA, échelle verbale simple, échelle
numérique simple), sans spécicité propre à la réanimation. Cependant, la possibilité
d’y avoir recours est très rare en réanimation, en raison de la présence de troubles de
conscience, induits par la pathologie (traumatisme crânien) ou par la prescription d’hypno-
tiques. Enn, demander au patient de chiffrer sa douleur à la sortie de réanimation n’offre
que peu d’intérêt, car il s’agit dans ce cas d’une mesure globale et rétrospective.
2.2. HÉTÉROÉVALUATION
La situation fréquente de patients sédatés et ventilés, incapables de verbaliser leur
douleur, rend nécessaire une évaluation par un tiers. Une première approche est de coner
la mesure de la douleur aux soignants et/ou aux proches du patient par l’intermédiaire d’un
questionnaire. Or, il est bien montré que la douleur est systématiquement sous-évaluée
par 35 à 55 % des soignants [9]. De même, l’estimation de la douleur par les proches du
patient est correcte dans 50 % des cas seulement [10].
Une autre approche consiste à utiliser des échelles comportementales de douleur, ba-
sée sur l’expression corporelle à l’état de repos ou en réponse à un stimulus douloureux.
Pour être utilisables, ces échelles doivent répondre à des critères de qualité bien précis :
sensible, able et valide. Parmi toutes les échelles disponibles en pédiatrie, il faut citer
l’échelle de Comfort, spécialement conçue pour les enfants admis en réanimation [11].
Chez l’adulte, il avait été montré que des critères comportementaux (mouvements
du corps, expression du visage, posture) pouvaient être correctement mesurés par des
inrmières, et présentaient une bonne corrélation avec des mesures d’auto-évaluation [12].
C’est sur la base de ce travail et d’échelles pédiatriques que nous avons élaboré une échelle
de douleur pour le patient adulte, sédaté et ventilé [13]. L’échelle comporte l’observation
de 3 critères : l’expression du visage, le tonus des membres supérieurs, et l’adaptation
au ventilateur (Tableau II).
Nous avons ainsi montré que, chez des patients profondément sédatés (score de
Ramsay entre 4 et 6), des procédures douloureuses (aspiration trachéale, mobilisation
pour pansement) ont provoqué une augmentation signicative du score de douleur par
rapport à la situation de repos, 4 fois plus importante que les variations entraînées par
les soins non douloureux (pansement de voie veineuse centrale, pose de bas de conten-
Tableau II
Echelle comportementale de douleur (d’après [13])
Critères Aspects Score
Expression du visage • Détendu
• Plissement du front
• Fermeture des yeux
• Grimace
1
2
3
4
Tonus des membres supérieurs • Aucun
• Flexion partielle
• Flexion complète
• Rétraction
1
2
3
4
Adaptation au respirateur • Adapté
• Déclenchement ponctuel
• Lutte contre ventilateur
• Non ventilable
1
2
3
4

MAPAR 2003
436
Questions pour un champion en réanimation 437
tion). De plus, la mesure du score s’est avérée able, avec un coefcient de concordance
kappa égal à 0,74. Enn, la variation du score à la douleur a été fonction du type de
sédation/analgésie que les patients recevaient (sédation légère, modérée ou lourde).
Autrement dit, l’échelle a rempli les critères requis en termes de validité, de sensibilité
et de reproductibilité. Il n’y a pas pour le moment d’autres échelles pour quantier la
douleur chez l’adulte en réanimation. L’intérêt principal de cette échelle est de mesurer
l’intensité d’une réponse à un stimulus douloureux standardisé (aspiration trachéale). A
partir de cette mesure, il est possible de faire un ajustement des posologies antalgiques
pour des procédures douloureuses ultérieures selon un algorithme simple.
2.3. PARAMÈTRES PHYSIOLOGIQUES
La variation de données physiologiques simples (fréquence cardiaque, pression
artérielle, pression intracrânienne) peut reéter indirectement la réponse de l’organisme
à l’agression douloureuse. Mais de nombreux facteurs confondants existent en réanima-
tion (agents vaso-actifs, èvre, état hémodynamique instable), rendant ces paramètres
peu spéciques.
Les techniques de quantication de la profondeur de l’anesthésie ont aussi été testées
en réanimation : variabilité de la fréquence cardiaque, analyse quantitative de l’EEG
(spectre de puissance), potentiels évoqués auditifs, indice bispectral (BIS). De toutes ces
méthodes, la mesure du BIS en réanimation a été la plus explorée. Les études initiales
avaient montré que cette mesure était un bon reet de la sédation en réanimation [14].
En fait, la valeur de BIS est très variable d’un patient à l’autre (de 20 à 100), sans être
bien corrélée avec le niveau clinique de sédation [15, 16]. Ceci peut s’expliquer par la
présence de nombreux facteurs confondants (lésion cérébrale, analgésie, barbituriques,
mouvements musculaires,...), et de l’origine encore mal connue des variations du BIS
(sédation et/ou analgésie). A l’évidence, d’autres travaux sont nécessaires pour mieux
dénir la place de ces méthodes dans l’évaluation de la profondeur de la sédation et/ou
de l’analgésie en réanimation.
3. PRINCIPES THÉRAPEUTIQUES
Tout d’abord, quelques points sont essentiels :
• De la même façon qu’il faut évaluer séparément la sédation et l’analgésie, il faut
administrer de manière séparée les agents de la sédation et les agents analgésiques.
• La pharmacologie classique ne s’applique pas en réanimation. La notion de demi-vie
contextuelle, déterminée en anesthésie après quelques heures d’administration, n’est
pas valable en réanimation en raison d’une durée d’administration des produits sur
plusieurs jours. De plus, les sources de variations de la pharmacocinétique et de la
pharmacodynamie sont très nombreuses : hypovolémie, dénutrition, troubles méta-
boliques, syndrome inammatoire, sepsis, atteinte hépatique et rénale, hypothermie,
interactions médicamenteuses, épuration extra-rénale... Ces éléments imposent des
études pharmacologiques propres à la réanimation.
3.1. QUELS PRODUITS CHOISIR ?
Les morphiniques (morphine, fentanyl, sufentanil, rémifentanil) représentent
l’essentiel du traitement analgésique. Parmi ces produits, on serait tenté de retenir le
rémifentanil comme agent de choix en raison de ces propriétés pharmacologiques.
Deux arguments incitent à nuancer l’emploi à titre systématique de ce morphinique en
réanimation :

MAPAR 2003
436
Questions pour un champion en réanimation 437
1-Des études récentes en postopératoire de chirurgie cardiaque n’ont pas permis de mon-
trer que le rémifentanil était supérieur au fentanyl en termes de durée d’intubation, de
score de douleur, de durée de séjour en soins intensifs et à l’hôpital [17].
2- L’administration peropératoire de rémifentanil peut induire un état de tolérance et
d’hyperalgésie postopératoire, dose-dépendant, marqué par des scores plus élevés de
douleur et par une augmentation de la consommation de morphine [18]. L’hypothèse
est celle d’une activation des récepteurs N-méthyl-D-aspartate (NMDA) induite par le
traumatisme chirurgical, ampliée par l’emploi peropératoire des dérivés morphiniques
liposolubles, et prévenu par la kétamine à faible dose [19]. Il n’existe pas de données
à l’heure actuelle en faveur d’un état d’hyperalgésie en réanimation induit par les
morphiniques. Cependant, une tachyphylaxie au fentanyl et au sufentanil est fréquem-
ment observée [20]. Il est probable que le rémifentanil n’échappe pas à cette règle.
En somme, ces résultats soulignent que le choix du dérivé morphinique n’est pas en
soi déterminant, mais qu’il faudra privilégier l’adaptation permanente de l’analgésie aux
besoins du patient : évaluation régulière du niveau d’analgésie au repos et au cours de
stimuli douloureux (par exemple, aspiration trachéale), emploi d’algorithmes de prescrip-
tion des analgésiques. En optimisant l’analgésie (et la sédation), le bénéce attendu sera
un meilleur confort pour le patient, et une éventuelle réduction de la durée de ventilation
mécanique et de la durée de séjour [21]. Cela dit, le rémifentanil conserve une place de
choix, par exemple dans l’évaluation neurologique après agression cérébrale.
Quant aux antalgiques non morphiniques, on peut utiliser le paracétamol, le
néfopam, et les agonistes alpha2 centraux (clonidine, dexmedetomidine). Ces derniers
offrent l’avantage d’avoir un effet sédatif associé et de réduire la consommation des
morphiniques, mais peuvent être mal tolérés sur le plan hémodynamique. La place
des anti-inammatoires non stéroïdiens (AINS) est réduite en raison des troubles de
l’hémostase fréquents chez le polytraumatisé. Pour des raisons semblables, l’analgésie
locorégionale est peu développée en réanimation. Les blocs périphériques sont toujours
possibles, à condition dinstaller un cathéter pour permettre une administration continue
d’anesthésiques locaux et/ou de produits morphiniques. Quant aux blocs centraux, ils
sont utiles pour les traumatismes thoraciques peu sévères, responsables d’une atteinte
unilatérale ou peu étendue [22].
3.2. QUELS MODES D’ADMINISTRATION ?
La plupart du temps, l’analgésie est administrée de manière continue, par voie
systémique, à l’aide d’une seringue auto-pousseuse. Comme évoqué ci-dessus, ceci ne
correspond pas forcément à la réalité (pics de douleur déclenchés par les soins) et peut
conduire à un risque de surdosage. Il faut pouvoir titrer l’analgésie ; pour cela, on peut
proposer deux approches :
1- La manière la plus simple est de réaliser une analgésie continue minimale à laquelle
on ajoute des bolus d’un morphinique (de préférence d’action courte) au moment des
gestes douloureux.
2-
La manière la plus élégante sera d’appliquer le concept d’analgésie à objectif de
concentration. Ce concept commence à être étudié pour la sédation en réanimation
(propofol, midazolam) [23]. Il s’agit de décrire pour chaque produit un modèle liant
la pharmacocinétique et la pharmacodynamie (PK/PD) en fonction de la profondeur
de la sédation et de sa durée d’administration. Choisir une gamme de concentration
plasmatique d’un agent sédatif, responsable d’un effet clinique recherché (par exemple,
score de Ramsay à 2 ou à 5), devient alors possible à l’aide d’une seringue auto-
pousseuse munie du modèle pharmacocinétique. Pour l’analgésie, tout reste à faire
puisqu’il n’existe pas de modèle pharmacologique pour les morphiniques en réani-
mation.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%






![version texte en pdf [PDF - 18 Ko ]](http://s1.studylibfr.com/store/data/004644697_1-83180251b4ca74689c233f4d4ab516dd-300x300.png)