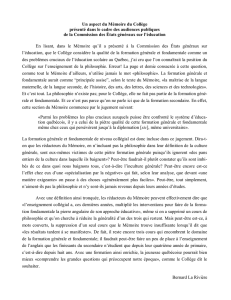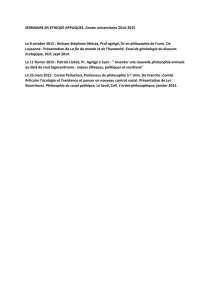La formation fondamentale, au cœur de la mission collégiale

La formation fondamentale, au cœur de la mission collégiale
Mémoire du département de philosophie du Collège de Rosemont
En dépit des multiples tâches constituant notre enseignement, particulièrement en
période de fin de session où il faut à la fois compléter les engagements déjà en cours ainsi que
préparer la prochaine rentrée scolaire, il nous semblait non seulement opportun mais nécessaire
de se positionner en tant que département sur les valeurs et finalités de l’éducation collégiale.
Nous soutenons que la formation générale commune telle que structurée en cours obligatoires
pour l’ensemble des étudiants du réseau collégial secteur technique et préuniversitaire,
représente une véritable formation fondamentale au cœur de la mission collégiale. Afin de
présenter les arguments en faveur d’une formation générale systématique et hiérarchisée, nous
allons en un premier temps critiquer la position du Conseil supérieur de l’éducation sur le rôle des
collèges et en particulier sur la formation générale. Par la suite, il s’agira de définir la mission de
la formation générale telle qu’elle s’intègre à la nouvelle approche programme en répertoriant les
valeurs et finalités qui sous-tendent ce projet éducatif. Parce qu’elle figure comme la discipline
que nous connaissons le mieux, en regard de nos compétences et propres expériences
pédagogiques, nous aborderons le rôle de la philosophie comme discipline de la formation
fondamentale.
Les recommandations du Conseil supérieur de l'éducation portant sur la formation
générale: incohérences et insuffisances de l'argumentation.
Dans un avis récent au ministre de l'éducation, le Conseil supérieur de l'éducation
recommande d'apporter des changements radicaux à la formation générale dispensée au
collégial. Les recommandations du Conseil s'appuient sur des considérations qui souffrent de
graves incohérences logiques et qui sont totalement insuffisantes pour justifier des changements
d'une telle ampleur. Nous croyons que le ministre serait mal avisé d'entériner des
recommandations qui reposent sur des bases aussi fragiles.
Parmi les sept recommandations du Conseil au ministre de l'Éducation relatives à la
formation générale, la sixième propose "d'assurer une plus grande diversité dans la composition
et la mise en œuvre de la formation générale, en faisant appel à un éventail de disciplines plus
large qui inclut, par exemple, le domaine des sciences de la nature, des sciences appliquées et
des technologies ainsi que le domaine des sciences humaines et sociales". La même
recommandation ajoute qu'il faut également assurer "à l'élève des possibilités de choix réels tout
en accordant un statut particulier à la langue d'enseignement…" (Avis, p. 117).

Le Conseil remet en question "l'exclusivité des disciplines qui définissent, encore
aujourd'hui, la formation générale commune" (p. 112). Les modifications proposées pourraient
s'actualiser dans différents scénarios. Le Conseil, dans son avis, en présente un qui aurait pour
effet de faire pratiquement disparaître les cours de philosophie au collégial et qui semble avoir
pour but de reléguer l'enseignement de la littérature et de la philosophie dans un "champ de
savoir" défini comme celui des "humanités classiques", qui n'occuperait plus qu'un sixième de la
composante de formation générale des programmes.
Pour proposer des changements aussi radicaux, il faut disposer de solides raisons.
Malheureusement, l'argumentation du Conseil ne résiste pas à l'examen de sa cohérence logique
et de sa capacité à fonder en raison les recommandations du Conseil.
Les propositions du Conseil semblent essentiellement motivées par deux prémisses, liées
l'une à l'autre.
(1) La formation générale actuelle, en particulier les premiers cours de français et de
philosophie, présenterait des difficultés particulières pour les élèves du secteur technique et
constituerait un obstacle important à l'obtention du DEC.
(2) Les difficultés éprouvées par les élèves du secteur technique dans les cours de formation
générale seraient moins grandes si l'on rendait les apprentissages "plus signifiants" pour les
élèves - par exemple en leur offrant des "réelles possibilités de choix".
A l'appui de la première prémisse, le Conseil note que les élèves du secteur technique
réussissent moins bien leurs cours de formation générale que les élèves du secteur
préuniversitaire et qu'ils réussissent moins bien leurs cours de formation générale que leurs
cours de formation spécifique. Les membres du Conseil font également référence au taux
d'échec élevé des premiers cours de français et de philosophie.
Mais dans le même avis, le Conseil nous met en garde : il faut éviter d'établir "une relation
indue entre la formation générale et l'obtention du DEC au secteur technique" (p. 100). Plusieurs
observations permettent en effet d'affirmer que la formation générale, telle qu'elle est
actuellement conçue, n'est pas un obstacle particulièrement important à l'obtention du DEC pour
les élèves du secteur technique.
• Le lien qu'on observerait entre la réussite du premier cours de français ou de philosophie
et l'obtention du DEC ne serait pas spécifique aux élèves du secteur technique,
puisqu'on observerait le même lien pour les élèves du secteur préuniversitaire.

• Aucune étude n'a permis de démontrer que la formation générale était plus responsable
qu'un autre facteur du faible taux d'obtention du DEC en formation technique.
• Le facteur déterminant de la réussite des cours de formation générale serait la moyenne
de l'élève au secondaire, et non son appartenance au secteur technique ou
préuniversitaire.
• La formation générale n'est pas le seul réservoir de "cours écueils", c'est-à-dire de cours
qui représentent des difficultés importantes pour les élèves du secteur technique et qui
peuvent avoir une influence sur le taux d'obtention du DEC. On retrouve de tels cours
dans la formation spécifique, par exemple les cours de mathématiques - qui ressemblent
à ceux de français et de philosophie dans la mesure où ils exigent une capacité similaire
d'abstraction et de cohérence logique.
• Observation qui invalide la prémisse principale du Conseil: la formation générale n'est
pas une cause prépondérante d'abandon, si l'on examine le dossier des élèves du
secteur technique qui n'ont pas obtenu leurs DEC. Une enquête menée auprès de ces
étudiants montre que les motifs principaux d'abandon résident dans le manque d'intérêt
des élèves pour le programme et dans l'obtention d'un emploi (Rheault, 2004).
Si ces observations sont véridiques, la première prémisse du Conseil est fausse et ne permet
plus de justifier les recommandations plutôt radicales du Conseil. Autrement dit, l'argumentation
du Conseil en faveur de ses recommandations souffre d'incohérence logique en établissant une
"relation indue entre la formation générale et l'obtention du DEC au secteur technique", tout en
conseillant d'éviter d'établir une telle relation.
On peut bien relever le "malaise" éprouvé par les membres du Conseil devant les "difficultés"
qu'éprouveraient les élèves du secteur technique (il faudrait dire en fait: les élèves ayant une
faible moyenne au secondaire) dans les premiers cours de français et de philosophie, mais le
ministre comprendra que de telles impressions ne peuvent pas justifier de manière rationnelle
des changements de l'ordre de ceux qui sont proposés par le Conseil.
Pour résoudre un problème qui, en réalité, n’existe pas, le Conseil estime qu'il faut ouvrir la
formation générale aux autres "champs du savoir" et offrir une "possibilité de choix réels" aux
élèves pour rendre leurs apprentissages plus "signifiants", c'est-à-dire plus près de leurs
"besoins" et de leurs "champs d'intérêt".
Mais, premièrement, cette recommandation perd sa raison d'être si la formation générale
n'est pas le facteur principal du faible taux d'obtention du DEC dans le secteur technique. La
formation générale actuelle ne représente pas de difficultés particulières pour les élèves du

secteur technique, mais pour les élèves ayant une faible moyenne au secondaire. (L'avis du
Conseil donne "l'impression" que ses membres veulent atténuer les difficultés de la transition du
secondaire au collégial vécues par les élèves plus faibles, en poursuivant au collégial une sorte
de "formation personnelle et sociale" améliorée. Le résultat sur la motivation des élèves qui
espèrent trouver, dans l'enseignement collégial, un niveau d'éducation supérieur au secondaire,
serait désastreux. Les membres du Conseil semblent avoir oublié que la motivation et
l'engagement cognitif de l'élève ne dépendent pas uniquement de la capacité d'un apprentissage
à répondre à leurs besoins et leurs intérêts immédiats. Les élèves seront motivés dans leur
apprentissage si celui-ci comporte suffisamment d'exigences et des "possibilités réelles" d'élargir
leur horizon - par exemple en leur apprenant à considérer les besoins et les intérêts de
l'ensemble de la société.)
Deuxièmement, cette recommandation du Conseil est inspirée par un préjugé courant à
l’égard de la philosophie, selon lequel elle ne parviendrait pas à soulever l’intérêt des élèves. Or
une enquête menée par des enseignants du collège de Rosemont, Diane Gendron et Martin
Provencher, a démontré « un net intérêt des élèves pour la philosophie, en relation avec leur
développement personnel » et que le « degré de difficulté rencontré dans le premier cours de
philosophie … est loin de constituer un obstacle aussi résistant » qu’on le laisse entendre trop
souvent1. Encore une fois, l’argumentation du Conseil ne réussit pas à démontrer la nécessité
des transformations qu’il recommande.
Troisièmement, le Conseil recommande d’ouvrir la formation générale à d’autres « champs
du savoir » que celui des « humanités classiques », dans lequel il semble confiner la philosophie
enseignée au collégial. Certes, le premier cours de philosophie s’appuie sur les grands modèles
antiques du traitement rationnel des questions philosophiques, c’est-à-dire sur un contenu qu’on
peut cataloguer parmi les « humanités classiques ». Mais l’apprentissage de la pensée critique et
de l’argumentation qui se fait à l’intérieur du premier cours constitue une compétence
transversale de grande importance, qui traverse tous les champs du savoir. Les conceptions de
l’être humain qui sont généralement étudiées dans le second cours ne se limitent pas, non plus,
au champ des « humanités classiques », à moins de considérer Marx, Freud, Sartre, Darwin et
compagnie comme des « classiques » des « humanités ». Quant au troisième cours, il est axé
sur des problèmes éthiques de la société contemporaine – ce qui serait un gage de l’intérêt des
étudiants, selon les membres du Conseil, puisque « l’actualité » du contenu semble déterminante
à leurs yeux.
1 Gendron, D. et M. Provencher, Philosopher au Collège, Philosophie et rationalité, enquête sur la
perception des étudiants, Rapport de recherche produit dans le cadre du Regroupement des collèges
PERFORMA, Collège de Rosemont, Janvier 2003, p. 97.

Si le Conseil estime que les devis ministériels privent l'enseignement de la philosophie de
tout "intérêt" pour les jeunes d'aujourd'hui, pourquoi ne recommande-t-il pas de les rafraîchir? Au
Collège de Rosemont, les professeurs du département de philosophie ont déjà démontré leur
capacité d’élaborer et d'enseigner des cours qui, tout en respectant les principes de l'approche
philosophique, débordent largement le champ des "humanités classiques", tout en s’intégrant de
manière harmonieuse dans le nouveau programme "Histoire et civilisation" offert au Collège.
L’argumentation du Conseil à l’appui de ses recommandations résiste mal à un examen
même superficiel. Les membres du Conseil semblent eux-mêmes avouer leurs lacunes lorsqu’ils
écrivent, dans leur avis, que « les raisons qui sous-tendent les changements proposés en
formation générale ne sont pas faciles à cerner » (p. 98). Peut-être est-ce parce que ces raisons
« ne sont pas toujours clairement exprimées » (p. 98). La moindre des choses, de la part d’un
organisme dont le rôle est de conseiller le ministre sur les orientations qu’il doit donner à
l’éducation des jeunes québécois, serait d’exprimer clairement les raisons qui justifient leurs
recommandations, de trouver des raisons qui soient suffisamment fortes et d’éviter l’incohérence
qui prive leur discours de toute valeur pour ceux qui estiment que les choix éducatifs doivent être
rationnels.
La formation générale, une formation fondamentale
Le théoricien Edgar Morin 2 soutient que notre époque, parfois qualifiée de
«postmoderne» serait marquée par trois caractéristiques principales : 1) l’absence de vérité
fondamentale, 2) l’impossibilité logique d’un fondement premier, car on peut toujours trouver un
fondement au fondement, et 3) parce que le réel nécessite de recourir à quelque chose d’autre
pour se justifier, il n’est pas fondamentalement réel. Non seulement ébranlée par une
méthodologie sceptique, qui naturellement initie toute pensée critique, cette position relativiste
rend pratiquement impossible toute constitution positive du savoir, tout enseignement. Or, en
suggérant que la formation générale soit dénaturée en l’ouvrant à l’ensemble des
disciplines (arts, lettres, sciences pures, sciences humaines…) le Conseil supérieur de
l’éducation nous semble adopter d’une certaine façon une thèse relativiste. En effet, la formation
générale y apparaît comme un amas disparate de cours optionnels bâti selon les goûts et
caprices de l’étudiant-client. Cette forme de relativisme, insidieuse et si fréquente dans nos
sociétés pluralistes sans repères, mène à une sorte de subjectivisme. Sera vrai seulement ce qui
est choisi, acheté. Pour paraphraser Descartes, je choisis donc je suis. Or, même si la relation
pédagogique doit prendre en compte la nature de l’apprenant, il faut absolument éviter le culte
2 MORIN, Edgar. La méthode 3. La connaissance de la connaissance 1, Paris, Seuil, 1986. Pour une
présentation critique des thèses d’Edgar Morin, voir MORIN, Lucien et BRUNET, Louis. Philosophie de
l’éducation, Québec, Presses de l’Université Laval, 2000.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%