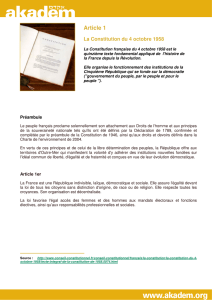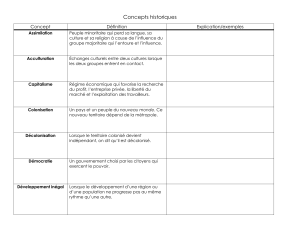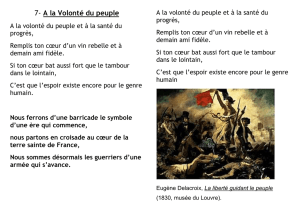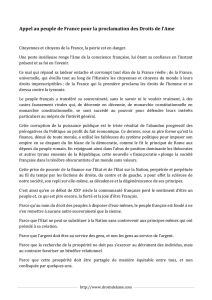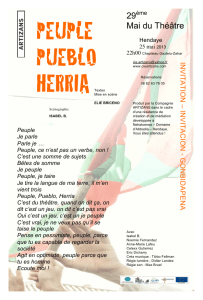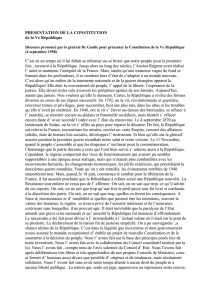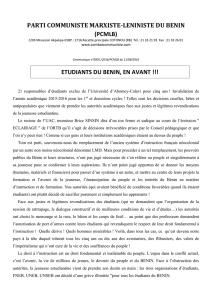Qu`est-ce qu`un peuple ?

Qu’est-ce qu’un peuple ?
Micka¨el Zakaria
To cite this version:
Micka¨el Zakaria. Qu’est-ce qu’un peuple ?. Philosophie. 2013. <dumas-01058377>
HAL Id: dumas-01058377
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01058377
Submitted on 25 Mar 2015
HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destin´ee au d´epˆot et `a la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publi´es ou non,
´emanant des ´etablissements d’enseignement et de
recherche fran¸cais ou ´etrangers, des laboratoires
publics ou priv´es.
Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0
International License

Mickaël ZAKARIA
Qu'est-ce qu'un peuple ?
Mémoire de Master 2 « Sciences humaines et sociales »
Mention : Philosophie
Spécialité : Histoire de la philosophie & philosophies du langage
sous la direction de M. Philippe SALTEL
Année universitaire 2012-2013
1

2

Remerciements
Je souhaite tout d'abord remercier mon directeur de mémoire, M. Philippe Saltel,
Professeur des universités et directeur de l'UFR sciences humaines à l'Université
Pierre Mendes France de Grenoble, pour le temps conséquent qu'il m'a accordé, ses
remarques et ses corrections qui m'ont considérablement aidé durant mes recherches.
J'ai beaucoup appris à ses côtés et lui en suis sincèrement reconnaissant.
J'adresse de chaleureux remerciements à mon assesseur, M. Denis Perrin, Maître de
conférence en philosophie à l'Université Pierre Mendes France de Grenoble, pour
l'attention qu'il a porté à la correction de mon projet de mémoire.
Je tenais également à remercier Mme Karine Laborie, docteur en philosophie et
chargée de cours à l'Université Pierre Mendes France de Grenoble, pour ses précieux
conseils, qui m'ont donné envie d'orienter mes recherches sur des questions de
philosophie générale.
Je souhaite remercier spécialement Maïmouna Camara pour son soutien et sa patience
tout au long de ce travail.
3

Résumé
La portée polémique des questions se rattachant à la notion de peuple est ancrée dans
divers débats sur la nature de l'homme, de la société, et des rapports qu'ils
entretiennent. Le « peuple » est également un concept utilisé en sciences humaines,
qui lui associent différentes définitions (ensemble de citoyens, de prolétaires, de
croyants...). L'ambition première de cette étude est d'expliquer l'origine de cette
polysémie en retraçant sa généalogie. En ce sens, nous verrons si le champ
épistémologique du peuple se limite à la seule philosophie politique, ou s'il recouvre
également d'autres aspects (sociaux, juridiques, culturels ou encore langagiers).
Partant, il s'agit d'un travail de philosophie générale visant à rendre compte de la
structure conceptuelle qui sous-tend les définitions du peuple. L'enjeu philosophique
de ce mémoire est d'apporter des éléments de résolution au problème de
l'indépendance, de la (re)naissance d'un peuple.
Abstract
The polemical reach of the questions being connected with the notion of people is
anchored in diverse debates on the nature of the man, the society, and the
relationships which they maintain. The « people » is also a concept used in human
sciences, which associate him various definitions (group of citizens, proletarians,
believers). The first ambition of this study is to explain the origin of this polysemy by
redrawing its genealogy. This way, we shall see if the epistemological field of the
people limits itself to the only political philosophy, or if it also recovers other aspects
(social, legal, cultural or still linguistic). Therefore, it is about a work of general
philosophy to report the abstract structure which underlies the definitions of people.
The philosophic stake in this report is to bring elements of resolution to the problem
of the independence, the (re)birth of people.
4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
1
/
99
100%