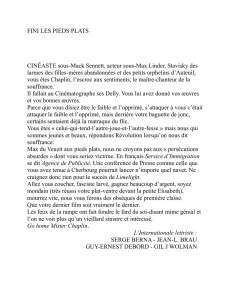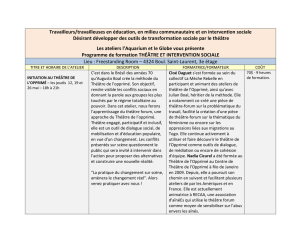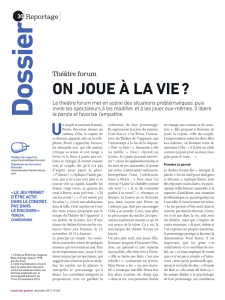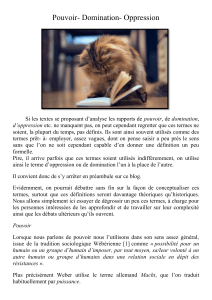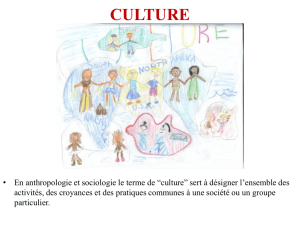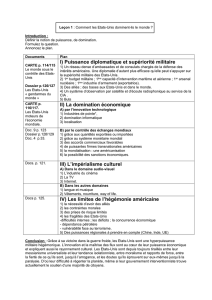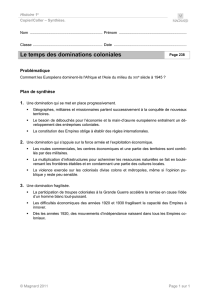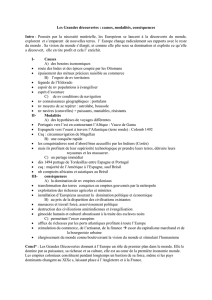Mémoire de Myriam Cheklab sept 2015_NAJE

!"#$%&'(')%*+%&*+%'
,-.*"$/012'30&4"$/01'%$'51$%&6%1$/01'70*/"8%'
!"#$%&'%(#)*+,$&(%-.)(-,()&,)'-./)+0)'&)1%0)
)
)
)
!,!95),':,'),;<,);<,'
'
!
T!r!a!v!a!i!l!l!é!e!!!!a!u!!!!c!o!r!p!s!
20)$-3"4)$-550)'01%03)+0)(3&.46-35&(%-.)4-$%&'0))
+&.4)'&)"3&(%7,0)+,)(8#9(30)+0)':-""3%5#;0)
Une$recherche$encorporée$avec$la$Compagnie$N.A.J.E.$
$
)
)
)
<=3%&5)>80?'&@)
5=3%&5;$80?'&@A/5&%';$-5)
)
!-,4)'&)+%30$(%-.)+0)<&3(%.0)<-3%440)0()B0&.C2-,%4)20)D3&.+)
)
)
E..#0)FGHICFGHJ) )

2
« Throw away abstraction and the academic learning, the
rules, the map and compass. Feel your way without
blinders. To touch more people, the personal realities and
the social must be evoked - not through rhetoric but
through blood and pus and sweat.
Write with your eyes like painters, with your ears like
musicians, with your feet like dancers. You are the
truthsayer with quill and torch. Write with your tongues
of fire. Don't let the pen banish you from yourself. Don't
let the ink coagulate in your pens. Don't let the censor
snuff out the spark, nor the gags muffle your voice. Put
your shit on the paper. »1
Gloria Anzaldúa (This bridge called my back, 1981)
1 Traduction : « Débarrasse-toi de l’abstraction et des études universitaires, des règles, de la carte et du compas.
Avance sans œillères. Pour toucher plus de gens, les réalités personnelles et le social doivent être évoqués, non
par la rhétorique mais par le sang et le pus et la sueur. Ecris avec tes yeux comme les peintres, avec tes oreilles
comme les musiciennes, avec tes pieds comme les danseuses. Tu es l’oracle, plume et flambeau en main. Ecris
avec tes langues de feu. Ne laisse pas le stylo te bannir de toi-même. Ne laisse pas l’encre coaguler. Ne laisse pas
la censure éteindre l’étincelle, ni que l’on étouffe ta voix. Couche ta merde sur le papier. »

3
7044"/&%'
K0503$%050.(4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)L)
E1&.(C"3-"-4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)M)
E.(#$#+0.(4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)N)
O.(3-+,$(%-.);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)HI)
="&$/%'>?'</#$0/&%#'*&0/#@%#?'A+@B$&%'-%'8C0DD&/4@?%'%$'@-.*"$/01'
D0D.8"/&%'??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????'(E'
Théâtre de l’opprimé.e et éducation populaire en Amérique latine ............................................ 20)
Genèse : Augusto Boal et le mythe fondateur ............................................................................... 20)
La pédagogie des opprimé.es de Paulo Freire ............................................................................... 23)
(Très) petite histoire de l’éducation populaire en Amérique latine ............................................... 24)
Une pensée du corps dans l’éducation populaire latino-américaine .............................................. 25)
Théâtre de l’opprimé.e et éducation populaire en France .......................................................... 26)
Petite histoire de l’éducation populaire et de la culture ................................................................. 26)
Le théâtre de l’opprimé.e aujourd’hui ........................................................................................... 29
="&$/%'(?'F%'*0&D#'-%'8"'*+%&*+%.#%?'54D8/*"$/012'4@$+0-%#'???????????????????'G>'
L’entrée sur le terrain ...................................................................................................................... 31)
La compagnie N.A.J.E et le « grand chantier » ............................................................................. 31)
Le corps de la chercheuse : premier contact .................................................................................. 34)
Le paradoxe de la posture de recherche ......................................................................................... 34)
Observation versus participation ................................................................................................... 35)
Observation participante et implication ......................................................................................... 35)
Observation participante et rapports de pouvoir ............................................................................ 36)
Savoirs situés et vision encorporée ................................................................................................ 38)
Savoirs incarnés, science et enjeux de pouvoir ............................................................................. 39)
Participation observante et recherche-action ................................................................................. 41)
Ecoute et non-directivité .................................................................................................................. 43)
L’entretien non-directif .................................................................................................................. 43)
Interlude - Almas en pena ........................................................................................................................ 45)
Le choix des personnes interviewées ............................................................................................. 47)
Redistribution de la parole ............................................................................................................. 48)
Ecoute, intuition, improvisation : une contre-méthodologie ? ..................................................... 51)
L’écoute contre l’observation ........................................................................................................ 51)
Méthodologie de l’improvisation .................................................................................................. 53)
Critique de la méthode et transdiciplinarité ................................................................................... 55)
Parler du corps ................................................................................................................................. 56)
Dire le corps ................................................................................................................................... 56)
Ecrire le corps ................................................................................................................................ 57
="&$/%'G?':.'*0&D#'-04/1@'".'*0&D#'&@H8%I/H?';0&D#2'"DD&%1$/##"J%#'%$'
-04/1"$/01'??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????'KE'
Savoirs incarnés. L’apprentissage de la domination .................................................................... 60)

4
Apprentissages informels et incorporation des savoirs ................................................................. 60)
Hexis corporelle et incorporation des rapports sociaux ................................................................. 61)
Inconscient du corps et éducation à la soumission ........................................................................ 63)
Interlude – La créature ratée .................................................................................................................... 66)
Penser le corps et la complexité des rapports de domination ...................................................... 67)
Le corps dans la pensée postcoloniale ........................................................................................... 67)
Interlude – Cueca de la migrante ............................................................................................................. 69)
Le marquage des corps .................................................................................................................. 69)
Les masques blancs chez Frantz Fanon ......................................................................................... 71)
L’apport du féminisme décolonial ................................................................................................. 73)
Corps, pouvoir et performativité .................................................................................................... 75)
Le corps discipliné chez Michel Foucault ..................................................................................... 75)
Corps et performativité chez Judith Butler .................................................................................... 77)
Théâtralité de la vie quotidienne et masques sociaux chez Augusto Boal .................................... 79)
L’entrée dans une démarche réflexive ........................................................................................... 81)
Mise en réflexivité et auto-observation ......................................................................................... 81)
Mise en conscience du corps et expérience sensorielle ................................................................. 82
="&$/%'L?'F%'*0&D#'-M1"4/#@?';0&D#'%1'&@#/#$"1*%2'@4"1*/D"$/012'
"8$@&/$@'???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????'NO'
Le corps comme espace de résistance ............................................................................................. 85)
Démécanisation du corps et construction de nouveaux rôles ........................................................ 86)
Un nouveau rapport à l’espace ...................................................................................................... 87)
Le corps comme arme politique .................................................................................................... 88)
La dynamisation : une mise en mouvement du corps et de l'esprit ............................................. 90)
Corps et esprit au théâtre de l’opprimé.e ....................................................................................... 90)
Dynamisation et augmentation du pouvoir d’agir ......................................................................... 93)
L’exemple d’Allison ...................................................................................................................... 95)
Une dimension sensible pour la construction d’un espace commun ........................................... 95)
La construction d’un groupe solidaire ........................................................................................... 96)
La présupposition d’égalité ............................................................................................................ 98)
Régulation du groupe et la question de la place ............................................................................ 99)
Un espace safe ............................................................................................................................. 102)
Bienveillance, non-jugement et confidentialité ........................................................................... 104)
Transformation du rapport au monde et partage du sensible ....................................................... 107)
Dépasser les dichotomies : la construction d’une nouvelle altérité ........................................... 108)
Une conscientisation des privilèges ............................................................................................. 109)
Dynamique de la domination et point de vue situé ...................................................................... 112)
Un espace pédagogique entre fiction et réalité ............................................................................ 113)
Sortir du paradigme de l’oppression : le théâtre de l’opprimé.é comme borderland .................. 115
>-.$',4%-.);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)HHN)
P%@'%-/3&"8%0);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)HFF)

5
'
'
'
'
'
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
1
/
129
100%