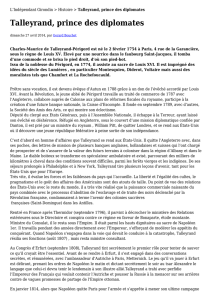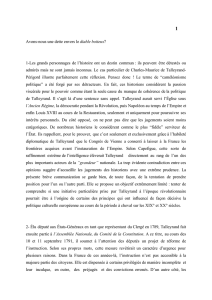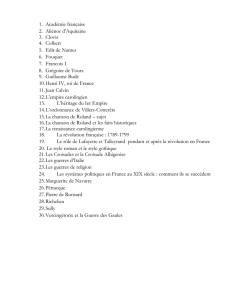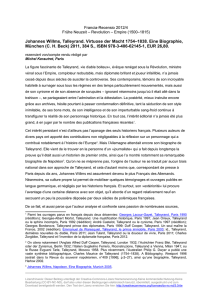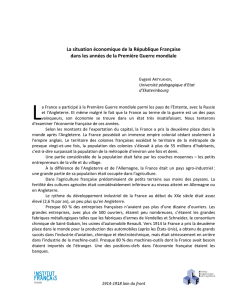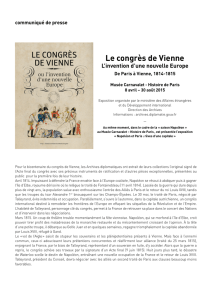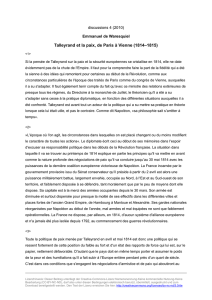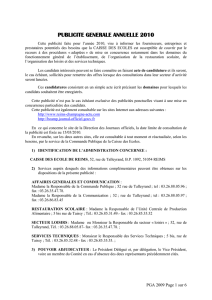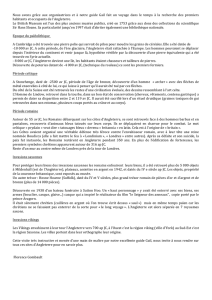Talleyrand, prophète de l`entente cordiale

MAURICE
SCHUMANN
TALLEYRAND
PROPHETE
DE
L'ENTENTE CORDIALE
A Marie-Thérèse
Quiniou,
dont
les
travaux
d'érudition
ont
éclairé
cette
analyse.
L
e 29
septembre
1831, la
séance
de la Chambre des lords sortit
de l'ordinaire. La France y fut quelque peu
malmenée,
ce qui
n'étonna
personne
;
l'ambassadeur
de France y fut pris à partie, ce
que plusieurs gentlemen
jugèrent
choquant.
L'incident
ne
mérite-
rait pas
d'être tiré
de
l'oubli
si le diplomate
attaqué
n'avait pas été
un
illustre dignitaire qui n'avait rien perdu, à soixante-dix-sept ans,
de son
habileté légendaire
et si son
défenseur
le plus
véhément
n'avait été
l'Anglais
le plus
célèbre
de son
temps.
La
polémique
fut
allumée
par le marquis de Londonderry,
frère
de Castlereagh qui
s'était suicidé
une dizaine
d'années
plus tôt
après
avoir
représenté
le
gouvernement de Sa
Majesté
George III au
Congrès
de Vienne :
«
La
France
—
s'écria-t-il
—
cherche
par
tous
les
moyens
à
faire
plier
l'Angleterre.
Je ne
crois
pas
qu'on
puisse
trouver
dans
le
monde
entier
un
caractère
semblable
à
celui
de
l'astucieux
person-
nage
qui la
représente
ici.
Quand
on
voit
nos
ministres
s'empresser
autour
d'un tel
homme,
on ne
ressent
que du
dégoût.
»
Le
chef de l'opposition (à laquelle
appartenait
le marquis de
Londonderry)
ne voulut pas laisser au gouvernement le
soin
de rele-
ver
le
défi.
Ce fut
ainsi
que le duc de
Wellington prononça
le
pané-
gyrique
du prince de Talleyrand : «
Tout
en
défendant
son
pays
avec
autant
d'art
que de
fermeté,
dit-il,
il a su se
comporter
envers
les
autres
avec
honneur
et
droiture
; en
conscience,
je
vous
déclare
qu'aucun
homme,
public
ou
privé,
n'a
jamais
été
dépeint
sous
des
couleurs
plus
fausses.
»
Presque au
même
moment,
l'ambassadeur
Talleyrand recevait
deux visiteurs
français,
grands
écrivains
l'un et
l'autre,
qui
portè-
rent
sur leur
hôte
des
jugements
aussi contradictoires que ceux de
Wellington
et de Londonderry. Le premier
—
Jules
Michelet
—
fut

542
TALLEYRAND
et
resta
scandalisé
:
«
L'Angleterre,
fulmina-t-il,
est
pour
lui
l'idéal
du
monde
; il est
anglais
au
point
de
nous
faire
frémir.
» L'autre
—
Alphonse de Lamartine
—
composa,
trente
ans plus tard, un
portrait de Talleyrand auquel ne
manquent
ni les
nuances
ni la
sérénité
: « Il y a une
lumière
qui
vient
de
l'esprit
et une
lumière
qui
vient
de la
conscience.
Il
n'avait
que
l'une
des
deux,
et ce
n'était
pas
la
meilleure.
» La
lucidité
de Lamartine ne le
porte
donc pas à la
complaisance.
Elle
ne
l'empêche
pas,
cependant,
de
décrire
son
interlocuteur de 1831 comme « le
diplomate
de
la
paix,
le
pondéra-
teur
de
l'équilibre,
le
conservateur
économe
de la vie des
peuples
».
N
ous voyons
ainsi,
des deux
côtés
de la Manche, ceux qui
considèrent
la
réconciliation
de l'Angleterre et de la France
comme une
dangereuse
chimère
prendre
Talleyrand pour
cible
et
ceux qui croient, au contraire, non seulement possible mais souhai-
table
d'enterrer
la
hache
de
guerre
le louer ou le
défendre. Parmi
ceux qui
appartiennent
à la seconde
catégorie,
Lamartine est digne
à
plusieurs
égards
d'une
attention
particulière.
Né en 1790, il eut,
en premier
lieu,
le
mérite précurseur
de
connaître
l'Angleterre et de
chercher à la comprendre : il apprit l'anglais pour
lire
dans
le
texte
original
Wordsworth, Shelley et Keats qui
exercèrent
sur lui une
heureuse
et
visible
influence ; il
épousa
une
Anglaise, Miss
Birch
;
la
mort de
Byron
lui inspira le
Dernier
Chant
du
Pèlerinage
d'Ha-
rold,
poème
digne selon moi de
celui
auquel il est
dédié.
En second
lieu,
Lamartine fut diplomate de
carrière jusqu'à l'âge
de
quarante
ans
avant
de devenir homme politique et, pour quelques mois,
ministre des
Affaires étrangères. Enfin
et
surtout,
son jugement a
l'avantage
d'être fondé
sur un
témoignage précis,
et non sur des
idées préconçues.
« Ce
n'est
pas à
Paris,
mais
à
Londres
qu'on
a
besoin
de moi », avait dit Talleyrand en s'ouvrant une nouvelle et
dernière carrière aussitôt après
avoir
aidé Louis-Philippe
à monter
sur le
trône
de roi des
Français.
Quelques mois plus tard, quand
Lamartine
—
son
cadet
de trente-six ans
—
lui
demande
audience, il
l'accueille
à la fois comme un
jeune
collègue
et comme un
écrivain
consacré
qui vient
d'entrer
à
l'Académie française.
Il sait fort bien
que l'homme de
lettres
auquel il parle
livrera
un jour à la
postérité
cette
confidence capitale : «
Voyez
combien
je
suis
heureux
dans
ma
vieillesse.
En 1792, j'ai
tenté
ici de
réconcilier
Mirabeau
et
Pitt,
et
de
former
entre
l'Angleterre
libérale
et la
France
révolutionnaire
une
alliance
qui
aurait
tenu
la
tige
de la
balance
du
monde.
Eh

TALLEYRAND
543
bien,
en 1830,
la
fortune
me
réservait
pour
dernière œuvre
de
venir
à
Londres
avec
la
même
mission
et d'y
défendre
les
mêmes
principes
que je
défendais
alors.
»
Un
historien scrupuleux est
obligé
de relever
dans
cette
décla-
ration
deux
erreurs
de fait, tout en soulignant qu'elles n'en
altèrent
pas la
signification
profonde. Tout d'abord, en 1792, Mirabeau ne
pouvait
pas se
réconcilier
avec Pitt,
puisqu'il était
mort le 2
avril
1791.
Cependant Talleyrand
était
bien excusable
—
surtout
après
tant
d'années
—
d'utiliser son nom comme un symbole. En effet,
Mirabeau,
peu de temps-avant de mourir,
s'était écrié
à
l'Assemblée
constituante en
présence
de son
collègue
Talleyrand :
«
Jeter
dès à
présent
les
grandes
bases
d'une
éternelle fraternité
entre
l'Angle-
terre
et la
France
serait
un
acte
profond
d'une
politique
vertueuse
et
rare.
» Ensuite (seconde erreur de fait), en 1792,
juste
avant la
chute de
Louis XVI,
Talleyrand,
chargé
d'une
mission officieuse
auprès
de
William
Pitt,
n'écrit
pas au ministre
français
des
Affaires
étrangères
pour lui recommander « de
former
entre
l'Angleterre
libérale
et la
France
révolutionnaire
une
alliance
» qui tiendrait
«
la
tige
de la
balance
du
monde
». Son propos est plus modeste : il
préconise
un accord
économique
et
—
le mot figure textuellement
dans
son rapport
—
« une
bonne
entente
» ; car
—
ajoute-t-il
prudemment
—
« un
rapprochement
avec
l'Angleterre
n'est
pas une
chimère
».
Mais
—
et
c'est
bien l'essentiel
—
le vocabulaire et la
pensée
du
vieil
ambassadeur de 1831 sont analogues à ceux du
jeune
chargé
de mission de 1792.
Cette
continuité
est
sans
doute un premier sujet
d'étonnement.
Presque
tous
les contemporains
—
notamment
Victor
Hugo et
Chateaubriand, qui fut lui aussi ambassadeur à Londres
—
et la
plupart des historiens ont
présenté
Talleyrand comme un pur et
simple
opportuniste. Certains le tiennent pour un opportuniste de
talent,
d'autres
pour un opportuniste de
génie.
Tous s'accordent à
dire
que
—
comme les scrupules
—
les
idées générales
lui
étaient
étrangères.
Cependant une
opinion différente
fut
professée
pour la
première fois,
sur un territoire britannique, par un personnage dont
nous avons trois bonnes raisons de ne pas
mépriser
le jugement :.
d'abord, il avait été en relations
étroites
avec Talleyrand
pendant
près
de dix ans ; ensuite, il n'avait aucun
motif d'être
indulgent,
bien
au contraire, envers un homme qui l'avait trahi ;
enfin,
il avait
du génie.
Ce territoire britannique,
c'est
l'île
de
Sainte-Hélène
; ce
personnage,
c'est
Napoléon.
On lit, en effet,
dans
le
Mémorial
de
Sainte-Hélène
: «
Talleyrand
est
un
philosophe,
mais
dont
la
philo-

544
TALLEYRAND
sophie
sait
s'arrêter
à
propos
». Nous verrons à quel point
cette
définition
est juste. Comme
Napoléon
fut le premier à le compren-
dre parce
qu'il
l'avait
constaté,
Talleyrand avait une doctrine
immuable.
Jamais il ne l'a
infléchie,
jamais il ne s'en est
éloigné.
Lorsque
les circonstances l'y contraignirent, il
renonça
provisoire-
ment
à la servir, mais
sans
la renier ni l'oublier. Sa philosophie fut
souvent à
l'arrêt,
mais il ne changea jamais de philosophie. Quatre
textes
concourent à en fournir la preuve. Entre le premier et le
dernier, il y a
près
de
quarante
ans. Or ils
sont
presque
interchan-
geables.
1°
Le 25 novembre 1792, Talleyrand est encore à Londres d'où
il
sera
expulsé
au
début
de 1794
(heureuse
mésaventure, grâce
à
laquelle
il
découvrira l'Amérique
et y
passera
deux ans). Depuis
deux mois, la France est une
république. L'ancien chargé
de
mission
n'a plus aucun
caractère
officiel.
Mais déjà
il se soucie
moins de savoir par qui la France est
gouvernée
que de continuer à
servir
les
mêmes idées,
quel que soit le
régime.
Il
adresse
donc au
premier gouvernement de la
Première République
un
étonnant
mémoire
qui est le prolongement, la suite logique, de son rapport au
dernier gouvernement de la monarchie. Son but est simple :
convaincre les nouveaux gouvernants
d'arrêter
le plus vite possible
la
guerre
qui a
commencé il
y a
sept
mois et
—
pour y parvenir
—
de
renoncer à
toute
annexion, en particulier à l'annexion de la
Belgi-
que ; telle est, en effet, la condition de la
neutralité
anglaise, donc
de la paix. «
Tous
les
agrandissements
de
territoire
—
écrit Talley-
rand
—
ne
sont
que des
jeux
cruels
de la
déraison
politique.
» Cet
avertissement fut
bientôt noyé
dans
la tourmente.
Mais,
en 1815,
vingt-trois
ans
après,
la guerre,
commencée
en
Belgique,
se termi-
nera en Belgique par l'amoindrissement du territoire
français.
Jamais la France ne retrouvera ni le sang ni le rang qu'elle a
perdus.
2°
En
août
1797, Talleyrand, revenu de son
exil
aux Etats-
Unis,
est ministre des
Affaires extérieures.
Le
traité
de Campo-
Formio
vient de donner la Belgique à la France. L'ivresse de la
victoire
règne
à Paris. Or Talleyrand refuse de
céder
à
cette
ivresse.
Ecoutons-le
: « La
querelle
momentanément
assoupie
par la
consternation
du
vaincu
n'est
point
de
nature
à
être définitivement
terminée
par les
armes,
tandis
que la
haine
subsiste...
Qu'est-ce
qu'un
traité
de
paix
?
C'est
celui
qui, en
réglant l'universalité
des
objets
en
contestation,
fait
succéder
non
seulement
l'état
de
paix
à
l'état
de
guerre,
mais
l'amitié
à la
haine.
» Les mots les plus impor-

TALLEYRAND
545
tants
de
cette
mise en
garde
sont
peut-être ceux-ci
: il faut
régler
« l'universalité
des
objets
en
contestation
». Ce qui
signifie
:
tant
que vous n'avez pas fait la paix aussi avec l'Angleterre, vous n'avez
rien réglé
du
tout.
3° Huit
ans
après,
le 17 octobre 1805,
Napoléon
semble plus
que jamais
invincible. L'Autriche
vient de capituler à Ulm. La
griserie est la
même
qu'au lendemain du
traité
de
Campo-Formio,
mais elle est encore plus forte. Cependant
Talleyrand
ne
cède
pas
plus à l'ivresse en 1805 qu'en 1797. Il
adresse
à
Napoléon
d'abord
un mémoire,
puis une
lettre
pour
l'inciter
à «
tendre
la
main
au
vaincu
», pour le supplier de sauver la monarchie autrichienne. Car
—
ajoute-t-il
—
si la monarchie autrichienne est
irrémédiablement
affaiblie,
les Russes «
maîtres
de la
Hongrie
» deviendront «
tout-
puissants
en
Europe
».
La
pensée prophétique
de
Talleyrand
est exactement celle
qu'il
dévoilera complètement
au
Congrès
de
Vienne
:
l'équilibre
de
l'Eu-
rope ne
peut
reposer que sur l'accord de
l'Autriche,
de l'Angleterre
et de la France. Pour
écrire cela
en 1805, pour
l'écrire
deux
fois,
pour
l'écrire
à
Napoléon,
il
fallait posséder
deux
qualités
: une
clairvoyance
que
personne
d'autre
n'a
montrée
; une
fermeté
que
personne
d'autre
n'a
déployée.
4°
Un
quart
de
siècle
plus tard, le 27 novembre 1830,
Talley-
rand vient d'arriver à Londres, comme
ambassadeur
d'un roi dont
la
légitimité
est encore
contestée.
Sa
première dépêche
n'est
pas
l'analyse
d'une
situation ou le
récit
d'une
conversation. C'est l'ex-
posé
d'une
doctrine, toujours la
même,
exactement la
même
:
<r
La
France,
dit-il,
doit
être
bien
avec
tout
le
monde
et
seulement
mieux
avec
quelques
puissances...
Ce
sont
les progrès
de la
civilisation
qui
formeront
désormais
nos
liens
de
parenté...
Ceci
conduit
naturelle-
ment
à
regarder
l'Angleterre
comme
la
puissance
avec
laquelle
il
nous
convient
d'entretenir
le
plus
de
relations...
L'Angleterre
est la
seule
puissance
qui,
comme
nous,
veuille
franchement
la
paix...
C'est
avec
l'Angleterre
que la
France
doit
chercher
à
agir.
»
Cette
dépêche
est
antérieure
de quelques mois à la conversa-
tion
que
nous
rapporte
Lamartine. Au cours de cet entretien,
Talleyrand
n'a pas menti. En revanche, il est impossible de se trom-
per plus lourdement que Chateaubriand, qui
écrit
à la fin des
Mémoires
d'outre-tombe
: «
L'autorité
de
Talleyrand
n'avait
aucune
valeur
en
matière
d'avenir
; il ne
voyait
point
en
avant,
il
ne
voyait
qu'en
arrière.
»
Nous
savons maintenant que
Talleyrand
avait une philosophie
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%