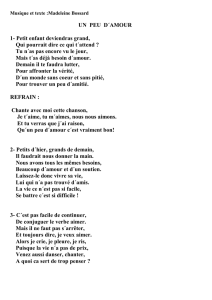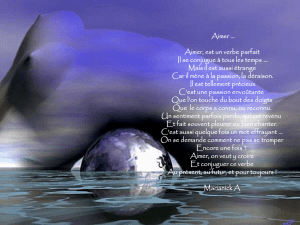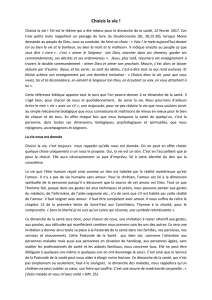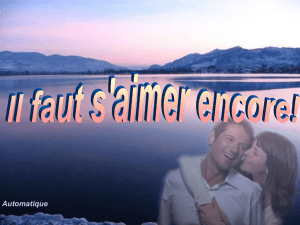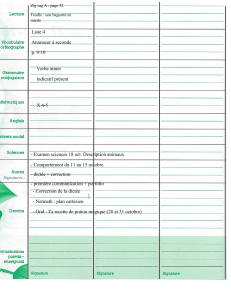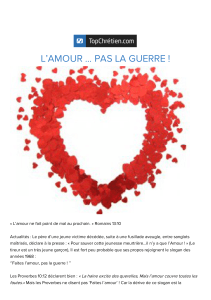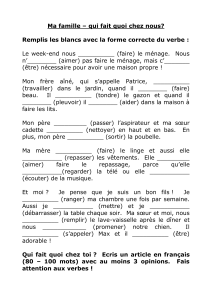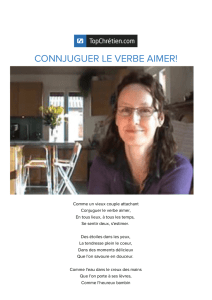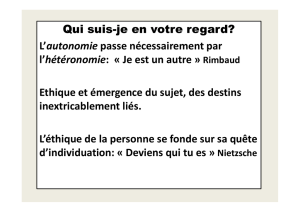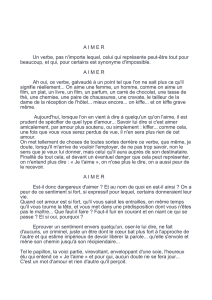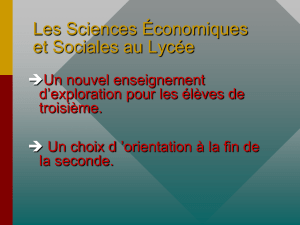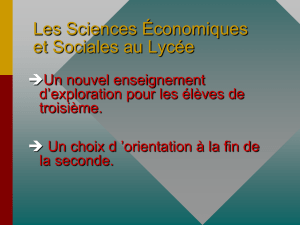Aimer son patient : une obligation, un interdit ou un choix

Aimer son patient : une obligation, un interdit ou un choix ? Elisabeth ROUCHON
___________________________________________________________________________
« Aimer son patient : une obligation, un interdit ou un choix ? »
Conférence prononcée par Elisabeth ROUCHON , psychanalyste, agrégée de philosophie, le
8 décembre 2011 à la faculté de médecine d’Angers dans le cadre de l’association
ANJOUPHILETHIQUE.
L’extrême complexité de la question que nous allons aborder ce soir n’a d’égale que son
extrême urgence : il y va en effet d’une nouvelle figure du soin dans notre société post
moderne. L’avancée des technosciences suscite, dans le domaine de la santé, deux réactions
antinomiques : d’une part, l’espoir d’une amélioration indéfinie de la durée et de la qualité de
la vie grâce à une médecine de plus en plus performante ; d’autre part, la peur d’une
éradication de la place du sujet (de la subjectivité) dans le contexte d’une politique de la santé
qui vise prioritairement l’efficacité quand ce n’est pas la rentabilité.
Qu’advient-il en effet de la nature de la relation qui s’instaure aujourd’hui entre le médecin et
son patient ? Rend-elle possible l’aménagement d’un espace et d’un temps qui permette une
véritable rencontre c’est à dire un accueil et une écoute de la personne souffrante tels que
celle-ci puisse s’engager dans une authentique démarche thérapeutique dont la confiance est
le fondement et le moteur ? Cette confiance ne requiert-elle pas, de la part du médecin, une
attention et une bienveillance voire une sollicitude qui l’initient et l’entretiennent dans la
durée ?
En d’autres termes, pour soigner et bien soigner celui dont la maladie altère non seulement le
corps mai aussi l’image de soi et le rapport au monde, faut-il que le médecin fasse preuve
d’amour à son égard ? Serait-ce là une obligation un impératif et si oui de quelle nature ?
Dans quel registre un tel devoir se situerait-il : règle déontologique, précepte moral voire
prescription à valeur sacrée ? Par ailleurs, introduire l’amour c’est à dire le sentiment avec la
charge des affects qui le sous tendent, dans une relation de soin, n’est-ce pas ouvrir la boîte de
Pandore ? Sensibilité et scientificité, affectivité et geste technique, logos et pathos, n’ont
jamais fait bon ménage ! L’amour ne serait-il pas un obstacle à l’exercice du jugement, à la
décision rationnelle et à sa mise en œuvre raisonnable, auquel cas, plutôt que d’un devoir c’est
d’un interdit (d’une prohibition) dont il devrait être l’objet. Nous voilà confrontés, dans le
champ de la pratique médicale, à une alternative, qui sur le plan subjectif, risque d’être
souvent vécue par le médecin comme un douloureux dilemme. Pour y échapper celui-ci ,
exerçant son libre-arbitre, pourrait recourir à un engagement personnel, un choix relevant
d’une intention éthique, mettant en œuvre des valeurs à la fois individuelles et universelles
parce que fondatrices de son humanité…Il reste qu’un tel choix ne se fait jamais in abstracto
mais sur le terrain des problèmes concrets que chaque médecin rencontre dans le quotidien de
sa pratique configurée par ce que l’on nomme aujourd’hui le « colloque singulier » avec son
patient. A ce titre toute relation de soin est traversée par des représentations à la fois
collectives (culturelles) et individuelles qui viennent façonner, pour part à l’insu des
protagonistes, les positionnements respectifs de chacun. La place ou l’absence de place ainsi
que le statut axiologique accordés à l’amour sont , dans cette mesure, tributaires de facteurs
non conscients voire inconscients (au sens psychanalytique du terme) dont l’ensemble
constitue une sorte de paradigme de la relation de soin (un modèle que l’on peut théoriser , à
l’instar de ce que François Laplantine fait pour la maladie dans son ouvrage l’anthropologie
de la maladie publié en 1986 .).
Qu’il soit donc posé comme une obligation , un interdit ou un choix, l’amour, en dernier
ressort, met toujours le médecin aux prises avec ce qui, sans doute, l’a motivé à entrer dans
cette profession dont on ne peut évacuer la dimension de « vocation »…il lui faudrait alors
1

Aimer son patient : une obligation, un interdit ou un choix ? Elisabeth ROUCHON
___________________________________________________________________________
s’interroger sur la véritable signification de l’appel auquel il a répondu initialement qui
conditionne, en deçà de sa posture professionnelle son engagement auprès de son patient, la
justesse et l’humanité de sa présence.
A partir de ces quelques pistes nous allons tenter d’élaborer la question proposée en reprenant
les trois hypothèses qu’elle contient. Chacune d’elles nous renverra à la fois à un sens
possible du verbe « aimer » (l’épaisseur sémantique de la notion d’amour étant déjà en soi un
problème) et à un modèle de la relation médecin-patient dont nous ne pourrons qu’esquisser
les contours et suggérer les limites (voire les possibles dérives).
La médecine comme praxis, savoir faire, est dès son origine indissociable d’un certain nombre
de règles qui en délimitent l’exercice .Celles-ci constituent, pour l’essentiel, la trame du
serment d’Hippocrate définissant ce qu’il convient de faire et de ne pas faire sous peine de
sanctions. On les qualifiera ultérieurement (à partir du XIXème siècle) de déontologiques.
Elles définissent pour tout médecin des obligations qui, littéralement, le lient à ses pairs et à
ses patients. Ainsi il lui faut respecter le secret professionnel, ne pas nuire à celui qu’il a le
devoir de soigner en l’assistant dans la durée, faire bon usage de ses connaissances et
techniques au service de la vie, etc.…
Ces devoirs trouvent leur fondement dans l’ asymétrie, la dissymétrie initiale qui caractérise
la relation entre le soignant (le médecin ) instruit de la maladie , de ses causes et des moyens
de lutter contre elle, en position de savoir et de pouvoir et le patient, ignorant (même si
aujourd’hui il a sa disposition une masse d’informations sur les maladies en général via
l’Internet et autres moyens de diffusion) et fragilisé par sa situation d’être mal portant. Le
patient est celui qui subit comme le terme le souligne (pati : souffrir, être affecté par) mais
aussi celui qui est en souffrance c’est à dire en attente de ce que la médecine peut lui apporter
en termes d’amélioration de son état, d’atténuation de ses douleurs voire de guérison.
Demandeur de soins il se trouve, de fait, sous la dépendance de celui qui est capable de les lui
prodiguer ; « minorisé » par la souffrance, il est sous la « tutelle » du « majeur » qu’est
l’homme de l’art. Je reprends ici délibérément le vocabulaire de Kant dans son opuscule
Qu’est-ce que les Lumières ? où le philosophe s’efforce de penser les situations
d’hétéronomie qu’il illustre, entre autres, par celle qui nous intéresse ici. Cette dépendance de
fait est apparemment légitimée par la confiance que le malade accorde à son médecin.
En conséquence, ce devoir d’assistance que l’on pourrait nommer devoir de protection
éclairée ou de « bientraitance » requiert la référence à des impératifs qui, bien que plus diffus
(moins explicites) que les règles déontologiques, sont tout aussi contraignants : impératifs ou
normes qui constituent une éthique professionnelle (régionale) venant garantir de la part du
médecin le respect de la personne du malade et de sa dignité afin que celui-ci jamais ne soit
instrumentalisé. A la bientraitance se substitue alors la bienveillance qui peut être nommée
une forme d’amour. La tradition philosophique (et théologique) parle d’un amour de
bienveillance qui doit être distingué de l’amour dit de concupiscence. Le premier vise le bien
d’autrui quand le second est tourné vers son propre intérêt articulé sur le désir. Descartes
(reprenant les idées de St Thomas d’Aquin) définit l’amour de bienveillance comme « vouloir
du bien à ce qu’on aime » (article 81 du traité des passions de l’âme) et Kant ,à son tour, lui
oppose l’amour de complaisance enraciné dans la sensibilité et les affections qui la
caractérisent. Seul l’amour de bienveillance, désintéressé, peut être l’objet d’un
commandement éthique voire d’un impératif proprement moral c’est à dire
2

Aimer son patient : une obligation, un interdit ou un choix ? Elisabeth ROUCHON
___________________________________________________________________________
catégorique,universel et inconditionné, prescrivant une action comme nécessaire en elle-
même et non pas comme simple moyen en vue d’une fin (auquel cas l’impératif n’est
qu’hypothétique).Aimer son patient signifierait ici le traiter toujours comme une personne
ayant valeur intangible,(absolue), « toujours comme une fin et jamais simplement comme un
moyen » dit Kant dans les fondements de la métaphysique des moeurs c’est à dire comme une
créature raisonnable et non un être sensible. En d’autres termes l’amour entre dans les
catégories morales à la condition d’être détaché, délié de ses racines affectives, articulé au
seul vouloir (la volonté bonne) sans que vienne s’y mêler aucune inclination ou penchant.
Toutefois si l’on revient à la dimension empirique de la pratique médicale, le médecin de fait
ne peut vouloir que ce qu’il estime être le bien de son patient, ce qu’il évalue être le mieux
pour préserver , restaurer et entretenir la qualité de sa vie, son bien-être au nom de l’art dont
il dispose et de la représentation de la science et du pouvoir que celui ci lui confère. Doté
d’une autorité (puisque hiérarchiquement en position de surplomb), il est tenu
déontologiquement et moralement, de prendre en charge le patient qui en fait la demande et
qui ne peut, parce qu’il n’a ni la science ni la technique, se prendre en charge lui même (sous
l’angle de sa pathologie). Alors la bienveillance du médecin semble l’analogue de celle du
père qui a le devoir d’aimer ses enfants, de les prendre en charge et d e les conduire vers leur
bien (chez Kant ce qu’il nomme l’autonomie.) c’est à dire de les éduquer.
Envisagée de la sorte, référée au paradigme de l’exercice de l’autorité du père, la relation
entre le médecin et son patient met en jeu des mécanismes intra psychiques qui pour une part
agissent à l’insu des sujets. Le médecin risque de s’identifier inconsciemment à cette figure
du père que sa position vient solliciter et que le désir implicite du patient vient conforter à son
tour. En effet derrière la demande explicite de soins il y a souvent une attente implicite du
patient articulée sur les effets de l’état de souffrance dans lequel il se trouve. L’épreuve de la
maladie est celle d’une altération non seulement du corps mais, globalement, de tout l’être.
Elle vient bouleverser le rapport du sujet au temps, aux autres (les proches et tout le tissu
social) et plus radicalement encore le rapport à soi. On peut parler alors d’une perte
narcissique qui fait vaciller les assises identitaires de la personne (ce que traduisent les
expressions si souvent entendues « je ne plus le même », « je ne me reconnais plus ») ; Le
patient humilié par ses défaillances, ses incapacités, traverse une crise qui ouvre une brèche
dans une existence qui se croyait forte parce que capable et illimitée (immortelle). La
souffrance vient briser l’illusion vitale ; elle est, en ce sens, comparable à un exil. Le recours
au médecin est alors habité par la demande informulée de recouvrer ce que l’on a perdu, de
revenir au pays de la vie ordinaire (celui de la santé) bref de réintégrer une identité qui est
menacée d’effondrement.
De père protecteur bienveillant et en ce sens aimant, le médecin peut devenir (à son insu) par
identification à l’image que lui tend le sujet qui souffre et opère une sorte de « régression »,
un père symboliquement « tout-puissant ». Le glissement de l’autorité au pouvoir et du
pouvoir à la domination n’est pas que sémantique. Le médecin est tenté de décharger son
patient de sa responsabilité en même temps que de ses symptômes ; ce qui n’est pas sans
susciter des mécanismes complexes sur le mode de ce que l’on nommera les effets du contre-
transfert. Si le médecin se conforme à ses devoirs, il s’érige en « bon » médecin et attend en
retour de son patient qu’il se comporte en « bon » patient: qu’il accepte, consente au protocole
mis en place, qu’il ne doute pas(ne fasse pas preuve de méfiance là où l’amour doit générer la
confiance), qu’il applique scrupuleusement les prescriptions et conseils (qu’il soit dans
l’ « observance » ou encore obéissant). Si le patient se dérobe, réagit sur le mode d’une
résistance ou d’une négligence, le médecin peut éprouver toute une gamme d’émotions, de la
3

Aimer son patient : une obligation, un interdit ou un choix ? Elisabeth ROUCHON
___________________________________________________________________________
lassitude (ennui) à la franche hostilité voire à la haine (ce que le pédiatre et psychanalyste
D.W. Winnicott nomme la haine dans le contre transfert). C’est l’ambivalence de l’amour qui
est ici en question mettant en évidence l’impossibilité d’en éradiquer les racines sensibles et a
fortiori les fondements inconscients. Il faudrait alors admettre une part incompressible de
charge libidinale dans toute forme d’amour faisant de celui-ci un obstacle à la relation
thérapeutique et justifiant la mise en place d’un interdit pour garantir la qualité de l’exercice
de l’art médical.
Nous pouvons donc pointer rapidement les dimensions de l’amour qui en font une entrave à la
tâche que le médecin a à accomplir : les mouvements de l’affectivité sont arbitraires,
fluctuants (Proust parle des « intermittences du cœur »), toujours tributaires des circonstances
particulières (non universalisables) voire singulières (propres à l’histoire de chaque sujet) ;
sympathie et antipathie, les affinités et leurs contraires ne se commandent pas et leurs effets
viennent tôt ou tard obscurcir le jugement, l’établissement d’un diagnostic, la prise de
décision(qui devrait ne se soumettre qu’à l’exercice de la raison) et la mise en place d’un
protocole de soins. Outre le danger de l’identification fusionnelle à celui qui est dans la
détresse, on peut craindre les dérives toujours possibles des motions sexuelles ou les
projections à partir de sa propre histoire et des figures archétypales qui l’ont peuplée.
Pour pallier ces risques le devoir positif d’amour de bienveillance fait place à son envers
négatif, la prohibition, l’interdit d’aimer. Comparable à la règle de l’abstinence dans la cure
analytique, un devoir de réserve sous la forme d’une suspension des investissements affectifs
(émotions, sentiments) permet au médecin de se protéger de toute intrusion du pathos. C’est
une expertise qu’il doit mettre au service de ses patients en s’engageant à les informer et à les
soigner. Le patient se définit alors comme un usager du service que lui fournit le médecin
dans le cadre d’une politique de la santé qui détermine les droits et les devoirs de chacun. Le
soin est pensé et mis en œuvre dans sa dimension strictement curative (cure) et la maladie
appréhendée comme une entité essentiellement organique. Il s’agit de soigner ce qui peut
l’être c’est à dire le corps, objectivé pour l’occasion, voire découpé, morcelé. Le modèle
mécaniste est celui auquel s’adosse la médecine pensée comme scientifiquement et
techniquement efficace, performante, avec l’arsenal que lui fournissent les technologies de
pointe (Les machines s’interposent entre les personnes quand elles ne se substituent pas à
elles). Le devoir d’informer le patient est lui-même susceptible d’une interprétation en
termes d’acte de communication protocolisé et vidé de son intentionnalité subjective. Une
telle approche que je qualifierai d’ « aseptisée » renvoie le patient lui-même à un rapport dé
subjectivé à sa pathologie (il a une maladie, un cancer, le sida …) et , en deçà, à son propre
corps (il a un corps,il ne l’est pas)…comme si de ce corps précisément il n’était que
l’usager…
La figure du médecin n’est plus alors celle du bon (ou du mauvais) père ; elle est celle du
maître : maître de la situation, maître de la maladie qu’il combat (on peut se référer au
vocabulaire de la stratégie militaire) et maître de lui-même puisque cultivant l’impassibilité.
Sur un plan psychanalytique on peut se demander si ce ne sont pas des défenses qui sont ici
mises en place pour permettre un processus de refoulement voire un déni des émois et des
affects en les recouvrant d’une valorisation déontologique et morale. De fait, le patient est
souvent laissé seul face à sa souffrance et le médecin seul face à des outils, à des procédures
qu’il subit pour partie et des impératifs( pragmatiques) d’une politique de la santé qui le
4

Aimer son patient : une obligation, un interdit ou un choix ? Elisabeth ROUCHON
___________________________________________________________________________
contraint toujours plus (temporalité brève, tâches administratives)…A quoi s’ajoute
l’obligation de résultat : si l’objectif n’est pas atteint le patient a le sentiment d’un échec dont
le médecin sera tenu pour responsable (voire d’une erreur ou d’une faute dont celui-ci sera
tenu pour coupable.). Le patient usager se réfère à ses droits pour se plaindre voire porter sa
plainte sur le terrain du droit pénal : la contractualisation de la relation va de paire avec sa
judiciarisation. Le patient est dans une demande d’efficacité qui le conduit également à
toujours chercher le meilleur expert d’où le phénomène fréquent de l’errance thérapeutique.
On assiste alors, au sein de ce modèle techniciste, à un retournement paradoxal de la figure de
l’expert en figure quasi magique dans laquelle s’incarne le fantasme de la toute-puissance
qui n’est autre qu’une mise en scène du déni de notre finitude et de notre vulnérabilité. Ce
déni opérant conjointement chez le médecin et son patient.
Or c’est là précisément au coeur d’une finitude et d’une vulnérabilité partagées que peut
s’inscrire une troisième dimension de l’amour qui en ferait l’objet non plus d’un impératif
déontologique ou moral ni d’un interdit mais d’un choix du médecin engageant sa
responsabilité éthique.
Aimer son patient serait à entendre dans le sens de lui accorder outre les soins dont il a besoin,
le soin i e l’accueil et la disponibilité permettant qu’il soit reconnu dans sa singularité, dans
son altérité et dans sa proximité : singularité d’une expérience qui fait sens dans son
histoire(même si c’est pour y marquer une distorsion voire une rupture), altérité (impossibilité
de se substituer à lui) et proximité(partage d’une condition qui est celle de l’humanité)…
Réapparaît alors une forme de symétrie dans la relation : le médecin intégrant à sa position
explicite, actuelle, de sujet savant et capable celle, implicite, de sujet vulnérable, fini ,doté
comme son patient d’un corps faillible et transitoire. Dans ce contexte et à cette condition,
le patient peut en retour, au creux de sa souffrance entendue, s’appréhender comme sujet et
conserver le sentiment de la continuité et de la valeur (la dignité) de son existence malgré les
métamorphoses induites par la maladie. Il peut aussi assumer en son nom ses hésitations et ses
doutes, ses préférences et ses choix éventuels, jusqu’aux ambivalences de ses désirs y compris
ceux (souvent inavouables) qui s’articulent autour de ce que nous baptisons les « bénéfices
secondaires » de la maladie.
Cet engagement du médecin dans une attitude d’ouverture et pourrait-on dire d’hospitalité
suppose une véritable écoute de la parole du patient fût-elle encore à l’état de cri ou de silence
(écoute de la plainte) qui nécessite un dispositif (à la fois dans l’espace et dans le temps) mais
surtout une disponibilité .C’est la fragilité de l’autre qui suscite des obligations auxquelles le
médecin n’a pas le « droit » de se dérober. Le psychanalyste Denis Vasse, dans le poids du
réel, la souffrance, pointe ce qui pourrait être considéré comme le premier précepte d’une
éthique de la juste présence à l’autre souffrant ; je le cite : « Certes en tant que symptôme la
souffrance a une signification dans le langage médical, social, politique. Mais en tant que lieu
de la parole, elle doit s’entendre comme le cri d’un sujet affronté au désir de vivre et à la
mort : le cri d’un sujet naissant. Ne pas l’entendre ainsi, fait de l’homme souffrant une chair
aveugle et sourde condamnée à ne plus être reconnue comme un fils d’homme promis à la joie
de la rencontre» (Editions du Seuil ; p.47). Ne pas donner à la parole du malade, directement
ou indirectement, les moyens de s’exprimer et de se déplier c’est lui interdire l’avènement de
sa subjectivité parce que lui dérober le moment fécond de la rencontre et de l’échange. Il y a
là un manquement grave, non pas une faute déontologique ou morale mais un manquement
éthique au sens où le philosophe Paul Ricœur parle d’une intention éthique fondée sur la
sollicitude.
5
 6
6
 7
7
1
/
7
100%