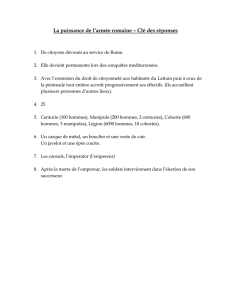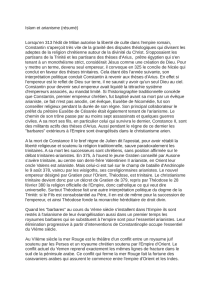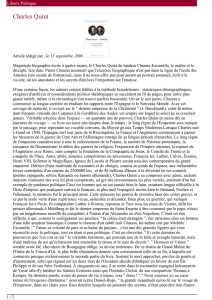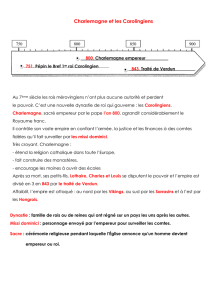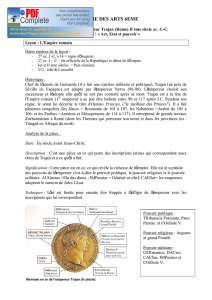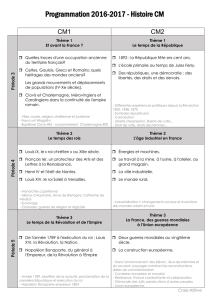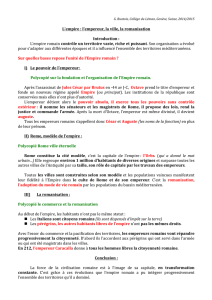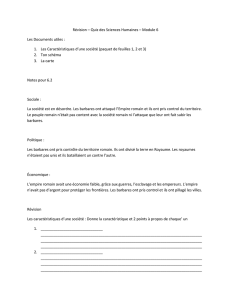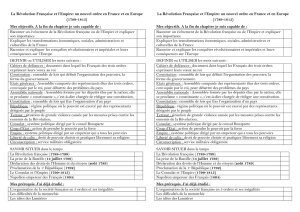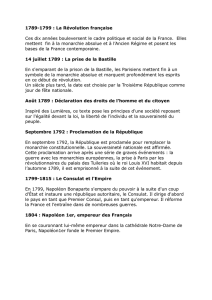histoire du bas-empire - L`Histoire antique des pays et des hommes

HISTOIRE DU BAS-EMPIRE
par Monsieur le Comte de Ségur
TOME CINQUIÈME

CHAPITRE PREMIER
CONSTANTIN ; sa prédilection pour le christianisme ; ses édits ; ses ordonnances ; ses victoires; son respect
pour le culte de Dieu ; ses efforts pour établir la paix dans l'église; son départ définitif de Rome ; ses grands
travaux dans Byzance ; ses institutions ; ses panégyriques; sa maladie; son baptême; sa mort.
CHAPITRE DEUXIÈME
CONSTANTIN II, CONSTANCE, CONSTANT et MAGNENCE ; partage de l'empire entre les enfants de Constantin ;
gouvernement des trois empereurs ; mort de Constantin II ; conspiration et usurpation de Magnence ; mort de
Constant ; élévation de Vétranion ; guerre entre Constantin et Magnence abdication de Vétranion ; Gallus et
Décence sont nommés Césars ; marche de Magnence contre Constantin ; bataille de la Drave ; lâcheté de
Constance ; défaite et mort de Magnence ; mort de Décence.
CHAPITRE TROISIÈME
CONSTANTIN, empereur; GALLUS, César; JULIEN, César ; prédilection de Constance pour le christianisme ;
tyrannie et mort de Gallus ; arrivée de Julien à Milan ; son élévation ; son gouvernement ; conspiration contre
lui ; préparatifs hostiles entre Julien et Constance ; mort de Constance.
CHAPITRE QUATRIÈME
JULIEN, empereur ; révolution à son avènement ; son caractère ; son gouvernement ; ses voyages ; ses succès ;
ses revers ; sa mort.
CHAPITRE CINQUIÈME
JOVIEN, empereur ; son élection ; son origine ; son caractère, sa tolérance pour les cultes ; sa mort.
CHAPITRE SIXIÈME
VALENTINIEN, empereur en Occident ; VALENS, empereur en Orient ; PROCOPE, usurpateur ; GRATIEN, César ;
VALENTINIEN II, empereur en Occident ; portrait de Valentinien ; association de Valens à l'empire ; usurpation
de Procope ; lâcheté de Valens ; mort de Procope ; cruauté de Valentinien ; ses institutions ; ses victoires ;
Gratien est nommé Auguste ; mort de Valentinien ; Valentinien II est empereur ; magnanimité de Gratien.
CHAPITRE SEPTIÈME
VALENS, en Orient ; GRATIEN, VALENTINIEN II, en Occident ; THÉODOSE ; MAXIME, usurpateur. État de
l'Occident sous Gratien ; victoire de Gratien ; défaite et mort de Valens ; rappel du duc Théodose ; ses exploits
; son association à l'empire ; ses victoires ; victoire de Gratien et de Théodose ; usurpation de Maxime ; mort
de Gratien.
CHAPITRE HUITIÈME
En Occident, MAXIME, EUGÈNE ; en Orient, VALENTINIEN II ; THÉODOSE, ensuite, THÉODOSE seul. Ambassade de
Maxime à Théodose ; prédilection de Théodose pour le christianisme ; son sage gouvernement ; marche de
Maxime contre Valentinien ; victoire de Théodose sur Maxime ; mort de Maxime ; mort de Valentinien ; Eugène
est nommé. Auguste ; Victoire de Théodose ; mort d'Eugène ; Arcadius et Honorius sont nommés Augustes ;
mort de Théodose.
CHAPITRE NEUVIÈME
HONORIUS, en Occident ; ARCADIUS, en Orient ; STILICON ; ALARIC ; ATAULPHE ; Honorius et Arcadius sont
proclamés Augustes ; partage de l'empire entre eux ; élévation de Stilicon ; exploits et élévation d'Alaric ; sa
défaite et sa mort ; élection et mort d'Ataulphe ; Théodose II est nommé César et Auguste ; mort d'Arcadius ;
régence d'Eudoxie ; mort d'Honorius.
CHAPITRE DIXIÈME
VALENTINIEN III et PLACIDIE sa mère, en Occident ; THÉODOSE II et PULCHÉRIE sa mère ; MARCIEN, en Orient ;
AÉTIUS, GENSÉRIC, ATTILA, THÉODORIC. Valentinien est empereur ; conduite de Théodose à l'égard de
Valentinien ; apparition d'Attila ; échecs et mort de Théodose ; avènement de Pulchérie au trône ; mort de
Théodoric ; lâcheté de Valentinien ; mort d'Attila ; mort de Valentinien.

CHAPITRE ONZIÈME
En Occident, MAXIMUS, AVITUS, MAJORIEN, SÉVÈRE, ANTHÈME, OLIBRIUS, GLYCÉRIUS, JULIUS NEPOS,
AUGUSTULE ; généraux barbares, GENSÉRIC, RICCIMER, ORESTE et ODOACRE ; en Orient, MARCIEN, LÉON,
ZÉNON, empereurs ; élévation de Maximus ; son mariage ; sa mort ; élection d'Avitus ; sa déposition et sa mort
; élévation de Majorien ; sa mort ; élévation de Sévère ; élection de Léon ; élévation d'Anthème ; sa mort ;
élévation d'Olibrius ; mort de Riccimer ; règne de Julius Nepos ; révolte d'Oreste ; mort de Nepos ; règne
d'Angustule ; chute de l'empire romain ; règne d'Odoacre ; mort d'Augustule.

CONSTANTIN
(An 313)
Nous avons quitté ce Forum célèbre où brillèrent tant d’orateurs éloquents, ce
sénat que Cynéas avait pris pour une assemblée de rois, et où l’on admirait tant
de vertus, ce Capitole où triomphèrent tant de héros ; et nous revenons avec
Constantin vers cet Orient voluptueux où l’homme, bercé par la mollesse, enivré
parles plaisirs, partit toujours destiné à s’engourdir au sein du repos, et à
s’endormir dans l’esclavage.
Nous allons écrire l’histoire de la vieillesse de cet empire, dont la force colossale
avait si longtemps fatigué la terre : l’histoire de cette vieillesse est triste, mais
elle conserve cependant quelques traits qui rappellent son antique grandeur ; si
elle n’élève plus l’esprit, elle l’intéresse encore ; on y voit peu de ces actions
héroïques qui excitent l’admiration, mais elle offre aux rois, et aux peuples
d’utiles leçons et de salutaires exemples : on y trouvera le courage plus occupé à
se de défendre qu’à conquérir, la politique s’y montre plus timide, l’intrigue y
succède à l’audace, la trahison aux révoltes ; on assassine au lieu de vaincre.
Des conjurations fréquentes détrônent encore quelques princes, mais elles ne
produisent plus de révolutions que dans le palais ; elles sont presque
indifférentes aux peuples, qui ne font que changer, non de sort, mais de maîtres.
Depuis le partage de l’empire, comme le dit Montesquieu, l’ambition des
généraux étant plus contenue, la vie des empereurs fut plus assurée ; ils purent
mourir dans leur lit ce qui parut avoir un peu adouci leurs mœurs. Ils ne
versèrent plus le sang avec tant de férocité ; mais, comme il fallait que ce
pouvoir immense débordât quelque part, on vit un autre genre de tyrannie, mais
plus sourde. Ce ne furent plus des massacres, mais des jugements iniques, des
formes de justice qui semblaient n’éloigner la mort que pour flétrir la vie. La cour
fut gouvernée et gouverna par plus d’artifice, par des arts plus exquis, avec un
plus grand silence ; enfin, au lieu de cette hardiesse à concevoir une mauvaise
action et de cette impétuosité à la commettre, on ne vit plus régner que les vices
des âmes faibles et des crimes réfléchis.
Depuis Auguste, les empereurs les plus ambitieux avaient respecté les formes
républicaines, et les plus mauvais princes, se montrant encore citoyens, se
faisaient populaires pour se rendre absolus. Ces maîtres du monde ne
commandaient à la terre qu’au nom du peuple romain ; le sénat légalisait leurs
ordres, les pontifes sanctifiaient leurs entreprises, les plus puissants et les plus
illustres personnages de Rome décoraient leurs trônes, entouraient leurs
personnes et soutenaient leur gloire par l’éclat de leurs triomphes. Peu de
princes, même les plus lâches, se seraient crus dignes de conserver le nom et la
puissance d’imperator, s’ils n’avaient parcouru fréquemment les camps
nombreux qui garnissaient les frontières de l’empire ; ils quittaient souvent la
toge, et se montraient à la tête de ces invincibles légions qui faisaient respecter
encore les Romains, à l’époque où la chute de leurs vertus et de leur liberté ne
leur laissait plus d’autres titres à l’estime que le courage.
Sous le règne de Constantin les traces de l’antique système s’effacèrent ; il ne se
soumit aux anciennes coutumes, que jusqu’au moment où il n’eut plus de rivaux.
Soigneux de détruire tout vestige de liberté, il fit même disparaître de ses

enseignes les lettres initiales des noms du sénat et du peuple romain ; prenant
pour prétexte la nécessité de les remplacer sur le labarum par celles du nom de
Jésus-Christ. Le peuple fut privé de tout droit d’élire, et le sénat de toute part
réelle à la législation.
L’empereur craignait la puissance des grands, et voulait cependant ménager leur
vanité : il créa une foule de titres sans fonctions, ne confia l’autorité qu’à des
officiers choisis par lui, et dont l’existence dépendait de sa faveur. La nation ne
fut plus rien, le prince fut tout ; la cour remplaça la patrie, et la monarchie
n’étant plus légale devint patrimoniale.
Les princes aveuglés par l’amour du pouvoir craignent toute limite à leur autorité
; ils oublient que les institutions qui règlent et arrêtent leur marche peuvent
seules lui donner quelque sûreté, et qu’en ne voulant pas de barrière contre
l’abus de la puissance ils, la privent des seuls remparts qui, dans les jours de
péril, peuvent la défendre.
Constantin ne s’aperçut point des dangers du despotisme qu’il fondait. Prince
belliqueux, couronné par la victoire, chéri des soldats compagnons de ses
triomphes, il se vit respecté des peuples qu’il avait délivrés d’une foule de tyrans
: son habile et heureuse activité empêchait tout péril de naître, et rien ne lui
résista que le clergé qu’il avait affranchi, élevé et enrichi.
Tout despotisme est brillant lorsqu’il est décoré par la gloire, s’il donne même un
bonheur apparent et passager quand il est exercé par un prince habile et juste.
La force de Constantin assurait à l’empire un profond repos ; l’équité qui dicta la
plus grande partie de ses lois faisait jouir ses sujets d’une sécurité depuis
longtemps inconnue. Ce ne fut qu’après sa mort que tous les vices de ce
gouvernement sans contrepoids et de cette monarchie sans base éclatèrent dans
toute leur difformité, et amenèrent en peu de temps la chute de l’empire qui
devint la proie des barbares.
Dès que l’âme active de Constantin cessa d’animer les membres épars de cet
empire colossal, ses faibles successeurs, semblables aux despotes efféminés de
l’Asie, ne montrèrent plus rien de romain. Une lâche oisiveté les enchaîna au
milieu d’une cour corrompue ; ils s’enfermèrent dans leurs palais ; toute leur
puissance passa entre les mains des eunuques, des affranchis et d’une foule
d’insolents domestiques. Les plus grands personnages, les magistrats les plus
respectables, les plus braves guerriers, comme le remarque un historien
moderne, M. Le Beau, se trouvèrent ainsi à la discrétion de cette foule de
courtisans sans expérience et sans mérite, qui ne peuvent servir l’état, ni souffrir
qu’on le serve avec gloire.
Invisibles pour la nation, au fond d’un palais impénétrable à la vérité, environnés
de prêtres que l’ambition éloignait de leurs devoirs, et qui ne s’occupaient que du
soin d’associer leurs maîtres à leurs honteuses querelles, à leurs puériles
disputes, et souvent à leurs funestes erreurs, ces empereurs dégradés ne virent,
ne pensèrent et ne régnèrent plus que par leurs favoris.
Depuis longtemps l’Italie, possédée par les conquérants du monde, enrichie des
dépouilles de la Grèce, de l’Asie, de l’Afrique et de l’Espagne, n’était plus, suivant
l’expression de Montesquieu, que le jardin de Rome. Cette terre couverte de
palais, de maisons de plaisance, de parcs somptueux, consommait tout et ne
produisait rien. On y voyait en foule des riches efféminés, des esclaves consacrés
au luxe et aux plaisirs, des gladiateurs, des baladins, des courtisanes, des
pantomimes, mais presque plus de cultivateurs ni de soldats ; les laboureurs ne
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
1
/
194
100%