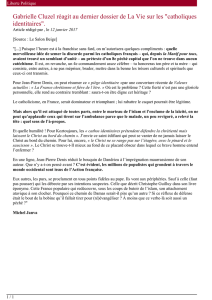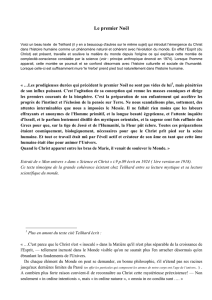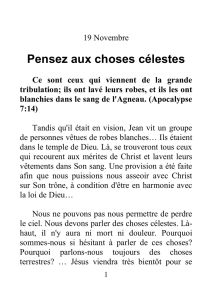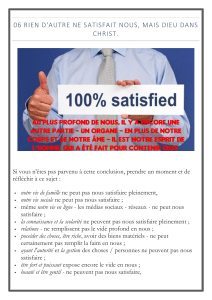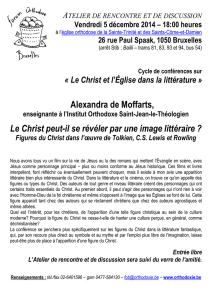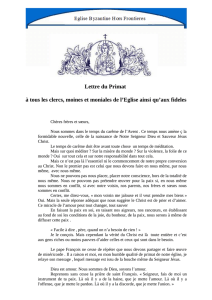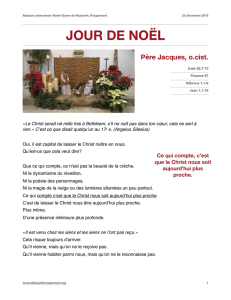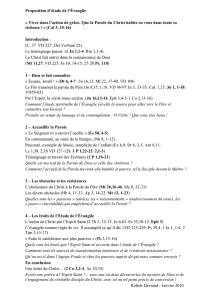Le Christ Médiateur dans la pensée de Calvin

ThEv vol. 9, n°1, 2010
45
Paul Wells
Le Christ Médiateur
dans la pensée de Calvin
Dieu ne s’est jamais manifesté de façon favorable à son ancien
peuple et ne lui a accordé aucune espérance de grâce sans lui
proposer un Médiateur… Dieu ne peut pas être propice envers le
genre humain sans Médiateur
1
.
Comparer la structure de l’
Institution
avec celle de la
Somme
théologique
de Thomas d’Aquin ou avec l’
Institution de la théologie élenctique
de
François Turretin est la meilleure façon de mettre en évidence que Calvin ne
prétend pas être un théologien systématique. Chez Thomas, il faut vraiment
patienter avant de trouver sa christologie, alors que chez Calvin, celle-ci occupe
une place au centre de l’œuvre dans le livre II
2
.
Malgré cela, la doctrine de l’œuvre de Christ chez Calvin – en particulier,
l’accentuation que le Réformateur place sur le médiateur – n’a pas toujours
bénéficié de l’attention que méritent son originalité et ses implications
3
. Dans
les présentations populaires, l’importance de cette doctrine est éclipsée par celle
de la prédestination et par l’obsession qu’elle suscite, un fait noté par Wilhelm
Niesel en son temps
4
.
1.
IRC
2.6.2 (cité selon l’édition Aix-en-Provence - Cléon d’Andran, Kerygma - Excelsis, 2009).
2.
Saint Thomas d’A
QUIN
,
Somme théologique
III
a
pers., qu. 1-59, trad. par Ch. H
ÉRIS
pour les questions 1-26 (« Le
Verbe incarné ») et P. S
YNAVE
pour les questions 27-59 (« Vie de Jésus »), éd. dite de la Revue des Jeunes, Paris/Tour-
nai/Rome, Desclée, 1927 ss. En ce qui concerne les influences thomistes sur la pensée de Calvin, voir Arvin V
OS
,
Aqui-
nas, Calvin and Contemporary Protestant Thought
, Grand Rapids, Eerdmans, 1985 ; et Richard A. M
ULLER
,
The
Unaccommodated Calvin : Studies in the Foundation of a Theological Tradition
, Oxford, University Press, 2000, ch. 3.
3.
Les références à la christologie de Calvin dans certains ouvrages récents sont maigres. Voir, par exemple, William
B
OUWSMA
,
John Calvin : A Sixteenth-Century
Portrait, New York, Oxford University Press, 1988 ; ou Bernard C
OT
-
TERET
,
Calvin. Bibliographie
, Paris, J.C. Lattès, 1995.
4.
Wilhelm N
IESEL
,
The Theology of Calvin,
trad. Harold Knight, Grand Rapids, Eerdmans, 1980 (1956), p. 159.
p. 45-70
TE_9.1 .fm Page 45 Jeudi, 18. février 2010 9:41 09

théologie évangélique vol. 9, n° 1, 2010
46
Dans cette étude
5
, nous souhaitons mettre en évidence la centralité de
l’œuvre de Christ dans la pensée de Calvin ainsi que son caractère novateur. Les
éditions successives de
l’Institution de la religion chrétienne
comme les
Commen-
taires
présentent une perspective théologique où la médiation de Christ est
capitale non seulement en ce qui concerne l’incarnation, mais aussi de façon
plus générale
6
.
La médiation implique une dialectique fondamentale pour tout ce que l’on
peut dire à propos de la relation entre Dieu et la création, y compris les êtres
humains. L’acte de médiation, avec ses caractéristiques, tel qu’il est assumé par
le Christ intéresse, en effet, Dieu, l’homme et la création, et il engage la
personne du médiateur lui-même. La médiation se situe aussi dans un cadre
historique, éternel, passé, présent et futur, qui est en consonance avec l’affirma-
tion paulinienne : « Il y a un médiateur entre Dieu et l’homme, l’homme
Christ-Jésus », et « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement »
(1 Tm 2.5 ; Hé 13.8).
La médiation intervient dans l’incarnation, dans la progression qui va de la
souffrance à la gloire et dans l’accomplissement des promesses divines, accom-
plissement qui, suite au succès de l’œuvre du médiateur, est aussi vaste que le
cosmos lui-même.
Les trois offices de Christ – prophète, prêtre et roi – fournissent une clef
pour interpréter la médiation. La finalité de l’œuvre de Christ est triple : la
rédemption, Christ pour nous ; l’union avec le Christ, Christ en nous ; la
promesse de la nouvelle création, Christ avec nous éternellement.
Dieu et homme
La Réforme du XVI
e
siècle a procédé à un recentrage de la théologie
chrétienne sur le Christ et l’incarnation, qui implique aussi une révision de la
notion de médiation. Cela a touché non seulement le mouvement réformateur
avec son
solus Christus
, mais aussi le catholicisme romain et le développement
du rôle de l’Église et des sacrements comme expression d’une continuation
matérielle et horizontale de la médiation du Christ
7
. L’interprétation que fait
Calvin de la médiation s’élève contre toute extension linéaire de l’œuvre de
5.
L’ é t u d e q u i s u i t e s t b a s é sur la conférence donnée par l’auteur au colloque Calvin organisé en février et mars 2009
par la Faculté Libre de Théologie Évangélique de Vaux-sur-Seine (FLTE) et la Faculté Libre de Théologie Réformée
d’Aix-en-Provence (FLTR). Le titre de ce colloque commun était : « L’actualité de Jean Calvin : théologien, exégète et
homme d’Église ».
6.
Hendrik S
CHROTEN
,
Christus, de Middelaar bij Calvijn
, Utrecht, P. den Boer, 1948.
7.
Philippe D
ENIS
,
Le Christ étendard. L’Homme-Dieu au temps des réformes (1500-1565)
, Paris, Cerf, 1987.
TE_9.1 .fm Page 46 Jeudi, 18. février 2010 9:41 09

Le Christ Médiateur dans la pensée de Calvin
47
Christ et prend appui sur un contraste vertical entre Dieu et le cosmos. Comme
l’explique François Wendel, la notion calvinienne de médiation s’explique le
mieux sur un arrière-plan théocentrique :
Dès le début de son ouvrage, Calvin place toute sa thélogie sous le signe de ce qui a été l’un
des principes essentiels de la Réforme : la transcendance absolue de Dieu et son altérité totale
par rapport à l’homme. Il n’y a de théologie chrétienne et conforme à l’Écriture que dans la
mesure où est respectée la distance infinie qui sépare Dieu de sa créature, et où l’on aban-
donne toute confusion, tout « mélange » qui tenterait d’effacer la distinction radicale entre le
divin et l’humain. Il faut, avant tout, que Dieu et l’homme reprennent leur place véritable.
C’est là l’idée profonde qui domine tout l’exposé théologique de Calvin et qui était sous-
jacente à la plupart de ses controverses
8
.
En dehors de toute considération relative à la nature humaine déchue, il
existe une distance irréductible entre Dieu et l’homme, qui empêche tout accès
direct à la divinité et qui établit, entre Dieu et l’homme, une barrière insurmon-
table qui ruine toute idée de continuité entre eux. Dieu est radicalement autre
que l’homme et la théologie ne devrait jamais oublier le réalisme de cette situa-
tion
9
. La création, l’alliance, la rédemption et l’eschatologie manifestent
l’ampleur de ce qui différencie Dieu et la réalité et institutionnalisent la
primauté de Dieu. C’est dans cet espace entre le Dieu autarcique et ses créations
que la médiation est introduite comme condition
sine qua non
de tout contact
entre eux.
La médiation est un concept-clé de la théologie de Calvin, qui inscrit toute
la réalité sous le signe de la grâce divine et de l’accommodation
10
. Dieu doit
descendre de sa hauteur car « il n’y avait donc aucune solution à une situation
désespérée, à moins que la majesté de Dieu ne s’abaisse jusqu’à nous, puisqu’il
n’était pas en notre pouvoir de nous élever jusqu’à elle
11
». Même si l’homme
était demeuré sans péché, sa condition était trop basse pour qu’il puisse attein-
dre Dieu sans médiateur.
Non seulement la distance entre Dieu et l’homme nécessite l’existence du
médiateur, mais elle a aussi des implications profondes sur la christologie ortho-
doxe. Le magnifique chapitre 12 du livre II de l’
Institution
affirme que nous
n’avons pas à nous préoccuper de trouver un médiateur, car Christ est devenu
homme pour cela. Il a été près de nous dans son incarnation « puisqu’il est de
notre chair ». Comme il nous est impossible de contempler directement la
splendeur de Dieu, Christ prend notre chair humaine, se rend petit pour que
8.
François W
ENDEL
,
Calvin. Sources et évolution de sa pensée religieuse
, Genève, Labor ef Fides, 1985, p. 111.
9.
Alexandre G
ANOCZY
,
Calvin, théologien de l’Église et du ministère
, Paris, Cerf, 1964, p. 75.
10.
Pierre G
ISEL
,
Le Christ de Calvin
, Paris, Desclée, 1990, p. 29-37, 142, 151.
11.
IRC
2.12.1. Sur l’accommodation, voir Paul H
ELM
,
John Calvin’s Ideas
, Oxford, University Press, 2004, ch. 7.
TE_9.1 .fm Page 47 Jeudi, 18. février 2010 9:41 09

théologie évangélique vol. 9, n° 1, 2010
48
nous puissions avoir accès à son Père. Cette « auto-mortification du divin impli-
que son dévoilement dans la révélation
12
». Et pourtant, le médiateur était non
seulement vrai homme mais aussi vrai Dieu :
Il fallait qu’il engloutisse la mort. Et qui pouvait en venir à bout, sinon la Vie ? C’était à lui
de vaincre le péché ; et qui pouvait le faire sinon la Justice ?… C’est donc Dieu qui, selon sa
clémence infinie, s’est fait nôtre en la personne de son Fils unique pour nous racheter
13
.
En affirmant que la divinité et l’humanité « résident », de façon égale, dans
la personne de Christ pour des raisons exégétiques, Calvin souhaite aussi expri-
mer son respect pour la tradition chalcédonienne. Tout mélange des deux
natures est absent de la personne unique de Christ. Les deux natures se trouvent
en une seule personne, mais sans aucune fusion
14
. Ainsi, il serait inapproprié de
parler de la « nature » de Jésus-Christ au singulier, car cela impliquerait une
confusion entre le divin et l’humain, même si les deux natures subsistent en une
personne
15
. Mélanger les natures serait confondre le ciel et la terre et aurait pour
résultat une idole ou un monstre.
Cependant, chaque nature est présente sans changement dans l’unité de la
personne. Voilà pourquoi, dans son débat avec Francesco Stancaro sur la
question de savoir si la médiation implique que Christ ait agi dans sa personne
complète divine et humaine et pas seulement dans sa nature humaine, Calvin
argumente que les deux natures sont nécessaires à une vraie médiation
16
. Il
adopte la doctrine des deux natures du médiateur afin de montrer comment le
Christ satisfait à la double condition du salut : être à la fois l’agneau de Dieu
sans tache et celui qui est fait péché pour nous
17
.
L’intérêt que Calvin éprouve pour les deux natures ne relève pas d’un désir
formel de symétrie. À la lumière de la fonction assumée par le Christ, les deux
natures sont d’importance complémentaire. Ce n’est pas tant le fait de
l’humanité qui intéresse Calvin que ce qu’il implique : la vraie humanité du
médiateur, semblable à la nôtre, fait de Christ notre frère. Nous ne pouvons
nous approcher de Dieu que si notre humanité et celle de Christ sont sembla-
12.
N
IESEL
,
Calvin
, 113.
13.
IRC
2.12.2.
14.
Egbert E
MMEN
,
Christologie van Calvijn
, Amsterdam, H.J. Paris, 1935, reste une des descriptions les plus complè-
tes de la doctrine de la personne de Christ chez Calvin, mais n’aborde la question de son œuvre que de façon excep-
tionnelle.
15.
G
ISEL
,
Le Christ
, p. 37s ; ainsi la critique calvinienne de l’eutychianisme ; voir W
ENDEL
,
Calvin,
p.221ss sur
Luther, Calvin et la « communication des idiomes ».
16.
Joseph T
YLANDA
, « Christ the Mediator : Calvin versus Stancaro »,
CTJ
7, 1972, p. 5-16 ; et « The Controversy on
Christ the Mediator : Calvin’s Second Reply to Stancaro »,
CTJ
8, 1972, p. 131-157. Voir aussi Stephen E
DMOND
-
SON
,
Calvin’s Christology
, Cambridge, University Press, 2004, ch. 1.
17.
W
ENDEL
,
Calvin
,
p. 161, 163.
TE_9.1 .fm Page 48 Jeudi, 18. février 2010 9:41 09

Le Christ Médiateur dans la pensée de Calvin
49
bles. Ainsi, l’humanité n’est pas un appendice de la divinité mais une condition
nécessaire à l’accomplissement de la fonction de médiation, même si la valeur
de l’humanité de Christ tient à son union avec la nature divine : « L’humanité
du Christ n’a de valeur que par son union avec la nature divine : elle tire tout
son prix du fait qu’elle est l’humanité non d’un homme, mais du Médiateur, et
pour tout dire
l’humanité de Dieu
. Comme tel est le médium du salut, elle est
le véhicule qui va de Dieu à nous et de nous à Dieu
18
. » Ainsi l’humanité de
Christ rend Dieu plus proche de nous, en nous révélant son amour et sa
compassion, et elle fournit une preuve concrète de notre salut. Calvin dit :
Ayant pour arrhes le fait que le Fils unique de Dieu a pris corps de notre corps et a été fait
chair de notre chair et os de nos os, nous avons une ferme assurance que nous sommes enfants
de Dieu, son Père. En effet, il n’a pas dédaigné de prendre ce qui nous était propre pour être
un avec nous et nous unir à lui en ce qui lui était propre et, par ce moyen, de devenir en même
temps Fils de Dieu et fils d’homme avec nous
19
.
Pareillement le fameux enseignement d’
extra calvinisticum
ou
catholicum
ne
trahit pas un esprit spéculatif, caractéristique de Calvin
20
. Il doit son impor-
tance au contexte de la médiation et souligne que la nature divine n’est pas
modifiée dans le salut et que sa souveraineté reste entière dans cette œuvre.
Dans son incarnation, Jésus est pleinement divin. Rien de sa divinité n’est mis
de côté lorsque le Logos est devenu chair en s’incarnant en Jésus, tout en étant
totalement en dehors de lui
(extra)
. Dans la personne du médiateur, le divin ne
subit aucune mutation et, ainsi, la transcendance est présente dans la christolo-
gie, ce qui accorde un poids divin à l’histoire de la rédemption et aux actes
accomplis par Christ. La divinité n’est ni limitée ni dépendante de l’humanité,
mais réside en celle-ci. Deux passages de l’
Institution
sont particulièrement
célèbres à ce sujet :
Le Fils est descendu miraculeusement du ciel de telle sorte qu’il y est resté. Il a été miracu-
leusement porté dans le ventre de la Vierge, a vécu dans le monde, a été crucifié et, cependant,
selon sa divinité, il a continué de remplir le monde comme auparavant.
Pour la même raison, le Fils de l’homme était au ciel et sur la terre, parce que Jésus-Christ,
en tant qu’homme, a vécu ici-bas durant sa vie mortelle, et que, cependant, il n’a pas cessé
d’habiter au ciel comme Dieu (Jean 3.13). Juste après, dans le même texte, il est dit qu’il est
descendu du ciel : non pas que sa divinité ait quitté le ciel pour s’enfermer dans la chair
comme dans une prison, mais parce que celui qui remplit tout a, néanmoins, habité corporel-
18.
Max D
OMINICÉ
,
L’ h u m a n i t é d e J é s u s d ’ a p r è s C a l v i n
, Paris, Je Sers, 1933, p. 48.
19.
IRC
2.12.2.
20.
À ce sujet voir, E. David W
ILLIS
,
Calvin’s Catholic Christology : The Function of the So-called Extra Calvinisticum in
Calvin’s Theology
, Leyde, Brill, 1966, ch. II. Heiko A. O
BERMAN
, « The “Extra” Dimension in the Theology of
Calvin »,
The Journal of Ecclesiastical History
21, 1970, p.43-64. Cf. H
ELM
,
Calvin’s Ideas,
ch. 3, et E
DMONSON
,
Christology
, p. 210-15.
TE_9.1 .fm Page 49 Jeudi, 18. février 2010 9:41 09
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%