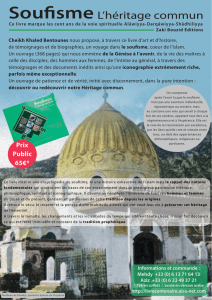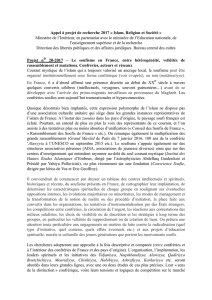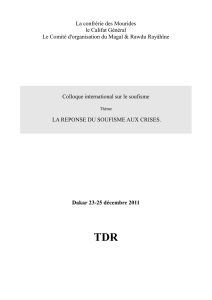Lire la suite de l`article d`Ahmed Bouyerdene écrit à la suite de la

Le soufisme, dimension intérieure de l’islam1
Ahmed Bouyerdene, chercheur en histoire.
Introduction
Les conjonctures politiques qui placent aujourd’hui l’islam sur le devant de la scène
médiatique ont pour conséquence de sortir le soufisme (tasawwuf en arabe) de l’ombre. Un
constat qui a fait dire à l’un de ses représentants que les « soufis sortaient du bois
2
». A
l’évidence le sujet, par le nombre toujours croissant de publications et de conférences qu’il
produit, interpelle toujours davantage de personnes, musulmans ou non, en quête de sens.
Car interroger le soufisme revient d’abord à poser la question du sens de la vie et de sa
finalité. Et la crise multiforme que traverse notre époque et l’angoisse qu’elle génère
donnent à ces questions une charge particulière. Il est bien sûr impossible dans le cadre de
cet article d’épuiser cette interrogation. Aucune prétention donc à l’exhaustivité mais une
volonté d’aller à l’essentiel en répondant à quelques questions : quels liens entretient le
soufisme avec l’islam ? Quelle est son origine ? Et quels en sont les principaux
fondements ?
Une seule et même réalité
Au contraire de ce qu’énoncent certaines approches simplistes, le soufisme n’est pas
une réalité religieuse qui se juxtaposerait à l’islam, ni un avatar New-Age aux couleurs de
l’islam. Selon cette logique il y aurait d’un côté le musulman, orthodoxe, et de l’autre le
soufi, hétérodoxe. Soyons clair : soufisme et islam n’ont jamais formé qu’une seule et même
réalité. A ce sujet l’image qu’aiment à utiliser les soufis pour évoquer le rapport entre islam
et soufisme est le rapport qui existe entre le lait et le beurre, … autant dire qu’il est bien
difficile de les distinguer ! Alors où se situe, si l’on peut dire, la ligne de partage des eaux
entre ces deux réalités ? Pour poursuivre sur cette métaphore, ce n’est pas en surface mais
en profondeur qu’il faut la chercher.
La Tradition pose qu’à toute réalité contingente correspond une réalité spirituelle,
que tout corps est le support d’une âme, et que la lettre n’est que le véhicule de l’esprit.
Selon cette dialectique religieuse, si l’islam est considéré comme un corps (religieux,
1
Cet article fait suite à la conférence organisée à la Maison diocésaine du Bon Pasteur à Valence le vendredi 25 février
2011 et à une session de formation délivrée dans le cadre de l’ISTR de Marseille deux mois auparavant.
2
Extrait d’un entretien du Cheikh Bentounès publié dans un journal suisse à la suite du colloque « Pour un islam
spirituel, libre et responsable » qui s’est tenu à Genève le 9 et 10 octobre 2010.

2
historique, législatif, social, etc.), le soufisme en constitue le cœur. Le soufisme est donc la
dimension intérieure de l’islam ou encore le versant ésotérique de la religion musulmane. Et
c’est en toute logique que les savants musulmans l’ont désigné comme la « science des
cœurs ». Mais avant d’explorer cet islam des « profondeurs », revenons sur ses origines
étymologique et historique.
Origine étymologique
La première origine possible pose que « sufi » est un dérivé du terme arabe sûfiya,
(« il a été purifié »), safa’ étant en arabe la pureté. En ce sens l’objectif majeur du soufisme
est, écrit l’islamologue E. Geoffroy ; « de reconduire l’homme à la pureté originelle, dans
cet état où il n’était pas encore différencié du monde spirituel
3
». La pureté originelle dont il
est question ici renvoie à une notion fondamentale en islam qui est la nature primordiale
(fitra) avec laquelle chaque être vient au monde. Et c’est son environnement familial,
religieux, social, etc., qui va déterminer son identité et remplir au fur et à mesure la page
blanche qu’il fut à son origine et à laquelle il doit revenir à sa mort.
La deuxième origine possible est liée à la laine en arabe qui se dit suf. Selon la
tradition, les prophètes et les saints s’en revêtaient. Elle est le symbole de l’ascète qui vit
dans la pauvreté matérielle et dans le détachement des contingences terrestres. De manière
générale elle est l’attribut ontologique de l’être humain. A ce sujet un verset du Coran dit
que « Ô vous les hommes, vous êtes les indigents à l’égard de Dieu, alors qu’Il Se suffit,
Lui, le Louangé
4
». Cela explique aussi pourquoi le terme faqir (pauvre ou indigent, fuqara
au pluriel) est employé dans certaines confréries soufies pour désigner le disciple.
Pour être complet ajoutons une autre origine, qui bien que décriée par les spécialistes,
est quelque fois avancée. Il s’agit de la sophia grecque et plus précisément la Sophia
perenis, la Sagesse primordiale et immémoriale. Une notion qui fait écho avec la notion de
hanifiyya dont la figure emblématique est Abraham (Ibrahim al-hanif). Il s’agit ici de la
« Religion sans nom », ou encore selon la terminologie coranique « La Religion immuable »
(al-dîn al-qayyim), qui renvoie à la question de savoir à quelle tradition religieuse appartient
Adam, le père du genre humain. Sur ce point rappelons qu’avant d’être appelé à son destin
prophétique, Muhammad Ibn ‘Abdallah a été lui-même considéré comme un hanif.
3
Eric Geoffroy, soufisme, voie intérieure de l’islam, Seuil, coll. Point Sagesses, 2009, p.15.
4
Cor. 35 : 15.

3
Origine historique
D’après la tradition musulmane, le prophète Muhammad a reçu pour mission de
transmettre à la communauté entière (al-umma) le message qui lui a été révélé. C’est vrai
pour la vulgate du Coran. Il en a été autrement pour son exégèse et certaines questions
spécifiques posées au Prophète. La transmission s’est déroulée selon des règles spécifiques
et à des niveaux différents. Si une partie de l’enseignement pouvait être reçue par le plus
grand nombre, il a existé dès l’origine de l’islam, un autre niveau d’enseignement qui n’a
concerné qu’un groupe restreint de compagnons (sahaba). Un procédé initiatique dont on
retrouve la trace dans ce témoignage très significatif d’Abû Hurayra : « J’ai gardé
précieusement dans ma mémoire deux trésors de connaissance que j’avais reçus du
messager de Dieu ; l’un, je l’ai rendu public, mais si je divulguais l’autre, vous me
trancheriez la gorge ». Par ces mots ce proche compagnon du Prophète signifie clairement
l’irrecevabilité de ce message par des personnes qui n’y seraient pas préparées. Ce hadith, et
d’autres dans la même veine
5
, montre de manière plus ou moins explicite que la notion
d’initié existe déjà aux premiers jours de l’islam. Pour être complet, il faudrait également
ajouter que le Coran admet le procédé initiatique, notamment dans le passage où Moïse, tout
prophète qu’il était, reçut une « initiation » par un « Serviteur de Dieu » (‘Abd Allah) qu’il
rencontra sur son chemin
6
.
La nature de cet enseignement ésotérique et les conditions de sa transmission ont
considérablement limité sa diffusion. Marqué du sceau du secret sa consignation par écrit
fut à l’origine extrêmement rare. Mais on en trouve cependant des traces dans certains
hadiths. La vocation initiatique est vérifiable par la qualité de l’auditoire auquel il s’adresse
et la profondeur de l’enseignement donné. Un exemple emblématique nous est fourni par le
hadith qui suit et qui met en scène le Prophète entouré d’une poignée de compagnons
lorsqu’intervient un énigmatique personnage. Le récit tel qu’il a été rapporté par un des
assistants est éloquent :
« Un jour que nous étions assis auprès de l’Envoyé de Dieu voici
qu’apparut à nous un homme aux habits d’une vive blancheur, et aux cheveux
d’une noirceur intense, sans trace visible sur lui de voyage, personne parmi nous
ne le connaissait. Il vint s’asseoir en face du Prophète, il plaça ses genoux contre
les siens et posant les paumes de ses mains sur ses deux cuisses, il lui dit : ‘’O
5
Une autre tradition attribuée au Prophète rapporte qu’avant de débuter certains enseignements, il demandait « Y’a-t-il
des étrangers parmi nous ? » L’ « étranger » ici fait allusion au non initié qui ne pourrait pas comprendre le langage des
initiés.
6
Cor. 18 : 65.

4
Muhammad : informe moi au sujet de l’Islâm. L’Envoyé de Dieu lui répondit :
l’Islâm est que tu témoignes qu’il n’est pas de divinité si ce n’est Dieu et que
Muhammad est l’Envoyé de Dieu ; que tu accomplisses la prière ; verses la
Zakât ; jeûnes le mois de Ramadân et effectues le pèlerinage vers la Maison
Sacrée si tu en as la possibilité.
Tu dis vrai ! dit l’homme.
Nous fûmes pris d’étonnement de le voir, interrogeant le Prophète,
approuver.
Et l’homme de reprendre : Informe moi au sujet de la foi (al-Imân). ‘’
C’est, répliqua le Prophète de croire en Dieu, en Ses Anges, en Ses Livres, en Ses
Apôtres, au Jour Dernier et de croire dans le Destin imparti pour le Bien et le
Mal.’’
Tu dis vrai, répéta l’homme qui reprit en disant : informe moi au sujet de
l’Excellence (al-Ihsân) ‘’C’est, répondit le Prophète que tu adores Dieu comme
si tu Le vois, car si tu ne le vois pas, certes, Lui te voit. ‘’ […]
Là-dessus l’homme s’en fût. Quant à moi je restai un moment. Ensuite le
Prophète me demanda : O, ‘Umar ! Sais-tu qui interrogeait ? Je répondis : Dieu
et son Envoyé en savent plus. « C’est Gabriel, dit le Prophète qui est venu vous
enseigner votre religion.
7
»»
Ce hadith est intéressant à double titre. D’abord par la nature même de celui qui
enseigne qui n’est autre que l’archange Gabriel, messager céleste par excellence, qui
apparaît sous les traits d’un homme et qui ne s’adresse visiblement qu’à un nombre très
réduit de témoins. Ensuite par le contenu qui démontre qu’il y a dans l’islam plusieurs
degrés dans la praxis qui correspondent à autant de niveaux de conscience
8
. Et c’est aux
confréries soufies qu’est revenue la responsabilité de ce legs spirituel dont elles vont
pérenniser la transmission selon une pédagogie actualisée à chaque époque.
7
Authentifié par l’Imam Muslim (IXe siècle) et recensé dans le recueil des 40 hadiths par l’Imam Nawawi (XIIIème
siècle).
8
Voici, par exemple, ce que dit un maitre soufi contemporain des trois niveaux auxquels fait référence le hadith : « Les
cinq piliers [de l’islam] seront pratiqués de manière superficielle ou profonde en fonction du niveau d’évolution des
individus. » Et à propos du troisième niveau, celui de l’Excellence (Ihsân), le même auteur précise qu’il « n’est pas
supportable par tous » et qu’il nécessite une préparation-initiation. Cheikh Khaled Bentounès, soufisme cœur de
l’islam, La Table Ronde, 1996, p.125.

5
Réalité ancienne et désignation tardive
A ses origines, le tasawwuf est sans nom. Cela explique non seulement la difficulté
de le distinguer de l’islam mais également de dater son apparition historique. A ce sujet une
figure soufie majeure du X
e
siècle écrit : « Le soufisme était auparavant une réalité sans
nom ; il est maintenant un nom sans réalité. » Outre l’idée que la réalité a précédé le nom
donné à la dite réalité, cette sentence laisse également entendre que la qualité de soufi
renvoie moins aux apparences extérieures ou à une étiquette, qu’à une attitude intérieure,
faite d’exigence et de sincérité. A ce sujet une catégorie de spirituels de l’islam, qu’on a
désigné sous le vocable de malamati (« les gens du blâme »), ont délibérément choisi de
refléter extérieurement la réalité inverse de leur état intérieur. Il s’agissait alors pour ces
malamati de ne laisser transparaitre d’eux mêmes, et pour ainsi dire, aucune « odeur de
sainteté ». Pour le Cheikh Ibn ‘Arabi (m. 1240), considéré comme le plus grand des maîtres
soufi (Shaykh al-akbar), ce type spirituel est le plus élevé qu’il puisse être.
C’est donc au IX
e
siècle que le soufisme prend forme et commence progressivement
à se doter d’une doctrine et d’une structure initiatique. Cette codification, qui concerne
également les autres sciences religieuses, va permettre d’assurer la transmission de cette
science dite « de l’intérieur » (‘ilm al-bâtin) qui se distingue de la « science de l’extérieur »
(‘ilm al-zâhir). Par la suite la « visibilité » du soufisme va s’affirmer avec l’apparition des
premières confréries organisées. Elles sont fondées sur la filiation spirituelle, matérialisée
par une chaîne initiatique (silsila), qui de maitre en maitre remontent jusqu’au prophète
Muhammad, et sur la relation de maître à disciple qui garantit la transmission de la baraka
(« influx spirituel »). Notons que comme tous les rituels soufis, cette allégeance spirituelle
(bay‘a) repose sur un modèle d’un événement relaté dans le Coran
9
.
La Voie soufie (tarîqa) qui est une à l’origine va au cours de l’histoire suivre un
processus de ramification. Ces turuq (pluriel de tarîqa), ou confréries, vont être désignées
du nom de leur fondateur éponyme. La tarîqa Shadhiliyya par exemple tire son nom de son
fondateur Sidi Abû l-Hasan al-Shâdhilî (m. 1258). Ce nom est quelquefois complété par
celui d’une figure majeure de la chaine initiatique considéré comme l’artisan d’une
revivification. C’est le cas, par exemple, de la tarîqa shadhiliyya-darqawiyya, dont le
« revivificateur », Mulay al-‘Arbi al-Darqawi (m. 1824), a vu son nom ajouté à celui de son
fondateur initial.
9
A la suite de la trêve dite de d’Hudaybiyah, une majorité de compagnons ont renouvelé le pacte d’allégeance avec le
Prophète : Cf Cor. 48 : 10.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%