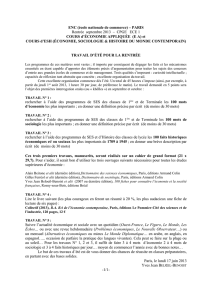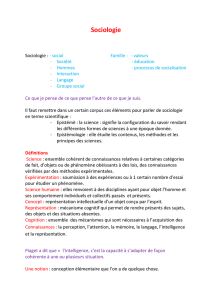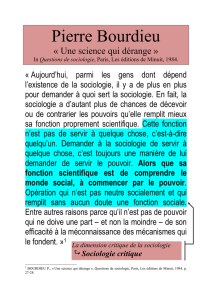Sociologie des organisations

BO, SA 2009, Sociologie des organisations 1
Sociologie des organisations
Bertrand Oberson
Résumé du cours no 10 Comprendre le social par les instruments
Les instruments ne limitent pas à révéler des stratégies ou valeurs des acteurs
L’invitation à se saisir de la matérialité de l’action publique remonte à Max Weber lui-même, qui
le premier fait de l’organisation bureaucratique un élément déterminant pour l’analyse, dès lors
qu’on entend saisir les modes de légitimation et de rationalisation de gouvernement. Ainsi, quand
Haroun Jamous et Pierre Grémion1 s’intéressent aux projets d’informatisation de l’État dans les
années 1979, c’est pour rappeler comment, derrière des mises en réseau de fichiers, des bases de
données et des ordinateurs, il y a des affrontements d’intérêts, des luttes de concurrence entre des
groupes, des corps, des institutions. À n’en pas douter, les instruments servent ici de traceurs du
social. Et le sociologue met à jour leur dimension stratégique. « Montrez moi une catégorie
statistique, une mesure de comptage de telle ou telle portion de la population ou du territoire –les
pauvres, les activités économiques à risque, les zones agricoles à handicap naturel– et je vous
dirai quels rapports de force ont présidé à leur définition, quels acteurs l’ont emporté, quels
acteurs ont perdu » : voilà ce qu’il semble revendiquer, estimant que les objets font belle et bien
quelque chose.
Cette deuxième considération bute toutefois sur une limite : faire des outils en question un pur
décalque des rapports sociaux existants, de simples prolongements matériels de tensions qui sont
ailleurs, et seulement cela. Car, dans ce cas, le chercheur revient très vite à une posture de
négation du rôle des instruments : ce ne sont pas les instruments qui comptent en fait, mais
seulement les acteurs qui les conçoivent et impriment, jusqu’à l’intérieur de leurs plus subtils
rouages, leurs propres intérêts. Cette considération paraît limitée si, en retour, l’on veut bien

BO, SA 2009, Sociologie des organisations 2
constater que les techniques polarisent les enjeux et les intérêts de manière autrement plus
irréversible que le seul jeu social des acteurs entre eux. Ainsi, pour prendre un exemple, la
différence de hauteur des tunnels et d’écartement des rails entre le métro parisien et le reste du
réseau ferré a à voir avec les conflits fondateurs, à la fin du XIXe siècle, entre la municipalité et
l’État –l’enjeu étant pour la vile de Paris de garder la maîtrise de son transport public en
empêchant les trains de circuler sur ses voies. Il n’est toutefois pas certain que ces enjeux
continuent à courir plusieurs décennies après. Quand bien même SNCF et RATP auraient intérêt
à coopérer, les contraintes matérielles continuent à s’exercer, témoignant de luttes d’un autre
temps, mais que les instruments entretiennent en quelque sorte, polarisant les enjeux et les
intérêts des protagonistes pour des raisons que, parfois, tout le monde a oubliées. Pierre
Lascoumes et Patrick Le Galès parlent, à ce propos, de l’effet d’inertie des instruments. C’est à ce
titre qu’il y a un intérêt majeur à explorer leur dimension stratégique, précisément parce qu’il n’y
a jamais de correspondance parfaite entre les intérêts des acteurs à un moment T et les outils de
l’action publique qui ont leur propre dynamique.
Une autre posture concerne ce qu’on pourrait appeler la dimension normative ou morale des
instruments. Car ces derniers supposent une certaine manière de problématiser l’action publique,
reposent sur une certaine façon de définir ce qui est bon ou mal de faire en matière publique, une
certaine conception des enjeux et des objectifs à atteindre. Bref, ils révèlent une vision des
choses. En s’intéressant aux dispositifs matériels de l’action publique, le chercheur s’efforce alors
de restituer la théorie politique qu’ils contiennent, estimant qu’en les répertoriant, en en faisant la
généalogie, il pourra rendre compte des processus de normalisation du réel : « Montrez-moi une
carte d’identité biométrique ou un radar routier, et je vous dirai quel rapport gouvernants et
gouvernés est en jeu, quelle définition de l’intérêt général et du bien public est activée, de quelle
façon les individus sont appelés à se conduire et pourquoi ».2
Il convient de ne pas se méprendre sur ces propos. Il n’est pas question ici de réduire les
instruments de l’action publique à de pures et simples « constructions sociales », révélant des
conceptions, des croyances, des représentations conçues ailleurs, sur d’autres scènes, de retourner
1 JAMOUS H. & GREMION P., L’Ordinateur au pouvoir. Essai sur les projets de rationalisation du gouvernement et
des hommes, Paris, Éditions du Seuil, 1978.
2 WELLER J.M., « Prendre au sérieux les instruments ou quatre manières d’analyser l’action publique » in BUISSON-
FENET H. & LE NAOUR G. (éd.), Les Professionnels de l’action publique face à leurs instruments, Toulouse, Éditions
Octarès, 2008, pp. 15-23.

BO, SA 2009, Sociologie des organisations 3
à l’acteur en quelque sorte (dans sa stratégie ou dans ses valeurs). Car, dans ce cas, les objets ne
sont plus véritablement pris au sérieux, réduits à n’être que des éléments révélateurs d’un social
qui est derrière eux, en filigrane, et qui demeure la seule et unique chose à analyser. C’est, par
exemple, ce qui arrive quand le chercheur souligne exagérément l’homogénéité d’une conception
à l’œuvre dans un instrument, comme si derrière chaque mesure réglementaire, chaque outil
managérial, chaque indicateur de gestion, se dessinait une élaboration logique, précise, cohérente
de l’État, des usagers, du service public ou du rôle des fonctionnaires. Au contraire, entrer dans
l’épaisseur des objets, des règles, des machines ou des instruments, c’est constater bien souvent
qu’il n’en est rien. Dans les calculs compliqués d’un indice statistique, dans l’agencement du hall
d’accueil d’une administration ou les zonages multicolores d’une carte du territoire sont à
l’œuvre des problématisations multiples pas toujours compatibles entre elles, ou des compromis,
pas toujours stables, entre des interprétations différentes d’un même phénomène. Suivre les
instruments, et considérer qu’ils disent quelque chose d’intéressant, c’est précisément restituer
ces tensions qui, sans ce détour de l’analyse, passeraient relativement inaperçues3.
Incontestablement, la description de l’action publique depuis ses instruments s’est aujourd’hui
imposée comme une entrée possible. Certes, les approches sont multiples, et s’intéressent aux
objets selon des modalités variables, selon le statut qu’on veut bien leur accorder.
3 WELLER J.M., « Prendre au sérieux les instruments ou quatre manières d’analyser l’action publique » in BUISSON-
FENET H. & LE NAOUR G. (éd.), Les Professionnels de l’action publique face à leurs instruments, Toulouse, Éditions
Octarès, 2008, p. 19.

BO, SA 2009, Sociologie des organisations 4
Tableau : les quatre manières d’appréhender l’action publique depuis les instruments4
Les instruments ne font rien Les instruments font quelque
chose
Les instruments ne disent
rien
Considération no 1
Dimension explorée : aucune
Statut des instruments : décor
Considération no 2
Dimension explorée :
stratégique
Statut des instruments :
intermédiaire, révélateur
Les instruments disent
quelque chose
Considération no 3
Dimension explorée :
normative
Statut des instruments :
intermédiaire, révélateur
Considération no 4
Dimension explorée :
pragmatique
Statut des instruments :
médiateur
Cette typologie simplifie exagérément les recherches en cours, et mériterait d’être affinée. Elle
n’en souligne pas moins une perspective importante : le détour par les instruments pour rendre
compte des formes d’intervention publique permet d’apporter des éléments nouveaux. Cela
concerne notamment la place et le statut des instruments. Les analyses des équipements de
l’action publique sont indiscutablement précieuses, mais l’invitation à les regarder de près, dans
le cours même de l’activité de travail, l’est plus encore. Elle rejoint le propos de l’anthropologue
et spécialiste des techniques qu’est François Sigaut, rappelant qu’ « un couteau ne sert pas à
couper, mais en coupant »5. L’exploration des activités de travail est également à ce prix : rendre
compte des instruments de l’action publique non pas du point de vue de la fonction que leur
4 WELLER J.M., « Prendre au sérieux les instruments ou quatre manières d’analyser l’action publique » in BUISSON-
FENET H. & LE NAOUR G. (éd.), Les Professionnels de l’action publique face à leurs instruments, Toulouse, Éditions
Octarès, 2008, p. 21.
5 SIGAUT F., « Un couteau ne sert pas à couper, mais en coupant. Structure, fonctionnement et fonction dans
l’analyse des objets » in Vingt-cinq ans d’études technologiques en préhistoire. Bilan et perspectives. Actes des XIe
Rencontres internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, Juan-les-Pins, APDCA, 1991, pp. 21-34.

BO, SA 2009, Sociologie des organisations 5
assignent leurs concepteurs, mais bien du point de vue pratique, de ce qu’ils permettent
d’imaginer et de fabriquer en situation.6
Si la présentation de l’organisation comme un système sans acteur est possible, si la présentation
des valeurs centrales dans la fonction publique peut se faire hors contexte, la présentation des
instruments s’est très vite teintée de l’influence, de l’appropriation faite par les acteurs.
6 WELLER J.M., « Prendre au sérieux les instruments ou quatre manières d’analyser l’action publique » in BUISSON-
FENET H. & LE NAOUR G. (éd.), Les Professionnels de l’action publique face à leurs instruments, Toulouse, Éditions
Octarès, 2008, p. 21.
1
/
5
100%