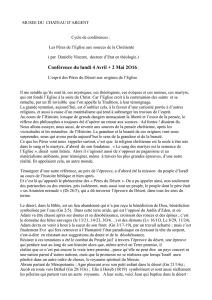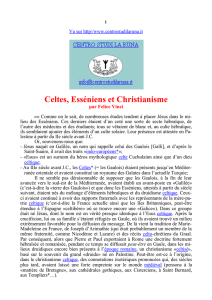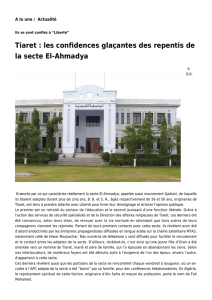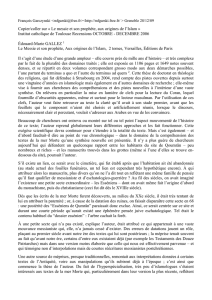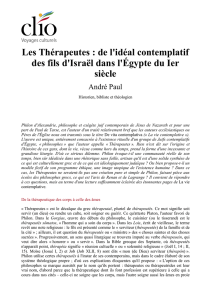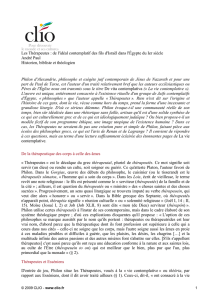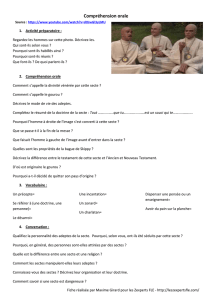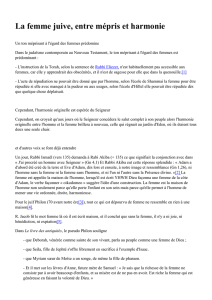téléchargez pdf - Arbre d`Or Editions


LA VOCATION DE L’ARBRE D’OR
est de partager ses intérêts avec les lecteurs, son admiration pour
les grands textes nourrissants du passé et celle aussi pour l’œuvre
de contemporains majeurs qui seront probablement davantage
appréciés demain qu’aujourd’hui.
La belle littérature, les outils de développement personnel,
d’identité et de progrès, on les trouvera donc au catalogue de l’Arbre
d’Or à des prix résolument bas pour la qualité offerte.
LES DROITS DES AUTEURS
Cet e-book est sous la protection de la loi fédérale suisse sur le droit
d’auteur et les droits voisins (art. 2, al. 2 tit. a, ). Il est également
protégé par les traités internationaux sur la propriété industrielle.
Comme un livre papier, le présent fichier
et son image de
couverture sont sous copyright, vous ne devez en aucune façon les
modifier, les utiliser ou les diffuser sans l’accord des ayant-droits.
Obtenir ce fichier autrement que suite à un téléchargement après
paiement sur le site est un délit.
Transmettre ce fichier encodé sur un autre ordinateur que celui
avec lequel il a été payé et téléchargé peut occasionner des dommages
informatiques susceptibles d’engager votre responsabilité civile.
Ne diffusez pas votre copie mais, au contraire, quand un titre vous
a plu, encouragez-en l’achat : vous contribuerez à ce que les auteurs
vous réservent à l’avenir le meilleur de leur production, parce qu’ils
auront confiance en vous.

© Arbre d’Or, Cortaillod, (), Suisse, janvier 2009
http://www.arbredor.com
Tous droits réservés pour tous pays
La secte
des Esséniens
Essai critique sur son organisation,
sa doctrine, son origine
èse de doctorat en théologie
présentée à la faculté catholique de Lyon
par l’abbé A. Regeffe
de la Maison des Chartreux
Lyon — 1898

LA SECTE DES ESSÉNIENS
4
PRÉFACE
Au commencement du siècle dernier, un Allemand nommé Wachter crut
avoir trouvé, dans les ressemblances de certaines pratiques entre les esséniens et
les premiers chrétiens, la preuve de l’origine essénienne du christianisme. Cette
thèse fut reprise à la, fin du XVIIIe siècle par le moraliste Stæudlin dans son
Histoire de la morale de Jésus-Christ ; et cinquante ans plus tard, Pfrœrer décla-
rait dénué de tout sens historique quiconque n’admettait pas avec lui un lien
de parenté directe entre l’essénisme et le christianisme. Victorieusement com-
battue par de Wegnern, cette thèse a été reprise à nouveau de nos jours par
Lenormand, Cohen et Grœtz. Par des voies diverses, ces trois historiens abou-
tissent à la même conclusion, à savoir : l’essénisme est au christianisme ce que
la tige est à la fleur. Tout en combattant cette conclusion, Stapfer, dans son
récent ouvrage : Jésus-Christ avant son ministère, semble faire une très grande
part à l’essénisme dans la formation de la conscience religieuse de Jésus.
En face de cette prétention d’une certaine critique rationaliste d’expliquer
Jésus et sa religion par l’essénisme ; une double tâche incombe à l’apologiste :
rendre à la secte sa vraie physionomie, montrer, en mettant en face l’une de
l’autre les deux doctrines, qu’il y a, entre l’essénisme et le christianisme, toute
la distance qui sépare le divin de l’humain.
Un travail de cette étendue dépassait les limites de cette étude : nous nous
sommes borné à refaire la biographie de la secte. L’histoire, ordinairement ou-
blieuse des hommes qui ne jouent pas un rôle apparent sur la scène d’une na-
tion, a laissé dans l’ombre une secte étrangère aux luttes religieuses et poli-
tiques de sa patrie, et sans autre ambition que celle de réaliser, dans la solitude
et par la mortification des passions, l’idéal entrevu de la vertu. À la faveur de
cette demi-obscurité, une foule d’hypothèses se sont fait jour et ont altéré des
traits de la physionomie des esséniens.

LA SECTE DES ESSÉNIENS
5
Notre but est de rendre à la secte sa vraie physionomie, celle même qui se
dégage des récits de Philon et de Josèphe, et ainsi de préparer à l’apologétique
un terrain sûr et facile.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
1
/
67
100%