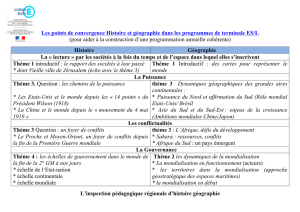La mondialisation: pour une évaluation éthique?1

La mondialisation:
pour une évaluation éthique?1
Tout le monde parle de nos jours du mouvement de mondiali-
sation et de globalisation qui marque l’économie à l’heure actuelle2.
Les uns y voient un phénomène des plus périlleux qui constitue
une grave menace pour la cohésion et la solidarité dans nos socié-
tés3, tandis que d’autres perçoivent là une chance à saisir, moyen-
nant adaptation4. Intuitivement on saisit de quoi il s’agit. On a
peine néanmoins à analyser ce qui est sous-jacent à cette notion
nouvelle et dès lors, à en évaluer les conséquences. Il s’agit certes
d’abord d’un processus économique, mais dont les implications
au plan social et culturel sont de première importance.
I. – Le phénomène de la mondialisation
Le terme nous vient des années 1980. Il a été forgé par les éco-
nomistes dans leur effort pour rendre compte d’un stade nouveau
de l’économie marqué par son internationalisation5. Parmi ses
caractéristiques, on relève d’abord une intensification et un élar-
gissement du commerce international. Celui-ci croît plus vite que
l’économie elle-même. En cinquante ans, le commerce mondial
s’est multiplié dix-sept fois tandis que la production mondiale,
quatre fois.
Conséquence de ce nouvel état de fait, la référence des princi-
paux acteurs économiques ne se réduit plus à un seul pays, à une
NRT 122 (2000) 51-67
É. HERR, S.J.
1. Cet article fut remis à la rédaction avant l’ouverture de la Conférence de
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) à Seattle, le 30 novembre 1999.
2. En français ces deux termes sont utilisés comme synonymes. On pourrait
dire que la mondialisation suggère davantage la dimension géographique tandis
que la globalisation signifie l’intégration d’une pluralité de domaines et d’aspects.
3. H.-P. MARTIN, H. SCHUMANN,Le piège de la mondialisation, Solin, Paris,
Actes Sud, 1997.
4. H. BOURGUINAT, L’économie morale, Paris, Arléa, 1998; D. COHEN, Richesse
du monde, Pauvretés des nations, Paris, Flammarion, 1997; A. MINC, La mon-
dialisation heureuse, Paris, Plon, 1997.
5. F. SACHWALD, L’Europe et la mondialisation, Paris, Flammarion, 1997.

seule région, mais se trouve constituée par le monde entier perçu
comme un seul et unique système global. Des pays et des conti-
nents entiers émergent pour devenir des acteurs dans ce système
unique. C’est le cas de l’Asie, mais aussi de l’Amérique latine.
Une partie substantielle du commerce international se déroule
entre filiales, à l’intérieur de sociétés multinationales. Cette inté-
gration mondiale des marchés de biens et de services s’accentua
évidemment par l’implosion de l’empire soviétique et par la
réforme de Deng Xiaoping en Chine.
Autre conséquence de cet état de fait: à côté de cette croissance
impressionnante du commerce mondial, on assiste surtout à par-
tir de la deuxième moitié des années 1980, — et c’est un deuxième
élément à relever — à un essor remarquable de l’investissement
direct à l’étranger (IDE). Celui-ci s’élevait à 315 milliards de dol-
lars en 1997, contre 60 milliards en 1980. Il passe par la prise de
contrôle d’entreprises à l’étranger. La Belgique constitue ici un
exemple éloquent des conséquences du processus qui s’engage
alors6. Mais l’IDE, c’est aussi la délocalisation d’unités de pro-
duction à l’étranger ainsi que le transfert de technologies.
Enfin, en troisième lieu, il faut mentionner évidemment le déve-
loppement explosif des marchés financiers. Les transactions quo-
tidiennes sur le marché des changes sont passées de 200 milliards
de dollars en 1986 à plus de 1800 milliards en 1998. Or 90% de
ces échanges de monnaies n’ont pratiquement pas de rapport avec
le commerce des biens et des services7. On assiste ainsi à une
mondialisation financière marquée par une forte instabilité, ponc-
tuée de crises impressionnantes, ainsi qu’à l’explosion de produits
sophistiqués nouveaux. Dans ce mouvement qui va s’accélérant,
un risque de dérapage généralisé n’est toujours pas à exclure,
52 É. HERR, S.J.
6. Depuis 1987, année du rachat par Suez de la Société Générale, première
société holding belge qui contrôle directement ou indirectement une part sub-
stantielle de l’économie belge, jusqu’en 1999, année du rachat de Cockerill-
Sambre, premier sidérurgiste belge, de Pétrofina, premier opérateur industriel
belge spécialisé dans les carburants, et de Tractebel qui contrôle le secteur éner-
gétique belge, en passant tout au long de ces années par les rachats de la Sabena,
de la Banque Bruxelles-Lambert, et, dans le domaine des assurances, de la Royale
Belge ainsi que par ceux de tant d’autres, ce sont de fait les fleurons de l’écono-
mie belge qui, en une dizaine d’années, sont passés sous contrôle étranger, sur-
tout français.
7. Les gains de cette spéculation sont colossaux. Le Monde diplomatique
d’octobre 1998 comparait les gains réalisés par 350 agents (traders) de la Citibank
en un semestre et les profits du groupe Peugeot (PSA) et de ses 140 000 employés
durant la même période. En dollars, Citibank a gagné 552 millions, alors que
PSA gagnait 330 millions.

dérapage qui pourrait se produire à partir des États-Unis. Un
autre aspect de la mondialisation des marchés financiers réside
dans le fait que les fameux fonds de pension deviennent des
actionnaires importants et parfois déterminants dans les entre-
prises du monde entier. Il suffit de se rappeler la bataille de l’été
1999 en France entre la Banque Nationale de Paris (BNP) et la
Société Générale (SG).
II. – Les moteurs de la mondialisation
Peut-on identifier les éléments moteurs de cette impressionnante
évolution? En premier lieu on doit mentionner une mentalité
nouvelle, celle du néo-libéralisme des années 80 qui se traduit par
la déréglementation8de la vie économique amorcée par Margaret
Thatcher et Ronald Reagan. Il s’agit aussi de la privatisation de
pans entiers de la vie économique, de l’abaissement des barrières
douanières, de la libéralisation des marchés monétaires et finan-
ciers déjà initiée dès 1971 quand Richard Nixon décida de laisser
flotter le dollar américain en le déconnectant de l’étalon-or.
Autant de dispositions qui entraînaient un retrait structurel des
États en tant qu’acteurs économiques.
En second lieu il faut souligner l’extraordinaire montée en puis-
sance des entreprises multinationales. P.-N. Giraud les qualifie
d’entreprises «nomades»9. En effet, celles-ci sont de moins en
moins enracinées dans un pays donné et liées à une nation. Leurs
intérêts ne coïncident pas avec ceux des États nationaux. Leur
localisation et leur actionnariat10, leurs matières premières ainsi
que leur main-d’œuvre et leurs produits deviennent effectivement
globaux. La frénésie des fusions d’entreprises conduit à l’émer-
gence de méga-entités de taille et de capacité mondiales dans beau-
coup de domaines et secteurs de la vie économique: sciences de la
LA MONDIALISATION 53
8. Dérèglementation signifie «libération» par la concurrence des prix et des
salaires, mais aussi démantèlement des droits acquis, des statuts privilégiés et des
positions protégées. Qu’on se rappelle les conflits avec les syndicats auxquels
celle-ci a donné lieu.
9.
P.-N. G
IRAUD
, L’inégalité du monde, Paris, Gallimard, 1996, p. 52;
J.-L. M
UC
CHIELLI
,
Multinationales et Mondialisation, Paris, Seuil, 1998; R. REICH,
L’économie mondialisée, Paris, Dunod, 1993.
10. Il s’agit notamment des fonds de pensions, surtout américains, qui contrô-
lent près de 8000 milliards de dollars de capitaux, c’est-à-dire le tiers du revenu
mondial. À titre de comparaison, les réserves officielles des banques centrales en
devises représentent 553 milliards de dollars. Cf. Ph. ENGELHARD, L’homme
mondial, Paris, Arléa, 1996, p. 74.

vie, banques et assurances, pétrole, industrie automobile, télécom-
munications, etc.11 Ainsi calcule-t-on que la production réalisée
dans le cadre d’une économie mondialisée, laquelle désormais
représente 65 % de la production mondiale, a quadruplé durant
les dix dernières années. Le chiffre d’affaires des cent premières
entreprises, ces nouveaux maîtres du monde comme les appelle le
journal Le Monde, est de 2 100 milliards de dollars, une fois et
demie le PIB de la France.
Il semble bien néanmoins que le moteur essentiel de la mondia-
lisation à laquelle nous assistons présentement consiste dans le
progrès technique phénoménal qui a touché tous les domaines de
la vie économique au cours des dernières années, particulière-
ment dans l’informatique, les communications et les transports12.
À vrai dire, ce progrès technique s’avère la condition de possibi-
lité de la mondialisation actuelle, notamment grâce à l’augmenta-
tion de la productivité et à la baisse des coûts de production qu’il
rend possible. On discute certes entre spécialistes pour savoir ce
qui est premier, le progrès technologique comme cause de la mon-
dialisation, ou, au contraire, la mondialisation elle-même qui, par
la concurrence des marchés, sollicite le progrès technique en vue
d’une plus grande compétitivité13. Sans doute y va-t-il d’une cau-
salité réciproque. Le mouvement est circulaire.
III. – Conséquences de la mondialisation
La mondialisation entraîne une concurrence globale accrue.
A. Minc a raison quand il dit qu’avec la chute de l’empire sovié-
tique dans les années 1989-1990 on pouvait espérer l’établisse-
ment d’un régime général de démocratie, mais qu’en fait c’est le
marché qui s’est imposé14.
54 É. HERR, S.J.
11. L’OPA hostile de ATT sur Mediaone en avril 1999 valait 62.5 milliards
de dollars. La fusion de MCI Worldcom et de Sprint (télécommunications) por-
tait sur 115 milliards de dollars. Ce «monde en fusion» constitue un paradoxe.
D’une part, il institue une concurrence désormais mondiale très forte, mais, de
l’autre, de par la concentration qu’il produit, il institue aussi des quasi-mono-
poles, comme c’est le cas par exemple avec Microsoft.
12. Qu’il suffise de mentionner ici les mass media, la télécopie, Internet, le
téléphone mobile, les satellites de communication. Il y a là un potentiel de chan-
gement qui se poursuit à un rythme époustouflant et qui n’est pas sans réper-
cussions politiques de premier plan.
13. P.-N. GIRAUD, L’inégalité… (cité supra, n. 9), p. 291.
14. A. MINC, La mondialisation…, (cité supra, n. 4), p. 11.

Relevons d’abord les apports positifs qu’on peut espérer de la
mondialisation. En effet, à moins d’une crise financière aux États-
Unis ou ailleurs dans le monde, on peut espérer une croissance
soutenue. Celle-ci sera sûrement répartie inégalement. Des régions
entières comme l’Europe de l’Est et surtout l’Asie et l’Amérique
latine pourront en profiter. Disposant d’une main-d’œuvre à la
fois bon marché et capable de produire des biens de consomma-
tion courants et même sophistiqués, ces régions sont déjà très
compétitives sur le marché mondial. Par rapport à ce qu’on
appelait le tiers-monde dans les années 1960, il y a là un avantage
comparatif qui constitue un atout important de rattrapage, sus-
ceptible de tourner à l’avantage de ces régions.
Par ailleurs, les personnes qui, dans le monde entier, seront
capables de travailler dans les nouvelles technologies seront assu-
rées de bénéficier de conditions de rémunérations très favorables.
On peut encore ajouter à cet état de fait que les consommateurs
pourront en général jouir de biens et de services à des prix concur-
rentiels, ce qui permet à un Paul Krugman, par exemple, de por-
ter sur la mondialisation comme phénomène de spécialisation
internationale un jugement globalement positif15.
Mais, comme nous allons le voir, les conditions de vie des salariés
et des acteurs économiques non liés aux nouvelles technologies
pourraient s’avérer moins enviables. Sur ce plan, mentionnons
quelques risques. Les fonds d’investissement et les fonds de pen-
sion exercent une pression indéniable sur la gestion des entreprises.
Ceux-là forcent celles-ci à rémunérer ces actionnaires puissants à
des taux qui par ailleurs ne peuvent qu’être dommageables pour
les travailleurs. On pourrait ainsi facilement se trouver devant le
paradoxe suivant: la même personne peut à la fois comme épar-
gnant bénéficier des rentrées du fonds de pension auquel elle
cotise et, par ailleurs, en tant que travailleur, risquer d’être mise
au chômage sous la pression que ce même fonds de pension exerce
sur la gestion de l’entreprise qui l’embauche.
Autre point à relever: les crises financières ont mis en lumière
la vulnérabilité des sociétés nationales par rapport aux mouve-
ments financiers internationaux. Au Mexique, par exemple, les
gens simples ont souffert ces dernières années de diminutions
de leur pouvoir d’achat allant jusqu’à 35 %. Un système inter-
national régulé par la seule loi du marché peut être d’une grande
brutalité. Ceux qui ne sont pas compétitifs se trouvent largués
LA MONDIALISATION 55
15. P.-R. KRUGMAN, La mondialisation n’est pas coupable, Paris, La Décou-
verte, 1998.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%