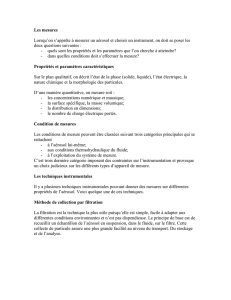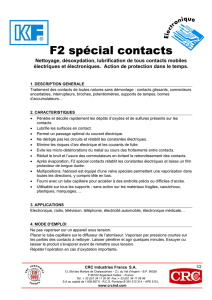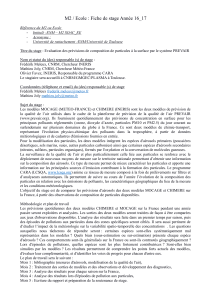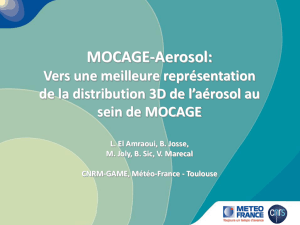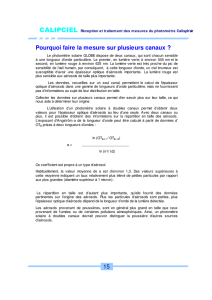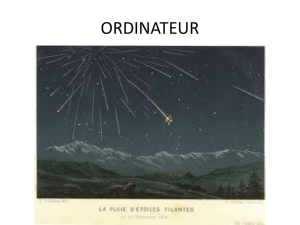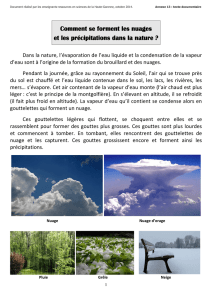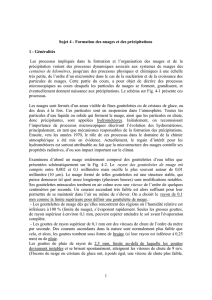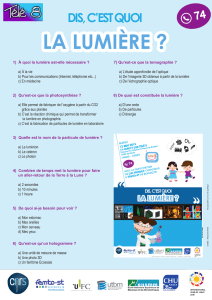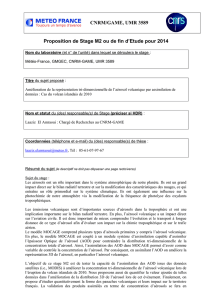9ième Congrès de Mécaniqu

___________________________________________________________________________________________________
9
ième
Congrès de Mécanique, FS Semlalia, Marrakech 196
Etude de l’Impact de la production naturelle des
aérosols marins sur le comportement
microphysique d’un nuage convectif.
R. MERROUCHI
1
, J. Piazzola
2
et M. Chagdali
3
1. Direction de la Météorologie Nationale (Casablanca), 2.
Laboratoire des échanges particulaires aux interfaces (LEPI)
(Université Toulon-Var) 3. Laboratoire de Calcul Scientifique en
Mécanique, Faculté des Sciences Ben M'sik, (Casablanca)
Introduction
L'atmosphère contient des particules en suspension
d'origine diverses naturelles ou anthropiques constituant
l'aérosol atmosphérique. En fonction de leur taille, les
aérosols sont soumis à des processus de transport et de
dépôt différents et possèdent des propriétés optiques et des
durées de vie extrêmement variables.
La mer, par sa grande superficie qui représente les ¾ de la
surface du globe, est la première source des aérosols
atmosphériques naturels. La composition chimique, la
concentration et la taille des aérosols marins font d’eux un
moyen d’échange de chaleur et de matière entre
l’atmosphère et l’océan. Par diffusion et absorption des
rayonnements électromagnétiques, les particules d'aérosols
influent sur la couche limite atmosphérique et sur le bilan
radiatif de la planète. Les particules de faible rayon jouent
un rôle important au niveau du climat en tant que noyau de
condensation (CCN) essentiel pour la formation des nuages
et des précipitations.
L’interaction aérosol nuage est un mécanisme fondamental
influençant le processus de précipitation. En effet, les
processus microphysiques régissant la croissance des
gouttelettes d’eau à l’intérieur du nuage dépendent du
spectre initial et de la composition chimique des aérosols
atmosphériques pris dans les courants ascendants
alimentant ce dernier.
Afin d’étudier l’impact des aérosols marins sur le
comportement microphysique des nuages, un couplage a été
réalisé entre le modèle (MEDEX) de production des
aérosols marins et de calcul du coefficient d’extinction
associé et un modèle de nuage à microphysique détaillée
(ExMIX).
Les simulations ont porté sur un nuage convectif (à phase
mixte) en utilisant des spectres initiaux d’aérosols
d’origines différentes. La comparaison entre les résultats
obtenus en utilisant un spectre d’aérosol continental et un
spectre d’aérosols marins montre que certaines propriétés
microphysiques ont été modifiées influençant en
conséquence les conditions de déclanchement des
précipitations ainsi que les quantités recueillies au sol.
1. Les aérosols marins :
L’aérosol marin est produit par le spray océanique. Sous
l’action des vagues déferlantes, des gouttelettes d’eau de
grosse taille sont projetées dans l’atmosphère. Après
évaporation de l’eau de mer, les sels marins solides se
retrouvent dans l’atmosphère et constituent des aérosols.
Au niveau global ce type d’aérosol domine largement et il
est à l’origine de la formation des pluies sur les océans. La
composition chimique de ce type d’aérosol est proche de
celle de l’eau de mer. On retrouve donc essentiellement du
chlore et du sodium, mais aussi de grandes quantités de
nitrates et de sulfates. Le taux d’émission annuel de
l’aérosol marin est d’environ 10
9
tonnes ce qui représente
plus de 42% de la masse totale des aérosols
atmosphériques.
La nécessité d’introduire un terme source pertinent dans les
modèles numériques de nuages et de transport
atmosphérique explique l’intérêt que soulève depuis
plusieurs années l’étude des processus de génération de
l’aérosol produit par le déferlement des vagues. La
méthodologie, adoptée pour ce travail, est basée sur l’étude
des relations entre le taux de couverture moutonneuse
(witecapping) et les paramètres météorologiques couplées à
des mesures de surface de déferlement (Piazzola et al.,
2002).
1.1 Mode de génération.
Deux phénomènes sont à l’origine de la génération des
aérosols marins :
a. Mode direct : (Ecrêtage)
A partir d’une certaine valeur du vent à la surface de la mer
(9m/s), les gouttelettes sont arrachées mécaniquement des
crêtes des vagues en misant en suspension des grosses
particules (spume drops) de diamètre dépassant les 10 µm.
A cause de leur taille, ces particules ont une courte durée de
vie dans l’atmosphère et retombe à proximité de leur lieu de
production.
Photographie de l’écrêtage direct des gouttes à partir d’une
surface libre. (Photographie par Hoyt and Taylor (1977))
b. Mode indirect : (bubbling)
Lors du déferlement des vagues, de l’air est entraîné dans
l’eau sous forme de bulles qui peuvent être immergées
jusqu’à des profondeurs de plusieurs mètres avant de
remonter en surface où elles éclatent, donnant naissance à
deux familles de gouttelettes.
Eclatement d’une bulle à travers une surface libre. Blanchard
(1963)
Les Gouttelettes de film :
Elles apparaissent à partir de la première phase de
l’éclatement de la calotte sphérique de la bulle à l’interface
eau-mer. Leur hauteur d’éjection est de 5 à 10 mm. Le
diamètre de la bulle mère est compris entre 300 µm et
10mm. Le nombre (Nf) de gouttes de film par bulle de
diamètre Db (en mm) est définie par :
3/5
3/5
bf
DN =
(Resch et Afeti (1991))
Les Gouttelettes de jet :
Dans la seconde phase de l’éclatement de la bulle, le
dégonflement de la cavité interne, après la disparition de la
cavité sphérique, produit un jet d’eau instable qui se
dissocie en un chapelet de gouttelettes qui compte au
maximum 10 gouttes par bulle. Ce nombre est d’autant plus
faible que la taille de la bulle mère est grande. Blanchard

___________________________________________________________________________________________________
9
ième
Congrès de Mécanique, FS Semlalia, Marrakech 197
(1983) relie le nombre de gouttes de jet Nj au diamètre de
la bulle « mère » Db par la loi suivante :
)3/exp(5.7
bj DN
−
=
1.2
Couche moutonneuse (Whitecap).
Une manifestation de l’entrainement de l’air dans l’eau lors
du déferlement des vagues est la couverture blanche
apparente à la surface appelée communément : la couche
moutonneuse.
La production des aérosols marins est proportionnelle à la
fraction de couche moutonneuse (W%). En effet, le nombre
de particules de rayons r produites par m
2
de surface, par
seconde et pour une incrémentation d’un µm de r est de :
dF/dr = Wτ
−1
dE/dr
τ étant un temps constant caractérisant l’amortissement
exponentiel de la couche moutonneuse (généralement
τ=3.53 s) et dE/dr le nombre de gouttelettes par incrément
du rayon produit lors de la phase d’amortissement pour une
unité de surface de cette couche moutonneuse (exprimée en
m
−2
µm
−1
). Il est bien évident que la concentration des
aérosols augmente avec la fraction de la couche
moutonneuse et en conséquence une meilleure
connaissance de cette fraction W est d’une extrême
importance pour la détermination des concentrations des
aérosols marins.
Monahan et al. (1986)
avec B = (0.38−logr)/0.650 et r (en µm) le rayon des
particules dans un air avec une humidité relative de 80%.
Pour ce travail on a adopté, pour le calcul de la fraction
moutonneuse, la formulation de J.piazzola (2001) qui prend
en considération, outre l’effet du vent, la longueur du fetch
correspondant :
où C
D
est le coefficient de traînée, U
10
la vitesse du vent à
10m de la surface de la mer et X la longueur du fetch
exprimée en mètres.
2. Le modèle MEDEX :
Le modèle MEDEX calcule la distribution de taille des
particules d’aérosols marins ainsi que le profil d’extinction
de 0 à 25 mètres de hauteur en utilisant la loi de Mie.
MEDEX a été développé sur la base d’une série de mesures
acquises sur l’île de Porquerolles (Toulon-France) entre
2000 et 2001. Durant cette période, une large variété de
distribution d’aérosols a été enregistrée sous différentes
conditions météorologiques. La distribution des particules
est prise comme étant la somme de quatre fonctions log
normales dont les modes sont paramétrés en fonction de la
vitesse du vent et de la longueur du fetch.
−= ∑
=
2
0
4
1
))log((exp
)(
i
i
i
i
fr
r
C
f
A
drrdN
Les résultats de ce modèle ont été comparés à des
observations effectuées en mer noire et en mer
méditerranée.
3. Le modèle de nuage ExMIX
Le modèle 1D½ de nuage EXMIX (EXternally MIXture),
est basé sur un concept de suivi pas à pas de l’évolution du
spectre des particules d’aérosol (humidification puis
formation et croissance des gouttes et cristaux de glace). A
cet effet, deux fonctions tridimensionnelles f
wat
(m, m
AP,N
,x)
et f
ice
(m, m
AP,N
,x) sont utilisées, la première pour les
particules d’aérosol humides et les gouttes d’eau, la
seconde pour les cristaux de glace. Chacune donne le
nombre (par unité de volume) d’hydrométéores de masse
m, et dont le noyau de condensation-congélation initial (la
particule d’aérosol) avait une masse m
AP,N
.
La troisième
coordonnée x décrit la composition chimique de l’aérosol.
Afin de simuler une situation nuageuse, le modèle
considère deux cylindres imbriqués, le premier représentant
la zone ascendante du nuage, et le second l’environnement
non nuageux subsidant. Les cylindres sont découpés en
couches de 100 m de hauteur chacune.
L’air atmosphérique est représenté à l’aide de neuf
paramètres, supposés homogènes horizontalement dans
chacun des cylindres considérés : les trois composantes de
la vitesse de l’air, sa masse volumique et sa température, la
pression, la quantité de vapeur et les distributions en
nombre des particules.
La grille des masses utilisée est logarithmique, ce qui
permet d’avoir plus de précision pour les petites tailles et de
représenter correctement la formation et la croissance
rapide des petits cristaux.
Différents processus microphysiques de formation et de
croissance des particules humides et solides sont pris en
considération dans le modèle.
4. Le Couplage MEDEX/ExMIX
Dans le cadre de la présente étude, un couplage a été réalisé
entre les deux modèles MEDEX et ExMIX selon le schéma
suivant :
5. Les Simulations
Pour initialiser le modèle ExMIX, il est indispensable de
disposer de paramètres thermodynamiques (profils de
température et d’humidité) et microphysiques (composition
chimique et spectre dimensionnel des aérosols). En ce qui
concerne les premiers, on a pris en compte le sondage de
température et d’humidité de Miles City à 14h40
(campagne
CCOPE 19 juillet 1989).
A partir de ce profil thermodynamique de base, on extrait
les conditions météorologiques de surface devant servir
d’Input au modèle MEDEX.
Pour initier la convection dans le modèle ExMIX, un
chauffage au sol de 2.3°C est appliqué pendant les 10
premières minutes d’intégration.
Pour les simulations, on considère également les particules
comme étant un sel d’acide sulfurique (H
2
SO
4
), de masse
molaire 98g/mol et entièrement soluble ( ε
s
=1 ).
Pour la distribution dimensionnelle de départ, on a utilisé
deux spectres :
• Un continental de 3 modes log-normaux selon la
formule de Jaenicke, 1988:

___________________________________________________________________________________________________
9
ième
Congrès de Mécanique, FS Semlalia, Marrakech 198
• le spectre d’aérosols marins à quatre modes log-
normaux issu du modèle MEDEX.
6. Les résultats :
- Spectre continental :
Suite au réchauffement imposé au sol, un courant ascendant
se développe permettant l’ascension des particules d’air et
la formation des particules nuageuses par condensation. Les
courants ascendants atteignent un maximum de 18 m/s
établit après 10 minutes d’intégration et à partir d’une
altitude de 3500m. Les courants ascendants demeurent
assez forts à l’intérieur du nuage (entre 12 et 18m/s).
Evolution temporelle des vitesses verticales (m/s)
Après 30 minutes d’intégration, un courant subsident
organisé s’installe entre la base du nuage et des altitudes
atteignant les 8000m avec un maximum de 6m/s localisé
vers la base du nuage. Cette subsidence est liée à la chute
des particules précipitantes et se poursuit à partir de 50
minutes au niveau des basses couches matérialisant la pluie
qui arrive au sol. La base du nuage se trouve à 3000m
d’altitude (MSL) et le sommet atteint 9.7km (MSL) vingt
minutes plus tard.
600 1200 1800 2400 3000 3600
Temps (s)
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
A
l
t
i
t
u
d
e
(
m
)
Évolution du Contenu en eau en g/m3.L’eau nuageuse (r<40µm)
en noir, l’eau précipitante en bleu
Les hydrométéores, de taille précipitante, apparaissent 30
minutes après la formation du nuage sous forme de gouttes
précipitantes mais à des altitudes assez élevées (8000m).
La valeur maximale du contenu en eau liquide nuageuse
r<40µm) est estimée à 2 g/m
3
et de 1.5g/m
3
pour l’eau
précipitante.
- Spectre maritime :
En adoptant un spectre initial d’aérosols marins, les
courants ascendants sont plus prédominants entre les
altitudes 4000 et 8000m.
Les courants descendants dans le nuage sont plus courts
mais deviennent plus importants près de la surface au-delà
de 40 minutes d’intégration. L’eau précipitante apparaît
plus tôt (20mn au lieu de 32mn) et à des altitudes plus
basses (6600m au lieu de 8200m). Les précipitations
atteignent plus rapidement le sol (2200mn au lieu de
2600mn) et la quantité d’eau recueillie est plus importante
avec un contenu en eau dépassant 2 g/m
3
.
En conclusion, les simulations conduites mettent en
évidence l’importante contribution des aérosols marins dans
le processus de formation des précipitations en favorisant
un déclenchement précoce du processus de précipitation et
un accroissement des quantités de précipitations recueillies
au sol.
Bibliographie :
Étude d’un nuage convectif de type cumulonimbus avec un
modèle de microphysique détaillée
(A.Flossman, W.Worbrock,
D.Leroy 2004).
A Numerical study of the effects of the aerosol particle
spectrum on the development of the ice phase and precipitation
formation
(D.leroy, M.Monier, W. Worbrock, A.Flossman 2001).
A Sea spray generation function for fetch-limited conditions
(J.
Piazzola, P. Forget, and S. Despiau. Annales Geophysicae-2002).
Vertical distribution of aerosol particles near the air-sea
interface in coastal zone
(J. Piazzola and S. Despiau. J. Aerosol Sci-
1997).
Performance evaluation of the coastal aerosol extinction code
MEDEX with data from the Black Sea
(PIAZZOLA J;
KALOSHIN G. Journal of aerosol science. 2005).
1
/
3
100%