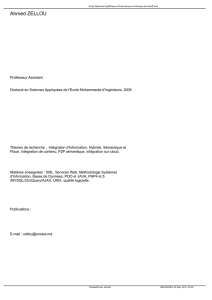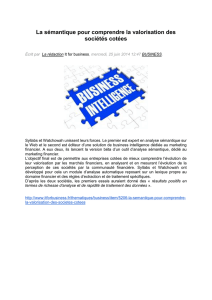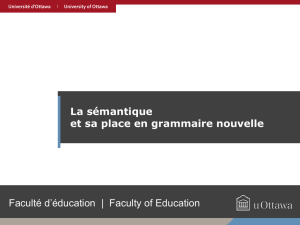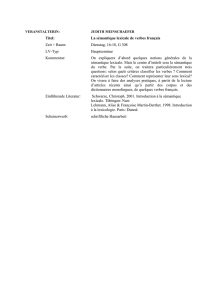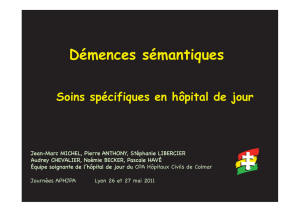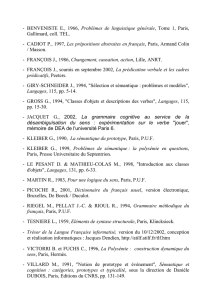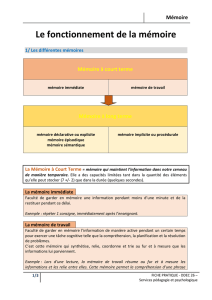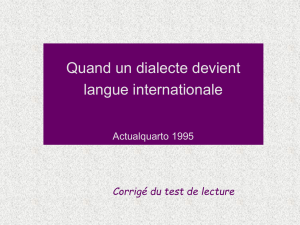Démence sémantique ou troubles sémantiques progressifs

La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. II - juin 1998 115
MISE AU POINT
nitialement décrites par Arnold Pick il y a maintenant un
siècle, les affections dégénératives caractérisées par l’alté-
ration sélective d’une conduite humaine (cognitive ou com-
portementale), d’installation insidieuse et d’aggravation pro-
gressive, et par une atrophie corticale focale, font actuellement
l’objet de nombreux travaux. Dans ces syndromes dégénératifs
“focaux” (tableau I) les patients peuvent rester autonomes pen-
dant plusieurs années, avant que ne s’installe une altération
cognitive plus diffuse et un syndrome pouvant être qualifié de
démence.
Le terme de démence sémantique apparaît en 1989 (Snowden et
coll. 1989) et qualifie un tableau clinique en relation avec une
atteinte progressive de la mémoire sémantique avec perte du
savoir sur les choses, les objets, les lieux et les personnes.
TABLEAU CLINIQUE
Les patients consultent habituellement de leur propre gré et se
plaignent d’un trouble de la “mémoire des mots”. Très
conscients de leur trouble, parfaitement orientés dans le temps
et dans l’espace familier, ils disent ne plus retrouver les noms
des choses et des personnes et avoir des difficultés pour com-
prendre certains mots qu’ils entendent ou lisent. Ils évoquent
aisément les événements qu’ils vivent quotidiennement. Le lan-
gage conversationnel est de débit normal, informatif, sans aucun
trouble phonologique ni syntaxique, marqué uniquement par
des pauses traduisant un manque du mot pour les mots concrets
Démence sémantique ou troubles sémantiques progressifs
●
M. Didic, M. Poncet*
* Service de neurologie et neuropsychologie, CHU La Timone, Marseille,
Laboratoire de neurophysiologie et neuropsychologie (UPRES EA, CJF 9706
INSERM), UFR de Médecine de Marseille.
I
■Les atrophies focales progressives, dont fait partie la
démence sémantique, sont des affections dégénératives
caractérisées par une altération sélective de la conduite
humaine d’installation insidieuse et d’aggravation pro-
gressive.
■Il existe une atteinte sévère de la mémoire sémantique
en l’absence d’atteinte évidente de la mémoire épiso-
dique. Il faut noter cependant que les connaissances épi-
sodiques et personnalisées sur les entités familières du
vécu autobiographique quotidien sont longtemps préser-
vées alors que les connaissances générales ou collectives
sur ces entités sont plus rapidement altérées.
■Un manque sévère du mot associé à un sentiment
d’étrangeté pour ce dernier contraste avec un langage
conversationnel fluent et informatif, sans trouble phono-
logique ni syntaxique.
■Les lésions neuropathologiques sont des lésions non-
spécifiques (perte neuronale, gliose, spongiose laminaire)
ou des lésions de la maladie de Pick et se différencient de
celles de la maladie d’Alzheimer.
POINTS FORTS
POINTS FORTS
• aphasie progressive primaire
• apraxie progressive
• anarthrie progressive
• syndrome amnésique progressif
• troubles visuo-spatiaux progressifs (ou syndrome de Benson)
• prosopagnosie progressive
• troubles comportementaux progressifs (ou démence
fronto-temporale)
• troubles sémantiques progressifs (démence sémantique)
Tableau I. Atrophies corticales focales progressives avec troubles
cognitifs ou comportementaux progressifs.
GLOSSAIRE
•
sémantique : (du grec sêmantikos “qui signifie”) le langage consi-
déré du point de vue du sens
•
champs sémantique : ensemble de mots, de notions et de savoirs se
référant au même domaine conceptuel
•
mémoire sémantique : la composante de la mémoire à long terme,
qui contient les notions et les savoirs sur le monde, les objets, les faits,
les mots et les acquisitions didactiques faisant partie de notre cultu-
re, et s’opposant à la mémoire à long terme, qualifiée d’épisodique et
contenant les souvenirs des événements de la propre histoire person-
nelle ou autobiographiques
maq 1 13/04/04 15:16 Page 115

La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. II - juin 1998
116
MISE AU POINT
et quelques rares paraphasies de type sémantique, comme par
exemple “voiture” au lieu de “train”. La compréhension du lan-
gage conversationnel paraît normale, mais parfois des troubles
manifestes de la compréhension d’un mot apparaissent, associés
à un sentiment d’étrangeté vis-à-vis de ce dernier. L’évaluation
du langage lors de l’examen clinique met en évidence un
manque du mot sévère en dénomination et confirme le trouble
de la compréhension des mots isolés en l’absence de tout
trouble de la répétition. L’examen neurologique somatique est
strictement normal.
CARACTÉRISTIQUES NEUROSPYCHOLOGIQUES
Le diagnostic de l’entité “démence sémantique” repose entière-
ment sur l’examen neuropsychologique. L’imagerie cérébrale
permet de confirmer la nature dégénérative du processus patho-
logique en montrant une atrophie “focale”.
La présence d’un trouble de type sémantique doit être recher-
chée (tableau II), mais apparaît déjà très clairement à l’examen.
Le manque du mot
Aussi sévère sur entrée visuelle, que tactile ou auditive, il n’est
pas aidé par l’ébauche orale. Le patient cherche le mot, ne
donne pas d’information générale sur l’objet, mais fait référen-
ce à l’expérience personnelle qu’il en a. Le manque du mot, qui
est très sévère pour les personnes, les lieux, les entités biolo-
giques (végétaux et animaux) et les entités manufacturées
(outils et ustensiles), l’est moins pour les noms d’actions et les
mots abstraits. De plus, fait fondamental, les personnes, les
lieux et les choses qui font partie du vécu quotidien du patient
sont nommés beaucoup plus facilement.
Les troubles sémantiques
La description verbale des personnes, des lieux et des choses
fait apparaître une atteinte des connaissances sur ces derniers.
Par exemple, devant une asperge, Madame MV peut dire : “ça
se mange”, mais ne sait pas si cela se mange cuit ou cru, avec
du sucre ou en vinaigrette. Devant le dessin d’un cygne, elle
dit : “c’est ce qu’on mange à Noël”. L’examinateur répond :
“non, c’est un cygne”. La patiente, étonnée, réplique : “Un
signe ? Ce n’est pas avec des mots qu’on signe ?”.
La perte des savoirs se manifeste également dans les dessins sur
ordre (figure 1).
Les épreuves de catégorisation sémantique comme le Pyramid
Palm Tree Test (Howard et Patterson 1992) ou le Test des
champs sémantiques (Lhermitte et coll. 1971) font apparaître
des erreurs que ne commettent jamais les témoins. Le Pyramid
Palm Tree Test consiste à choisir entre deux images (par
exemple, un palmier et un sapin) celle qui s’associe le mieux à
une image cible, dans cet exemple une pyramide. La patiente
associe le dessin d’un morceau de gruyère au dessin d’un chat
et non à celui d’une souris. Le Test des champs sémantiques
consiste à classer une liste de douze mots selon les rapports
sémantiques que ceux-ci entretiennent avec un mot présenté en
“en-tête”. Chaque mot est imprimé sur une carte et l’on deman-
de au sujet de regrouper les quatre mots qu’il considère comme
les plus proches du mot “en-tête” à gauche, les quatre mots
ayant un rapport plus lointain au centre et les mots n’ayant
aucun rapport à droite.
La dyslexie de surface
La lecture à haute voix des mots irréguliers fait apparaître des
erreurs de régularisation ; le malade applique les règles usuelles de
prononciation et ne suit pas les règles de lecture des mots irrégu-
liers. Le mot “abbaye” est lu /abaj/ et le mot “rhum” est lu /rym/.
Les mots réguliers sont lus sans difficulté. En neuropsychologie, ce
type de trouble de la lecture est qualifié de “dyslexie de surface”.
La dissociation entre mémoire épisodique
et sémantique
La mémoire épisodique qui permet d’évoquer des souvenirs
autobiographiques et le vécu quotidien est préservée, mais il
existe des troubles de la mémoire dite “sémantique”, soit la
composante de la mémoire à long terme qui contient les savoirs
sur les objets, les faits, les mots et leur signifié (Tulving 1972).
• épreuves de catégorisation sémantique (Pyramid Palm Tree Test,
Test de champs sémantiques)
• évocation verbale et graphique de diverses entités
• fluence catégorielle (animaux, fruits, etc.)
• connaissance sur les personnages célèbres (à partir de photogra-
phies et du nom)
• lecture de mots irréguliers (rhum, abbaye, etc.)
Tableau II. Mise en évidence de troubles sémantiques.
Figure 1. Dessin sur ordre de Madame MV.
maq 1 13/04/04 15:16 Page 116

La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. II - juin 1998 117
La réduction de la fluence verbale catégorielle
La réduction de la capacité à générer des mots d’une catégorie
sémantique particulière, telle que les animaux, ou fluence caté-
gorielle, contraste avec une meilleure capacité à générer des
mots selon un indice formel comme les mots commençant par
une lettre donnée.
En 1992, Hodges et coll. décrivent les caractéristiques neuro-
psychologiques de ce syndrome de la façon suivante :
• atteinte sélective de la mémoire sémantique avec anomie sévè-
re, trouble de la compréhension du mot écrit et parlé et réduc-
tion de la fluence catégorielle ;
• appauvrissement des connaissances générales ;
• pas de trouble syntaxique ni phonologique ; préservation de la
compréhension dans le langage conversationnel ;
• capacités perceptives et de raisonnement non-verbal intactes ;
• mémoire épisodique peu touchée ;
• dyslexie de surface.
CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES ET PARACLINIQUES
Il s’agit d’un trouble rare. Moins de trente cas ont été décrits
dans la littérature. Les troubles, d’installation insidieuse et d’ag-
gravation progressive, débutent souvent entre 50 et 65 ans (en
moyenne 58 ans avec des extrêmes de 39 à 71 ans). Des antécé-
dents d’un trouble similaire chez un membre de la famille
proche ont été rapportés dans à peu près 20 % des cas. Il n’exis-
te pas de prédominance nette en ce qui concerne le sexe.
L’évolution de la maladie, comme dans toutes les atteintes avec
un trouble neuropsychologique progressif est d’aggravation len-
tement progressive et des cas évoluant de 5 à 11 ans ont été rap-
portés. Les troubles de la mémoire sémantique restent isolés
pendant plusieurs années et les patients continuent à gérer leur
vie de façon tout à fait autonome. L’aggravation des troubles
entraîne un handicap majeur. Progressivement, les patients ne
sauront plus identifier les choses et ils ne reconnaîtront plus les
personnes ni les lieux ; à ce stade, il s’agit d’une agnosie des
objets, des personnes et des lieux. Plus tard, s’ajoutent des
troubles de la personnalité et du comportement, et plusieurs cas
rapportés dans la littérature ont développé un syndrome de
Kluever et Bucy avant de présenter un état démentiel terminal.
Pendant les premières années de la maladie, l’imagerie cérébra-
le par scanner X ou imagerie en résonance magnétique (IRM)
ne montre que des altérations subtiles qu’il faut soigneusement
rechercher : une atrophie des structures temporales antéro-infé-
rieures, souvent à nette prédominance gauche (figure 2) avec
préservation des structures temporales médianes. Comme cela
est toujours le cas dans un contexte de troubles neuropsycholo-
giques progressifs, l’examen en imagerie fonctionnelle par
SPECT-scan (tomographie par émission de photons) ou par
PET-scan (tomographie par émission de positrons) prend une
place importante, car il décèle un hypodébit dans les zones
impliquées dans le processus dégénératif.
Dans le cas de la démence sémantique, on retrouve un hypodé-
bit temporal antérieur et parfois temporo-frontal à prédominance
gauche (figure 3, p. 118). L’électroencéphalogramme ne contri-
bue pas au diagnostic, mais montre souvent des ondes fronto-
temporales lentes à prédominance gauche. Le diagnostic de la
maladie ne peut bien sûr être déterminé du vivant du malade.
Cependant, l’examen neuropathologique, réalisé chez six des
patients rapportés dans la littérature, montre des lésions neuro-
pathologiques actuellement qualifiées de lésions “non-spéci-
fiques” (perte neuronale, gliose, spongiose laminaire) dans trois
cas et des lésions caractéristiques de la maladie de Pick dans les
autres cas.
COMMENTAIRES
Une des caractéristiques essentielles de ce tableau est l’existen-
ce d’une atteinte sévère de la mémoire sémantique en l’absence
d’une atteinte évidente de la mémoire épisodique.
Contrairement à ce que l’on observe dans le syndrome amné-
sique, les patients sont capables d’enregistrer les épisodes de
leur vie alors qu’ils ne peuvent plus évoquer les savoirs sur le
monde. L’étude des lésions responsables soit du syndrome
amnésique (structures temporales internes), soit des troubles
sémantiques progressifs (cortex de la convexité temporale anté-
rieure), soit de l’association des deux types de troubles, devrait
permettre de préciser les structures cérébrales indispensables à
l’évocation des connaissances.
L’analyse des troubles montre clairement que l’atteinte fonc-
tionnelle se situe au niveau des connaissances sémantiques et
que les symptômes — manque du mot, troubles de compréhen-
sion du mot, dyslexie et réduction de la fluence catégorielle —,
Figure 2. IRM cérébrale en coupes sagittales pondérées en T1 de l’hé-
misphère droit (à gauche) et de l’hémisphère gauche (à droite). On
observe une atrophie temporale bilatérale à prédominance gauche.
maq 1 13/04/04 15:16 Page 117

n’en sont que les traductions cliniques. Bien que plusieurs cas
de ce type aient initialement été décrits dans l’entité “aphasie
progressive primaire” ou “anomie progressive”, la présence
d’un trouble du système sémantique, clairement distinct d’un
trouble aphasique doit désormais inciter à poser le diagnostic de
“trouble sémantique progressif” ou “démence sémantique”.
Par leur sélectivité, du moins pendant les premières années de
l’évolution, les troubles sémantiques progressifs sans trouble de
la mémoire épisodique constituent un modèle privilégié pour
étudier l’organisation cérébrale des connaissances.
1. Les savoirs concernant les concepts abstraits sont moins alté-
rés que ceux concernant les entités concrètes. Le patient peut
dire que le contraire du mot “optimiste” est “pessimiste” et don-
ner des informations pertinentes sur la signification de ce mot,
alors que le mot “vinaigrette” ne lui dit plus rien.
2. Les noms d’actions (verbes) sont mieux préservés que les
noms de choses (substantifs).
3. Les connaissances des grandes catégories résistent plus long-
temps que celles des composants de ces catégories ; dès le début
clinique de la maladie, un éléphant n’est pas identifié comme
tel, mais le patient sait qu’il s’agit d’un animal (Hodges et coll.
1995).
4. Les connaissances épisodiques et personnalisées à propos des
entités familières faisant partie du vécu autobiographique quoti-
dien (objets d’usage courant, personnes avec lesquelles on vit,
lieux familiers) sont longtemps préservées. Les connaissances
générales ou collectives sur ces entités disparaissent et les
savoirs sur ces entités ne sont plus que personnels et spécifiques
(Snowden et coll. 1995). Pour Mme MV, un ananas n’est plus un
fruit tropical que l’on peut trouver en boîte avec du sirop, dont
on peut faire des salades de fruits, etc., mais uniquement le fruit
nommé ananas, “acheté une fois par semaine sur le marché pour
sa fille qui les aime beaucoup”.
L’étude des troubles chez les patients ayant des troubles séman-
tiques progressifs montre que, dans le cadre du groupe des atro-
phies corticales focales progressives, il existe bien une entité
“démence sémantique”.
Certes, sur le plan neuro-
pathologique, les lésions
responsables sont les
mêmes que celles décrites
dans la plupart des syn-
dromes avec altération
progressive d’une condui-
te cognitive ou comporte-
mentale. Sur le plan cli-
nique, cette entité mérite
clairement d’être distin-
guée des démences fron-
to-temporales et de
l’aphasie progressive : les
signes “frontaux” n’appa-
raissent qu’après plusieurs
années d’évolution ; le
manque du mot n’est
qu’un des éléments de l’atteinte des connaissances et ne résulte
pas d’un trouble linguistique. ■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
• Snowden J.S., Neary D., Mann D.M.A et coll. Progressive language disorder due
to lobar atrophy. Ann Neurol 1992 ; 31 : 174-83.
• Howard D., Patterson K. Pyramids and Palm Trees : a test of semantic access
from pictures and words. Thames Valley publishing, 1992.
• Lhermitte F., Dérouesné J., Lecours A.R. Contribution à l’étude des troubles
sémantiques dans l’aphasie. Rev Neurol 1971 ; 125 : 81-101.
• Tulving E. Episodic and semantic memory. In : Organisation of memory. E.
Tulving & W. Donaldson (eds.) New York and London. Academic Press, 1972.
• Hodges J.R., Patterson K. et coll. Semantic dementia. Progressive fluent apha-
sia with temporal lobe atrophy. Brain 1992 ; 115 : 1783-806.
• Hodges J.R., Graham N., Patterson K. Charting the progression in semantic
dementia : implications for the organisation of semantic memory. Memory 1995 ;
3 (3/4) : 463-95.
• Snowden J.S., Griffiths H.L., Neary D. Autobiographical experience and word
meaning. Memory 1995 ; 3(3/4) : 225-46.
La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. II - juin 1998
118
MISE AU POINT
1. Les lésions de la démence sémantique sont :
a. des dégénérescences neurofibrillaires
b. des plaques séniles
c. des corps de Pick
d. des corps de Léwy
e. des lésions “non-spécifiques” (perte neuronale, gliose,
spongiose laminaire)
2. Les troubles comportementaux de la démence
sémantique :
a. sont inauguraux
b. apparaissent dans la phase d’état
c. sont inexistants
d. apparaissent dans la phase terminale
Figure 3. SPECT cérébral à l’ECD (neurolite). En coupe coronale, on observe une hypofixation temporale bilatérale
à prédominance gauche.
Bonnes réponses : c et e
Bonne réponse : d
maq 1 13/04/04 15:16 Page 118
1
/
4
100%