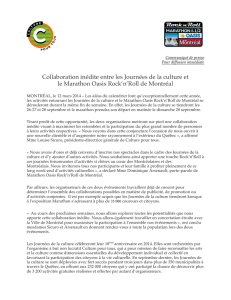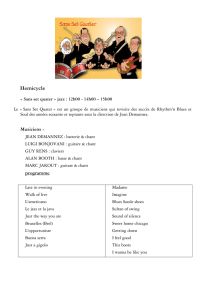several authors blank - retouralaccueil Érudit

Rock ’n’ roll, ségrégation et
interculturalité
Christophe Den Tandt
Université Libre de Bruxelles (U L B)
(2009)
Au moment de la mort de Michael Jackson, beaucoup de commenta-
teurs ont fait remarquer qu’un des apports majeurs du chanteur
récemment décédé avait été de permettre à la musique noire de jouer
un rôle central dans le marché des loisirs américain. La popularité
internationale de Jackson a contribué à créer le marché actuel, domi-
né par des chanteurs de rap et de R ’n’ B, dont les œuvres sont enca-
drées et commercialisées en grande partie par des producteurs afro-
américains. D’un point de vue européen, ont peu s’étonner du carac-
tère tardif d’une évolution que l’on pensait accomplie depuis long-
temps. Depuis le développement du jazz et du rock ’n’ roll, le con-
cept même de musique américaine évoque en effet l’image d’un
champ profondément influencé par les apports de la communauté
noire. Sans aucunement démentir cette idée, je me propose ici de
montrer que les interactions entre culture blanche et noire aux Etats-
Unis telles qu’elles se sont exprimées à travers la musique ont tou-
jours été complexes, et pendant longtemps soumises à des barrières
culturelles, ethniques et commerciales qui nuancent l’image d’une
créolisation pleinement assumée. Mon objet d’étude spécifique est la
naissance du rock ’n’ roll dans les années 1950—une période qui,
dans les récits journalistiques, a souvent été décrite comment
l’exemple même de la réconciliation ethnique sur le plan musical. Le
choix de ce moment de la culture états-unienne est bien sûr guidé par
le fait qu’il s’agit d’un sujet que j’ai appris à connaître en amateur
motivé au fil du temps. Je suis d’autre part convaincu qu’une analyse
similaire pourrait s’appliquer aux périodes antérieures de la musique
américaine—en particulier au développement du jazz, que je connais
moins bien—, ou même à l’histoire récente de la musique populaire
en Europe. L’objet principal de cette analyse est en effet très général,
puisqu’il concerne la possibilité d’établir un dialogue interculturel à
travers les modes d’expression populaires.

2 Den Tandt “Rock ’n’ roll et interculturalité”
Avant de nous pencher sur la genèse du rock ’n’ roll,
j’aimerais faire un détour méthodologique qui nous permettra de
mettre en lumière deux perspectives complémentaires qui régissent la
perception d’une culture par une autre. J’aimerais en effet contraster
deux textes du dix-huitième siècle, l’un de Benjamin Franklin (“Re-
marks Concerning the Savages of North-America.” 1784), l’autre de
Thomas Jefferson (Notes on the State of Virginia, Ch. 6) qui concer-
nent tous deux la représentation des indiens d’Amérique. Même si
l’objet d’étude est évidemment très éloigné de la musique populaire
du vingtième siècle, il apparaîtra, je l’espère, que les attitudes envers
la culture de l’autre prônées respectivement par Franklin et Jefferson
peuvent être transposées dans de nombreux contextes, y compris
celui qui nous occupe ici.
Dans ses remarques, Franklin cherche à combattre les préju-
gés qui pèsent sur les indiens d’Amérique, opinions incompatibles
avec le principe d’égalité implicite entre les êtres humains que Fran-
klin partage avec les autres représentants des Lumières. S’il y a
égalité fondamentale, suggère-t-il, les différences culturelles superfi-
cielles doivent être comprises et acceptées au nom d’un relativisme
bienveillant. Afin de faire passer ce message, Franklin met en oeuvre
la stratégie ironique utilisée par Montesquieu dans Les Lettres Per-
sanes. Il montre notamment que, du point de vue des indiens, les
colons britanniques sont à certains égards bien peu civilisés: leur
manque d’hospitalité envers ceux qu’ils considèrent comme infé-
rieurs est notoire.
Jefferson, sans nier le principe d’égalité humaine, donne plus
d’importance que Franklin aux différences concrètes entre ethnies et
cultures. Son texte est une réponse au naturaliste français Georges-
Louis Leclerc, Comte de Buffon. Ce dernier affirme que les animaux
et les populations indigènes d’Amérique sont inférieurs en taille et
vitalité à leurs équivalents européens, africains et asiatiques—un
argument peu fondé scientifiquement, mais qui, d’un point de vue
politique, sert bien à affirmer la supériorité de l’ancien monde sur le
nouveau. Buffon utilise comme preuve le fait que les indiens ont peu
d’enfants: ils seraient donc stériles. Jefferson réfute la thèse de
Buffon en indiquant que les indiens ont un mode de vie trop ardu
pour pouvoir élever des familles nombreuses. Dans sa démonstration,
Jefferson se révèle fin anthropologue: il reconstitue minutieusement
l’environnement des indiens afin de faire ressortir les contraintes qui
s’exercent sur leur développement. S’il y a égalité de droit entre

3
indiens et européens, il n’y a donc pas d’identité de condition ou de
mode de vie.
Je cite ces deux textes dans la conviction que les deux op-
tiques qu’ils développent doivent rester interdépendantes si l’on veut
rendre justice à la culture de l’autre: elles sont chacune indispensable
et s’équilibrent mutuellement. De plus, l’une comme l’autre peut
malheureusement être détournée de son but afin de promouvoir une
politique d’inégalité. Il est évident, d’une part, qu’insister sur les
différences concrètes qui séparent deux cultures ou deux peuples
peut servir à promouvoir l’idée que ceux-ci sont séparés par des
inégalités essentielles. Il est peut-être encore plus utile, d’autre part,
d’attirer l’attention sur le fait qu’un discours qui célèbre l’égalité
abstraite entre peuples et cultures peut servir à masquer la persistance
d’inégalités de fait. C’est justement cette deuxième dérive qui me
semble avoir caractérisé les récits de la genèse du rock ’n’ roll.
L’accent a toujours été mis sur la volonté du public et des musiciens
de transgresser les barrières de la ségrégation, jetant ainsi les bases
des mouvements d’émancipation culturelle et politique des années
1960. Le caractère incomplet de cette mutation—notamment le sort
très inégal réservé à l’époque aux musiciens noirs par rapport aux
musiciens blancs—a longtemps été passé sous silence.
On fait souvent remonter l’origine du rock ‘n’roll à des morceaux du
milieu des années 1950 tels que « Crazy, Man, Crazy » de Bill Haley
and His Comets (1953), « Rock around the Clock » [1954] de Max
E. Freedman et James E. Myers, chanté par le même Bill Haley, ou «
That’s All right » d’Arthur Crudup, dans la version d’Elvis Presley
(1954; original de 1946). D’autres commentateurs font reculer les
origines plus loin dans le passé, jusqu’à « Rocket 88 » d’Ike Turner
and his Kings of Rhythm [1951] ou même jusqu’à des titres des
années 1930 et ’40—«Roll ‘em Pete » par Big Joe Turner (1939) ou
«Good Rockin’ Tonight » de Roy Brown (1947). Ces hésitations ne
doivent pas surprendre: elles affectent la définition de tout phéno-
mène culturel. Dans le cas présent, elles sont notamment dûes au fait
que le rock ‘n’ roll ne tire pas sa cohérence uniquement de ses carac-
téristiques formelles: il apparaît à l’intersection d’une évolution
musicale et d’une dynamique sociale, chacune comportant sa com-
plexité et sa chronologie propres. Il faut en effet prendre en considé-
ration deux facteurs qui ont profondément modifié le paysage de
l’industrie des loisirs à l’époque—d’un côté l’évolution interne de la

4 Den Tandt “Rock ’n’ roll et interculturalité”
musique noire après la deuxième guerre mondiale et de l’autre, la
création d’un marché consumériste dont les adolescents américains
étaient le moteur.
Au niveau musical, les changements qui ont affecté le jazz
dans l’immédiat après-guerre ont servi de toile de fond aux mutations
musicales qui ont déterminé la naissance du rock ’n’ roll. La période
en question correspond au moment où des musiciens tels que Charlie
Parker, Charlie Mingus et Dizzy Gillespie, les créateurs du bebop,
donnèrent à la musique noire ce que l’on appelle en critique littéraire
un tournant moderniste: ils choisirent de faire du jazz une musique
expérimentale. Le bebop posa les fondations des étapes futures du
jazz moderne—le jazz cool, avec Miles Davis à la fin des années
1950 et le free jazz, avec Ornette Coleman. Le jazz acquit dès lors le
statut d’une musique sérieuse—un genre « canonique », parfois
renommé « Black art music », susceptible d’être l’objet d’études
académiques et de se créer une niche dans les écoles de musiques où
s’enseigne la tradition classique européenne. Cette métamorphose,
admirable à beaucoup d’égards, laissait cependant un créneau vide
dans le paysage de la musique populaire. Dans les années 1930, le
jazz, sous la forme du swing, servait essentiellement de musique de
danse, autant pour le public noir que le public blanc. Or le jazz
expérimental des années 1940 paraissait déconcertant pour une partie
de son public précisément parce que ses improvisations complexes
n’offraient plus de support aux danseurs. Il fallait donc que ce vide
soit comblé par un autre type de musique noire—le genre qui dans
les hit parades du début des années 1950 s’appelait encore « race
music », et qui, pour des raisons de pudeur politique fut rebaptisé «
rhythm and blues » à partir de 1948.
Le rhythm and blues n’a jamais constitué un style homogène.
Ce terme, que ce soit à ses débuts ou dans les décennies ultérieures, a
une valeur plus fonctionnelle que stylistique: il désigne une constel-
lation d’idiomes musicaux de la communauté noire dont la caracté-
ristique commune tient au fait qu’ils servent de musique de danse,
popularisée à la fois par la vente de disques et par les prestations des
artistes. Au début des années 1950, les composantes musicales
principales qui alimentaient le rhythm and blues comprenaient des
éléments du swing des années 1930, du boogie-woogie des années
1940, du blues électrique de Chicago, apparu après la guerre, et du
gospel. D’autres vocables à portée plus limitée désignèrent certains
pans de ce champ musical—« jump music » ou « bop ». Le rhythm

5
and blues se démarquait de la musique des années 1930 en partie par
son orchestration: au lieu des grands orchestres de swing composés
essentiellement d’instruments à vent (saxophone, trompette, trom-
bone), il privilégiait les formations plus restreintes, resserrées autour
du saxophoniste, du pianiste, et parfois du guitariste. De plus, le
rhythm and blues était dans sa grande majorité une musique vocale,
faisant intervenir souvent un soliste appuyé par les voix secondaires
des musiciens.
Le rock ’n’ roll est donc apparu au moment où le public ado-
lescent blanc s’est approprié la race music, et où des musiciens
blancs ont décidé de l’imiter et de la refaçonner selon leurs propres
traditions, notamment selon les modes d’orchestration en vigueur
dans la « hilbilly music », le futur country and western. Ce transfert
interethnique fut rendu possible par deux aspects généraux du con-
texte des années 1950. D’une part, la prospérité considérable des
Etats-Unis d’après guerre avait fait des adolescents un groupe social
à part entière, doté d’un pouvoir d’achat autonome. La jeunesse se
retrouvait ainsi dans une situation sans commune mesure avec les
années 1930, pendant lesquelles les perspectives d’avenir étaient
précarisées par la crise économique, et avec les années de guerre,
caractérisées par la mobilisation nationale sur le front intérieur et la
conscription pour les jeunes hommes. En revanche, les Etats-Unis
des années 1950, malgré des tensions politiques considérables —
guerre froide, chasse au sorcières du McCarthyisme, mouvements
afro-américain visant la déségrégation et l’égalité des droits ci-
viques—, s’étaient dotés d’une image conformiste et puritaine—un
état d’esprit incarné en la figure du Président Dwight Eisenhower.
Dans l’industrie des loisirs, ce conformisme trouvait son expression
dans des formes culturelles soigneusement préservées de tout accent
contestataire—chansons sentimentales des crooners (Bing Crosby),
cinéma Hollywoodien soumis à une stricte censure commerciale,
chaînes de télévision encadrées par une législation pointilleuse. Une
grande partie des adolescents se trouvaient donc dans une position
qui leur offrait à la fois les moyens et les motifs d’un geste de trans-
gression culturel. Il semble presque inévitable que cette contestation
adolescente se soit exprimée par l’appropriation de pratiques cultu-
relles issues d’une communauté subalterne à qui le discours raciste et
puritain conférait l’aura d’une sexualité désinhibée et d’une prédo-
minance des instincts.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%