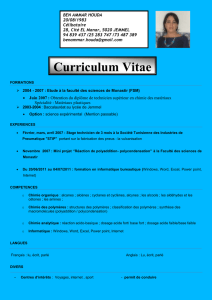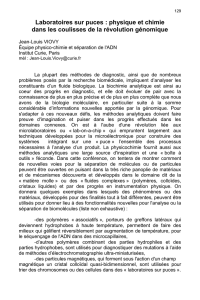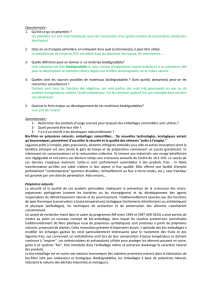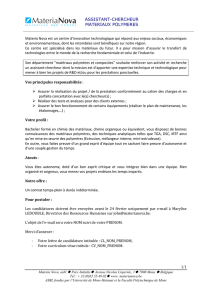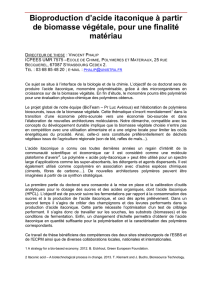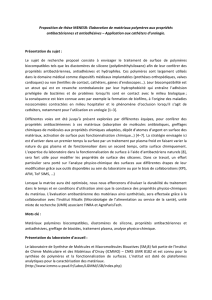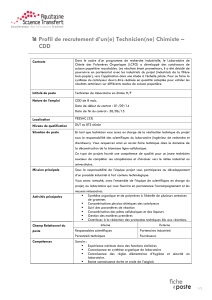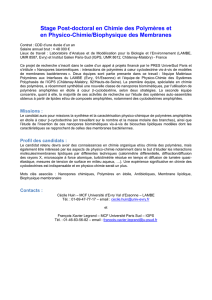contribution à l`histoire industrielle des polymères en

Contribution à l’histoire industrielle des polymères en France par Jean-Marie Michel
1
Contribution à l’histoire industrielle des polymères en France
CONTRIBUTION À L’HISTOIRE INDUSTRIELLE DES
POLYMÈRES EN FRANCE
Jean-Marie MICHEL
INTRODUCTION GÉNÉRALE
L’histoire industrielle des polymères est récente comparativement à celle de la plupart des
industries: verre, industries métallurgiques (excepté celle de l’aluminium)…. En France, elle
commence avec la découverte de la nitrocellulose et de ses applications plastiques (Celluloïd 1872),
textile (1891) film et pellicules (1890). Le développement excessivement rapide de ces applications a
entraîné évidemment celui de la recherche chimique et un cortège de progrès technologiques.
Cette nouvelle industrie s’appuie sur une science encore récente, la chimie macromoléculaire :
ses bases ont été jetées seulement au cours des années 1920-1930, par un savant allemand, Staudinger.
Cette nouvelle chimie prendra petit à petit toute sa place avec ses originalités. Elle est à l’origine
d’innovations et d’applications nombreuses et importantes qui ont apporté une impulsion et des
progrès spectaculaires dans quasiment tous les domaines industriels : électriques, électroniques,
transports, bâtiment, sans compter le champ considérable des industries textiles (artificiels et
synthétiques). L’étendue des domaines concernés est très vaste et il est évident que des secteurs
comme l’aéronautique et les industries spatiales n’auraient pas connu leurs développements actuels
sans les nombreux travaux effectués sur les polymères techniques.
Avec le recul, ce développement si rapide suscite l’émerveillement.
En 1900 la production mondiale annuelle d’acier brut est de l’ordre de 20 millions de tonnes
alors que celle des matières plastiques, dans l’enfance (celluloïd essentiellement), ne dépasse
probablement pas 1000 à 2000 tonnes. En 2000, la production d’acier annuelle est de 828 millions de
tonnes, celle des matières plastiques (dont la densité est beaucoup plus faible) 153 millions de tonnes.
L’autre application pondéralement très importante est le textile. En 1900, l’usine Chardonnet de
Besançon commence à assurer une production régulière d’une centaine de kilogrammes par jour. 50
ans plus tard, la production mondiale, toutes fibres chimiques confondues est de 1,7 millions de
tonnes, elle passe à 14,3 millions, après 80 ans, 28 millions (dont 90% de fibres synthétiques et 10%
de fibres artificielles cellulosiques) après 100 ans. Pour le textile, les nouvelles matières se substituent
en partie aux textiles naturels (coton, laine, lin, chanvre….). Elles permettent de répondre à la
demande grandissante d’une population mondiale en expansion et de découvrir de nouveaux matériaux
aux propriétés thermiques et thermomécaniques inconnues à ce jour.
Le progrès est encore plus remarquable si l’on considère que les bases scientifiques sur
lesquelles s’appuie cette nouvelle chimie sont très récentes. Elles datent des années 1925-1930, époque
à partir de laquelle cette chimie est reconnue à part entière : c’est la chimie macromoléculaire avec ses
originalités scientifiques et les propriétés particulières et spécifiques de ses macromolécules.
Les développements spectaculaires, explosifs, qui touchent des domaines d’application très
visibles (emballage, bouteilles, textile) mais aussi plus discrets (résines pour vernis et adhésifs, pièces
techniques), voire confidentiels (électronique), invitent à s’interroger sur ses origines et l’histoire de sa
naissance et de son développement en France. C’est l’objet de ce travail.
Cette contribution à l’Histoire française des polymères comporte trois parties :

Contribution à l’histoire industrielle des polymères en France par Jean-Marie Michel
2
Contribution à l’histoire industrielle des polymères en France
La première concerne la naissance et le développement industriel des premiers polymères à
partir de 1876 (début de la production du celluloïd), un développement sans bases théoriques où le
concept de macromolécules est absent. La nitrocellulose, découverte en France, y joue un rôle central.
C’est le modèle pour les applications thermoplastiques et textiles, la référence pour longtemps. Elle est
relayée par son cousin l’acétate de cellulose, accompagné par deux autres systèmes qui ne sont pas
thermoplastiques mais thermodurcissables, la caséine dont le rôle sera plutôt éphémère et les résines à
base de phénol qui débutent modestement. C’est l’époque pionnière où l’empirisme est roi, mais qui a
vu naître et se développer de nombreuses sociétés souvent très artisanales.
La seconde correspond à la période où la notion de macromolécule s’impose : c’est celle de la
naissance de la chimie macromoléculaire. L’explosion de la chimie organique, l’accès facile à des
molécules polymérisables d’origine pétrolière, l’essor économique associé aux « trente glorieuses »,
après la fin de la guerre. L’optimisme ambiant qui accrédite l’idée que tout est possible, font de ces
années une période dynamique très féconde jusqu’à l’avertissement apporté par le premier choc
pétrolier en 1974 qui fera réviser sérieusement cette vision quelque peu utopiste. C’est l’avènement
des grandes familles de polymères thermoplastiques de grande diffusion tandis que la recherche laisse
entrevoir un avenir pour des polymères spéciaux, très techniques dans des domaines jusqu’ici réservés
aux métaux. Ce chapitre décrit le développement historique par famille de polymères. Ce sont donc
pour l’essentiel, les polymères de synthèse industrialisés après 1930. Pour simplifier, ils ont été classés
sous forme monographique à l’exception du premier chapitre consacré à l’œuvre de Staudinger.
Ces monographies concernent les polymères vinyliques (polystyrène, polychlorure de vinyle et ses
dérivés, polyacétate de vinyle et dérivés, polymères fluorés), les polymères acryliques, les polyamides
et dérivés, les résines thermodurcissables, les silicones. Elles couvrent, en principe, la période 1930-
1980, sans toutefois qu’il s’agisse là de dates de rigueur.
La troisième partie de cet ouvrage est consacrée à l’histoire des sociétés productrices. Cette
histoire s’est déroulée dans le cadre et au sein de sociétés chimiques dont la vocation première n’était
pas la fabrication et le développement de matières polymères. Comment, pour quelles raisons, pour
quelles synergies, par quel effet d’entraînement ou de mode, ont-elles décidé d’investir dans ce
nouveau domaine chimique considéré comme prometteur mais qui, parfois, les écartait apparemment
de leur vocation ou simplement de leur cadre traditionnel d’activité ? A part une seule, toutes ces
sociétés importantes ont aujourd’hui disparu ; leur nom fut familier durant les années 60. Ils
s’évanouissent maintenant petit à petit dans les mémoires, même pour les plus importantes d’entre
elles. Ce sont Rhône-Poulenc, Péchiney, Progil, Kuhlmann, Saint-Gobain, les Charbonnages de
France, Ugine. C’est l’objet de cette dernière partie de faire l’inventaire de ces sociétés et de rappeler
brièvement leurs activités pour préciser l’apport de chacune d’elles dans l’industrie française des
polymères.
Ce travail s’appuie sur de nombreuses sources :
Le témoignage de personnes ayant oeuvré dans le milieu industriel des polymères.
Les fonds des Archives Nationales, de plusieurs archives départementales (Ain, Rhône, Seine-
Maritime, Eure, Paris), éventuellement d’archives notariales, les Archives du Monde du
Travail, les Archives du Service des Poudres.
Les archives du Crédit Lyonnais, du Crédit Commercial de France
Les fonds d’archives des sociétés privées. Certaines d’entre elles n’ont malheureusement pas
pu être consultées faute d’autorisation ou par suite de destructions comme conséquence des
restructurations industrielles.
La littérature ouverte (ouvrages, périodiques…)
La littérature des brevets.

Contribution à l’histoire industrielle des polymères en France par Jean-Marie Michel
3
Contribution à l’histoire industrielle des polymères en France
Remerciements
L’auteur est très reconnaissant aux directions des sociétés Rhône-Poulenc, Péchiney, Saint-
Gobain qui, à l’époque, lui ont donné toutes facilités pour consulter leurs archives.
Il remercie sincèrement toutes les personnes qui ont accepté, avec beaucoup d’amabilité et de
patience, d’apporter leur témoignage, souvent avec émotion, et de revivre quelque temps leur vie
professionnelle.
Ses remerciements vont à tous ceux qui ont permis que cette contribution à l’Histoire française
des Polymères soit publiée sous l’égide des sociétés savantes qu’ils président, sous une forme
accessible à chacun : M.Olivier Homolle et les membres du bureau de la Société Chimique de France,
Mesdames Laurence Listel et Danièle Fauque, Présidentes du Club de l’Histoire de la Chimie,
Messieurs Pascal Barthélémy et Yves Gnanou, Présidents du Groupement Français des Polymères
Ses remerciements vont également à Marie-Claude Vitorge qui a assumé la charge de cette
publication et Anne Sophie Bressy qui a effectué une partie du travail de mise en forme informatique.
L’auteur a une intention toute particulière pour Jean-Claude Daniel auquel il est lié par tant de
souvenirs passés, qui lui a apporté une aide efficace et bienveillante pour mener à bonne fin cette
publication.
Ce travail a demandé de nombreuses années. Il n’aurait pu être mené à bien sans la patience
affectueuse et l’aide de mon épouse Annie Michel à qui il est dédié. Je n’oublie pas également mon
frère, Guy-Jean Michel qui n’a pas hésité à effectuer un travail ingrat de relecture.
1
/
3
100%