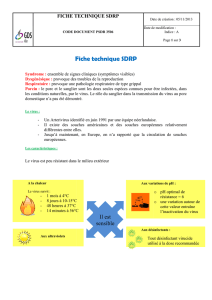Emergence en Asie d`un variant hautement pathogène du virus du

éditorial
Emergence en Asie d’un variant hautement
pathogène du virus du syndrome dysgénésique
et respiratoire porcin ?
G. Kuntz-Simon
1
P. Vannier
2
1
Unité virologie immunologie porcines
2
Vaccinologie-santé animale,
Afssa-Lerapp, zoopôle Les Croix,
BP 53, 22440 Ploufragan
LLe 10 avril, puis le 9 mai 2007, l’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE) notifie la déclaration de foyers de syndrome dysgénésique
et respiratoire porcin (SDRP), respectivement au Vietnam et en Républi-
que populaire de Chine (www.oie.int). Le 7 août, un rapport de suivi de l’OIE
fait état de 17 foyers en Chine, répartis sur la quasi-totalité du territoire, et l’on
comptabilise déjà la perte de plus de 96 000 porcs, dont 27 % sont morts des
suites de la maladie, les autres ayant été abattus.
Cette nouvelle épizootie pourrait être une relance de celle survenue au cours de
l’été 2006 dans l’est de la Chine et qui avait touché 2,12 millions de porcs avec
un taux de mortalité de 19,7 %. Cette maladie dévastatrice, d’abord appelée
« maladie porcine hyperthermique » en raison de la très forte fièvre induite,
aurait même déjà été observée dans certaines provinces du sud-est de la Chine au
cours des étés chauds des années précédentes. Il pourrait donc s’agir d’une
maladie saisonnière qui ne cesse de s’étendre de manière assez inquiétante
d’année en année. Elle a été au départ suspectée être une forme de peste porcine
en raison des symptômes cliniques et des tableaux lésionnels associés, mais trois
équipes chinoises ont récemment rapporté les résultats d’analyses de laboratoire
et concluent toutes à l’implication d’un nouveau variant, très virulent, de virus
du SDRP [1-3]. Celui-ci a été identifié par RT-PCR, immunohistochimie et
microscopie électronique, et la maladie a pu être reproduite chez des porcs
d’expérimentation après inoculation de l’agent viral isolé sur culture de cellules
épithéliales de rein de singe (MARC145).
Le SDRP (ou PRRS pour porcine reproductive and respiratory syndrome),
caractérisé par des troubles de la reproduction chez les truies et des problèmes
respiratoires chez les porcelets et les porcs en croissance, est apparu par vagues
épidémiques en 1987 en Amérique du Nord puis fin 1990 en Europe de l’Ouest,
continents où il s’est ensuite répandu rapidement, entraînant des pertes écono-
miques importantes [4]. Ce syndrome, aussi appelé « maladie des oreilles
bleues », est devenu endémique dans la plupart des pays producteurs de porcs.
L’infection par le virus du SDRP, non transmissible à l’homme, est aujourd’hui
très souvent subclinique chez les porcs en croissance, mais reste indirectement
responsable de lourdes pertes économiques en raison de son rôle majeur dans le
syndrome respiratoire multifactoriel du porc (ou PRDC pour porcine respiratory
disease complex).
L’agent étiologique, le virus du SDRP, appartient à la famille des Arteriviridae,
genre des Arterivirus qui regroupe également le virus élévateur de la lactate
déshydrogénase de la souris (LDV ou lactate dehydrogenase-elevating virus), le
virus de l’artérite équine (EAV ou equine arteritis virus) et le virus de la fièvre
hémorragique du singe (SHFV ou simian hemorrhagic fever virus). Cette
famille des Arteriviridae est classée au sein de l’ordre des Nidovirales avec les
familles des Coronaviridae et des Roniviridae. Le virus du SDRP est un virus
enveloppé de petite taille (50 à 65 nm de diamètre). Son génome est un ARN
simple brin linéaire de polarité positive, de 15 kb de long environ, organisé en
doi: 10.1684/vir.2008.0137
Virologie 2008, 12 (1) : 3-6
Virologie, Vol. 12, n° 1, janvier-février 2008
3
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

9 phases de lecture ouvertes (ORF ou open reading frame).
Les deux tiers du génome viral du côté de l’extrémité 5’
sont occupés par les ORF chevauchantes 1a et 1b codant
deux polyprotéines (pp1a et pp1ab) qui sont ensuite clivées
en 13 protéines non structurales (Nsp1a, Nsp1bet Nsp2 à
12). Celles-ci sont impliquées dans la réplication du gé-
nome viral et la synthèse d’ARNm subgénomiques (ORF2
à ORF7) codant les protéines structurales du virus. L’extré-
mité 3’ du génome viral code ainsi 4 glycoprotéines d’enve-
loppe (GP2a, GP3, GP4 et GP5), 2 protéines de membrane
non glycosylées (2b et M) et la nucléocapside (N).
Bien que les isolats européens et nord-américains présen-
tent les mêmes morphologie et organisation génomique, ils
se distinguent nettement les uns des autres au niveau géné-
tique et antigénique. On distingue deux génotypes de virus
du SDRP ayant très vraisemblablement divergé d’un ancê-
tre commun : le génotype 1, dit « européen » (type I-EU),
ayant pour prototype la souche Lelystad (LV), et le géno-
type 2, dit « nord-américain » (type II-NA), représenté par
la souche VR2332. Ces deux génotypes ne présentent que
63 % d’identité nucléotidique entre eux, les différences
majeures étant retrouvées dans les extrémités 5’ et 3’ non
codantes ainsi que dans les ORF1a et ORF1b, principale-
ment les régions codant Nsp2 et Nsp12 [5]. La diversité
génétique est également importante au sein de chacun des
deux génotypes, dans lesquels on distingue plusieurs sous-
groupes [6]. Cette diversité est surtout mise en évidence au
niveau des ORF5 et ORF7, codant respectivement GP5,
glycoprotéine d’enveloppe la plus variable, cible d’anti-
corps neutralisants, et la nucléocapside N, protéine virale la
plus abondante dans les cellules infectées.
Comme tous les artérivirus, le virus du SDRP est capable de
persister dans le sang périphérique pendant4à6semaines
après l’infection, voire plus, cela en dépit de la production
d’anticorps décelables dans le sérum dès 5 jours. La syn-
thèse tardive d’anticorps neutralisants permet de réduire la
virémie, et donc la contagiosité des porcs, mais le virus peut
persister encore plusieurs semaines dans les organes lym-
phoïdes.
Chez la truie, les infections survenant dans le dernier tiers
de la gestation sont particulièrement lourdes de conséquen-
ces, entraînant des avortements tardifs avec fœtus momi-
fiés, des mises bas anticipées et une augmentation du nom-
bre de porcelets mort-nés ou de porcelets chétifs qui
meurent peu après la naissance. Ces effets seraient liés à la
multiplication du virus dans les cellules du système
monocyte-macrophage des fœtus après passage de la bar-
rière transplacentaire. L’infection des porcelets pendant la
période de sevrage entraîne de la fièvre, de l’anorexie, de la
dyspnée, des tremblements, de l’érythème cutané, de la
conjonctivite, de l’œdème péri-oculaire et de la diarrhée. Le
taux de mortalité peut alors être élevé. Les lésions macros-
copiques et microscopiques concernent essentiellement le
poumon (destruction des macrophages alvéolaires, lésions
de pneumonie interstitielle) et les ganglions lymphatiques
(hyperplasie folliculaire). Le muscle cardiaque et
l’encéphale peuvent parfois être touchés. Chez les porcs
sevrés et les porcs en croissance, les mêmes symptômes et
lésions sont observés, mais sont moins prononcés. Les taux
de mortalité peuvent cependant être augmentés dans le cas
d’infections concomitantes à tropisme respiratoire, d’ori-
gine bactérienne ou virale (virus influenza porcin, corona-
virus porcin). Chez les porcs en fin de croissance, les verrats
et les truies, les infections sont d’ordinaire inapparentes.
Dans le cas de l’épizootie chinoise, les porcs de tous âges
sont affectés, y compris les truies adultes et les porcs en fin
d’engraissement. La fièvre (40-42 °C) et les taux de morta-
lité (20 à 30 %) atteignent des valeurs encore rarement
relevées lors d’épidémies de SDRP. Tous les signes clini-
ques classiques sont exacerbés. Des lésions de pneumonie
sont observées ainsi que des points hémorragiques sur les
ganglions. Le muscle cardiaque et l’encéphale sont atteints.
Cependant, on relève également des lésions non typiques
de l’infection SDRP : un infarcissement de la rate, une
dilatation de la vessie, des pétéchies sur les reins, des points
de nécrose sur le foie. La maladie dure5à20jours et se
propage rapidement, affectant l’ensemble d’un troupeau en
3 à 5 jours.
Comme évoqué plus haut, la très forte fièvre et ces lésions
non typiques du SDRP peuvent évoquer la peste porcine
classique (PPC) ou la peste porcine africaine (PPA), et
valurent à cette maladie d’être au départ identifiée comme
une maladie hog-cholera like [1]. Le rapport de l’OIE du
12 septembre 2006 (www.oie.int) évoque d’ailleurs l’hy-
pothèse que la maladie pourrait être due à une infection
mixte par le virus du SDRP, le virus de la PPC et le
circovirus porcin de type 2 (PCV2). En effet, sur 582 pré-
lèvements issus de porcs malades, 45 % étaient positifs au
SDRP, 29,2 % à la PPC et 22,3 % au PCV2. La présence de
la PPA aurait été exclue. Des experts relèvent également
que de nombreuses exploitations chinoises sont infectées
par le virus de la PPC et se questionnent sur le rôle de cet
agent (McOrist and Done, Report on recent visit to China,
www.aasv.org/news/story.php?id=2165). Cependant, les
agents pathogènes qui auraient apparemment fait l’objet de
recherches dans les études publiées impliquant un nouveau
variant de virus SDRP, sont Streptococcus, E. coli, Myco-
plasma, Haemophilus parasuis, le virus du SDRP, le PCV2
et le virus de la maladie d’Aujeszky [1-3]. A aucun mo-
ment, le virus de la PPA n’est cité par les auteurs, et seule
une équipe évoque la recherche du virus de la PPC par
RT-PCR [2]. Le SDRP serait l’agent pathogène majoritai-
rement retrouvé dans les prélèvements cliniques, mais il
n’est pas dit à quelles fréquences sont retrouvés les autres
agents pathogènes recherchés, notamment le virus de la
PPC. Rappelons que l’isolement du virus de la PPC néces-
éditorial
Virologie, Vol. 12, n° 1, janvier-février 2008
4
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

site des cellules sensibles, indemnes de contamination par
des pestivirus, en utilisant un sérum nutritif (le plus souvent
d’origine bovine) lui aussi dépourvu d’anticorps et de pes-
tivirus. De plus, le virus de la PPC n’étant pas cytolytique,
il faut utiliser des techniques d’immunomarquage pour
mettre sa multiplication en évidence.
Les troubles observés et les lésions décrites ont été repro-
duits chez des porcs exempts d’organismes pathogènes
spécifiés (EOPS) suite à l’inoculation des souches de virus
SDRP isolées sur cellules MARC145 [1-3]. Les auteurs ne
donnent cependant pas d’information quant aux tests de
contrôle réalisés sur ces isolats afin de s’assurer qu’ils sont
indemnes d’autres agents infectieux que le virus du SDRP.
Ils concluent avoir affaire ici à une souche très virulente du
virus du SDRP, particulièrement bien adaptée à son envi-
ronnement.
Il a été démontré, suite à des inoculations expérimentales,
que l’intensité du syndrome respiratoire et des lésions asso-
ciées peut varier en fonction de la nature des isolats impli-
qués. Une forme très virulente de virus SDRP a également
été associée au syndrome d’avortement et de mortalité chez
la truie (SAMS ou sow abortion and mortality syndrome),
décrit à la fin de l’année 1996 aux Etats-Unis, puis en
2003-2004 en Europe. Il est donc admis qu’il existe plu-
sieurs degrés de virulence des souches, mais on connaît
encore très mal aujourd’hui les déterminants moléculaires
de virulence et/ou d’atténuation. La comparaison des sé-
quences génomiques de virus parentaux et de leurs variants
atténués après passages en culture cellulaire, montre que de
nombreuses mutations ponctuelles (50 à 250 selon les étu-
des), silencieuses et non silencieuses, peuvent être relevées
chez les souches atténuées. Cependant, les changements
d’acides aminés sont répartis sur plusieurs protéines non
structurales et structurales (NSp1b, NSp2, Nsp10, ORF2,
ORF3, ORF5 et ORF6 notamment) et il n’a pas été claire-
ment défini de région particulièrement associée au change-
ment phénotypique. De même la comparaison des séquen-
ces de souches atténuées à celles de souches « révertantes »
ayant retrouvé un caractère pathogène après passage chez
le porc, révèle quelques changements isolés de résidus
aminoacides. Trois d’entre eux, situés respectivement dans
Nsp1, Nsp10 et M, seraient directement liés à la réversion
vers la virulence.
Les trois équipes chinoises ayant conclu à l’implication
d’un nouveau variant hypervirulent du virus du SDRP dans
cette maladie aux conséquences dramatiques rapportent les
résultats du séquençage du génome de plusieurs isolats
[1-3]. Ils ont tous un génome de 15 320 bp environ et sont
très similaires entre eux. Ils appartiennent au génotype II-
NA, comme toutes les souches de virus du SDRP isolées en
Chine au cours des dernières années [7]. Le degré de
similitude dans l’ORF5, au niveau nucléotidique, est de
88-89 % avec la souche VR-2332 mais serait de 93-94 %
avec d’autres souches chinoises récentes qui ont été clas-
sées dans le sous-groupe 1 chinois défini récemment par An
et al. [7]. Ces auteurs ont en effet montré que les souches
isolées en Chine avant cet épisode de SDRP fulgurant se
classent dans deux sous-groupes différents au sein du type
II-NA. Le sous-groupe 1 est constitué de souches dont
l’ORF5 a nettement divergé du prototype VR2332 et qui
ont pour la plupart été isolées dans le sud-est du pays, tandis
que les souches du sous-groupe 2 montrent une très grande
similitude avec le vaccin vivant atténué MLV et sa souche
parentale VR2332. Contribuant à la compréhension de
l’épidémiologie du SDRP en Chine, les auteurs relèvent
que la définition de ces deux sous-groupes pourrait expli-
quer la faible efficacité de la vaccination dans les fermes du
sud-est touchées par les souches du sous-groupe 1. C’est
aussi de cette région que semble avoir émergé le nouveau
variant hypervirulent.
Les analyses détaillées des séquences des différents gènes
viraux, codant les 6 protéines structurales et les 13 protéi-
nes non structurales, mettent en avant une caractéristique
particulière des nouveaux variants par rapport aux autres
isolats de type II-NA. Tous les génomes présentent en effet
les mêmes délétions dans le gène codant la protéine Nsp2,
par rapport à la séquence du gène homologue de la souche
VR2332. Une leucine manque en position 480 (ou 482 ou
483, selon les auteurs) et une délétion continue de 29
résidus aminoacides est systématiquement retrouvée en
position 531-559 (ou 534-562 ou 535-563, selon les
auteurs). Ces délétions portent à 79,4 et 74,9 % l’identité,
aux niveaux nucléotidique et protéique respectivement, en-
tre Nsp2 des nouveaux variants et Nsp2 des souches du
type II-NA. Il n’a visiblement pas été retrouvé d’autres
différences (mutations, délétions) dans les génomes qui
pourraient être pointées comme déterminants de la viru-
lence de ces souches atypiques.
Dans l’état actuel des connaissances, il n’est cependant pas
possible d’associer les délétions relevées en Nsp2 des nou-
veaux variants chinois à une augmentation du degré de
virulence. Nsp2 est la plus grande réplicase (1 196 aa) du
virus du SDRP et a la même organisation que Nsp2 des
autres artérivirus. Elle est organisée en trois domaines : un
domaine cystéine protéinase N-terminal (PL2), une région
interne hypervariable, et un domaine transmembranaire
(TM) hydrophobe en C-terminal. Les régions PL2 et TM
sont indispensables à la réplication virale, mais le domaine
interne de la protéine, dont la fonction reste inconnue, peut
être amputé jusqu’à 400 acides aminés entre les positions
324 à 726 sans que la multiplication du virus ne soit affectée
[8]. D’après les données des équipes chinoises, les délé-
tions repérées chez les nouveaux variants se situent dans
cette zone hypervariable non essentielle de Nsp2. On notera
que la protéine Nsp2 des virus du type I-EU comporte 120
acides aminés de moins que celle des souches du type II-
éditorial
Virologie, Vol. 12, n° 1, janvier-février 2008
5
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

NA, portant à seulement 34 % leur degré de similitude. Par
ailleurs, des virus de type I-EU identifiés dans des élevages
nord-américains au début des années 2000 (sans qu’aucune
souche vaccinale vivante atténuée de type I-EU n’ait été
introduite aux Etats-Unis) comportent également une délé-
tion de 17 acides aminés dans le domaine interne de Nsp2,
mais celle-ci n’a pas été associée à une modification de la
virulence des souches de type I.
Comme la plupart des virus à caractère hautement patho-
gène ayant émergé dans les populations animale et humaine
au cours des dernières années, le virus du SDRP est un virus
à ARN, donc variable sur le plan génétique. Le développe-
ment des techniques de génétique inverse a permis, au cours
des dernières années, la construction de clones (ADNc)
infectieux stables de plusieurs souches de virus du SDRP
[8, 9]. Des expériences de mutagenèse dirigée dans ces
clones infectieux devraient prochainement apporter de nou-
velles connaissances quant aux mécanismes de réplication
du virus et aux régions génomiques impliquées dans l’aug-
mentation de la virulence ou dans l’atténuation des sou-
ches.
Comme relevé plus haut, l’étiologie exacte de cette « mala-
die des oreilles bleues » demande à être confirmée, surtout
au regard de l’implication éventuelle du virus de la PPC,
celle-ci n’ayant pas, pour l’instant, été formellement ex-
clue. L’isolement systématique du virus du SDRP ne cons-
titue pas en soi une preuve absolue que cet agent soit le seul
responsable des troubles observés, dans la mesure où l’in-
fection par le virus du SDRP est largement répandue dans la
population porcine du monde entier. Dans une crise sani-
taire de ce type, il est essentiel de faire valider les isole-
ments viraux et le diagnostic par des laboratoires de réfé-
rence à vocation internationale. Les prélèvements chinois
n’ont pas encore (à la date de rédaction de cet article) été
envoyés dans un laboratoire international de référence
(OIE).
En conclusion, tant qu’une validation croisée sur le plan
international n’aura pas été réalisée par les autorités com-
pétentes, un doute peut légitimement subsister quant à la
cause réelle de cette épizootie. Cependant, si la responsa-
bilité d’un nouveau variant hypervirulent de virus du SDRP
devait être confirmée, cette émergence et sa propagation
rapide en Asie du Sud-Est seraient très inquiétantes et
confirmeraient, comme le relève D. Normile [10], la néces-
sité de soutenir les efforts de recherche sur les possibilités
d’évolution de cet artérivirus, afin de mieux comprendre
son épidémiologie et de pouvoir mieux le contrôler.
Références
1. Tian K, Yu X, Zhao T, et al. Emergence of fatal PRRSV variants :
unparalleled outbreaks of atypical PRRS in China and molecular dissec-
tion of the unique hallmark. PLoS ONE 2007 ; 2 : e526.
2. Tong GZ, Zhou YJ, Hao XF, Tian ZJ, An TQ, Qiu HJ. Highly pathoge-
nic porcine reproductive and respiratory syndrome, China. Emerg Infect
Dis 2007 ; 13 : 1434-6.
3. Li Y, Wang X, Bo K, et al. Emergence of a highly pathogenic porcine
reproductive and respiratory syndrome virus in the Mid-Eastern region of
China. Vet J 2007 ; 174 : 577-84.
4. Albina E. Le point sur le dernier-né des Arterivirus : le virus du syn-
drome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP). Virologie 2000 ; 4 :
113-21.
5. Allende R, Lewis TL, Lu Z, et al. North American and European por-
cine reproductive and respiratory syndrome viruses differ in non-
structural protein coding regions. J Gen Virol 1999 ; 80 : 307-15.
6. Stadejek T, Oleksiewicz MB, Potapchuk D, Podgorska K. Porcine re-
productive and respiratory syndrome virus strains of exceptional diversity
in eastern Europe support the definition of new genetic subtypes. JGen
Virol 2006 ; 87 : 1835-41.
7. An TQ, Zhou YJ, Liu GQ, et al. Genetic diversity and phylogenetic
analysis of glycoprotein 5 of PRRSV isolates in mainland China from
1996 to 2006 : Coexistence of two NA-subgenotypes with great diversity.
Vet Microbiol 2007 ; 123 : 43-52.
8. Han J, Liu G, Wang Y, Faaberg KS. Identification of non essential re-
gions of the nsp2 replicase protein of porcine reproductive and respiratory
syndrome virus strain VR-2332 for replication in cell culture. J Virol
2007 ; 81 : 9878-90.
9. Kwon B, Ansari IH, Osorio FA, Pattnaik AK. Infectious clone-derived
viruses from virulent and vaccine strains of porcine reproductive and
respiratory syndrome virus mimic biological properties of their parental
viruses in a pregnant sow model. Vaccine 2006 ; 24 : 7071-80.
10. Normile D. Virology. China, Vietnam grapple with ‘rapidly evol-
ving’pig virus. Science 2007 ; 317 : 1017.
éditorial
Virologie, Vol. 12, n° 1, janvier-février 2008
6
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
1
/
4
100%