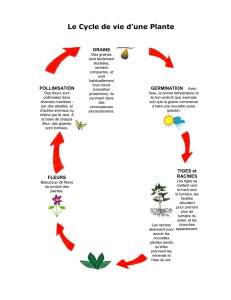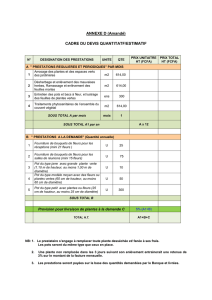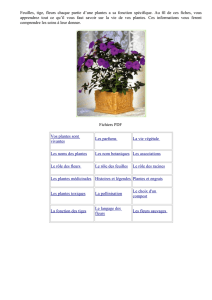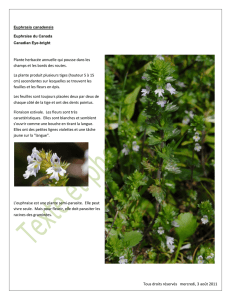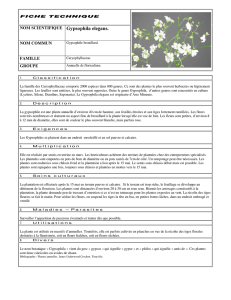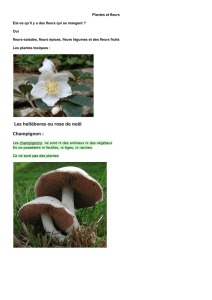Les Papilionacées, entre ombre et lumière

N° 60 HIVER 2007 -BIODYNAMIS 3
BOTANIQUE GOETHÉENNE
On emploie plus souvent le terme de
légumineuses dans l'alimentation
ou l'agriculture pour parler de ces
plantes. Les légumineuses sont une
famille botanique qui réunit environ
18 000 espèces réparties en trois sous-
familles sur tout le globe terrestre :
- les Papilionacées (aujourd'hui renom-
mées Fabacées d'après le nom de genre
Faba, la fève) qui est la seule famille
représentée en région tempérée
- les Césalpinacées et les Mimosacées,
deux familles dont la plupart des représen-
tants poussent dans les régions chaudes du
globe. On citera par exemple le mimosa
avec ses fleurs en pompons comme
Les Papilionacées, entre
ombre et lumière
Avant de s’attacher au petit pois, jetons un regard sur sa famille bota-
nique, les Papilionacées, ce qui nous permettra de mieux cerner les
particularités de cette légumineuse.
La vesce (Vicia cracca) en pleine floraison : les fleurs ressemblent à des insectes butinant

exemple de Mimosacée et l'arbre de Judée
comme exemple de Césalpinacée.
Nous allons nous limiter à la famille des
Papilionacées déjà importante avec ses
12 000 espèces. En décrivant quelques-
uns de ses représentants les plus courants,
nous pourrons observer un certain nombre
de caractéristiques de la famille.
Dans les prés et les landes
Dans le jardin ou le pré, nous rencontre-
rons très facilement les trèfles aux feuilles
trifoliées (d'où vient le nom de Trifolium)
typiques et aux fleurs en pompons blancs,
roses, ou pourpres chez le trèfle incarnat.
Ces plantes ont souvent un feuillage vert
bleuté et elles restent bien vertes en été,
même par temps sec. Quand les fleurs
fanent, le reste de la plante, au lieu de
dessécher, reste toujours vert comme si la
plante ne voulait jamais dépérir… Les
fleurs du trèfle blanc sont très appréciées
des abeilles, en particulier au cœur de
l'été quand il n'y a guère d'autres fleurs à
nectar. D'autres Papilionacées des prés
comme le lotier corniculé, la minette, le
trèfle fer à cheval (Hippocrepis) aux
fleurs jaunes sont des aliments très appré-
ciés des chenilles de certains de nos
papillons diurnes. Pensez-y si voulez pré-
server les papillons. On découvre ainsi un
lien intime entre les papillons et la famille
des Papilionacées qui tire son nom de la
ressemblance de ses fleurs à ces insectes.
Dans la prairie artificielle, on découvrira
aussi la luzerne ou le sainfoin, papiliona-
cée fourragère un peu délaissée du Sud
de la France.
À la lisière du pré, nous trouverons les
vesces et les gesses, grandes
Papilionacées qui s'accrochent aux
arbustes par les vrilles des extrémités de
leurs feuilles. Il est facile de distinguer
les gesses des vesces en observant les
feuilles : la vesce a des feuilles compo-
sées avec de nombreuses folioles et la
gesse des feuilles avec un nombre réduit
de folioles. Les vrilles sont des folioles
de l'extrémité des feuilles transformées,
étrange capacité de la feuille, organe d'or-
dinaire tout en surface seulement récep-
tif, à rester tige pour devenir sensible et
s'enrouler en vrille "tactile". Ces plantes
qui, en général, n'ont pas de tiges assez
rigides pour tenir debout "toutes seules",
s'étendent à l'horizontale assez loin sur
les autres plantes.
Les légumineuses sont rares à l'ombre et
dans les milieux humides, elles cherchent
plutôt la lumière et le sec. Dans les sous-
bois, on ne rencontrera guère que la gesse
de printemps qui se hâte de fleurir avant
que les arbres portent leurs feuilles.
Par contre, certaines Papilionacées
comme les genêts et les ajoncs aux odeurs
entêtantes sont les parures des landes
sèches et des friches qu'elles embellissent
de leur jaune lumineux. On découvrira
les différentes espèces de genêts la plu-
part du temps sur des terres acides, très
siliceuses, à l'exception du genêt
d'Espagne qui orne tous les talus d'auto-
route calcaires dans le sud de la France. Il
semble que les genêts, bien que poussant
sur des terres très pauvres en calcaire,
soient capables de concentrer du calcaire
dans leurs tissus.
La diversité de Papilionacées s'accroît lar-
gement quand on va vers le sud de la
France dans les régions méditerranéennes
sèches et très lumineuses : on ne compte
plus les innombrables luzernes et trèfles,
parfois miniatures, des garrigues et bords
de mer. De même, les milieux alpins
ouverts concentrent un grand nombre
d'espèces assez rares : astragales,
Oxytropis, etc. Le sainfoin est d'ailleurs
aussi une plante de montagne à l'origine…
4BIODYNAMIS -N° 60 HIVER 2007

N° 60 HIVER 2007 -BIODYNAMIS 5
Les deux systèmes racines sont très différents : à l’image
des familles de ces deux plantes : un pivot profonf et peu
ramifié chez le sainfoin, et une racine fasciculée très fii-
nement ramifiée chez le seigle.
A gauche, sainfoin au bout d’un an ; semé en mai.
À droite, seigle au bout de 8 mois semis fin septembre
En bas à gauche, luzerne semée entre deux plaques de
verre afin de bien voir le système racinaire

Pour terminer ce petit tour d'horizon, évo-
quons un "immigré", le robinier faux-acacia
(les vrais acacias appartiennent à la famille
des Mimosacées) arbre américain assez
envahissant introduit de l'est des États-Unis
par Jean Robin en France au XVII° siècle.
Les légumineuses cultivées
En ce qui concerne les plantes cultivées,
les recherches archéologiques montrent
que les premières plantes cultivées et
donc modifiées par l'homme au Proche-
Orient sont des graminées (les ancêtres
du blé : engrain, emmer, etc.) et des
Papilionacées : en particulier les lentilles.
Les fèves et les lentilles seront ensuite
très consommées durant la civilisation
grecque et romaine. Il est intéressant de
remarquer que l'on retrouve ce "couple"
fondamental céréales-légumineuses
comme alimentation de base et premières
plantes cultivées sur les différents conti-
nents. Le Proche-Orient a le blé et les
lentilles, l'Afrique le millet et ses haricots
dolichos, l'Asie orientale, le riz et le soja
et l'Amérique, le maïs et les haricots. En
Amérique ces plantes étaient cultivées
ensemble (souvent avec une courge au
pied), le maïs servant de tuteur au haricot
et le haricot fournissant de l'azote au maïs
très exigeant. Ce n'est certainement pas
un hasard d'autant que la composition de
ces deux familles de plantes est très com-
plémentaire : céréales riches en glucides
et légumineuses riches en protéines.
De même, ce milieu créé par l'homme
qu'est la prairie "naturelle" (en fait elle ne
peut exister que si l'homme alterne pâtu-
rage par les animaux et fauche) a pour
base un bon équilibre entre graminées et
légumineuses auxquelles s'ajoutent
d'autres plantes "aromatiques" et médici-
nales. C'est parmi ces deux familles que
l'on trouve l'alimentation de base de nos
animaux d'élevage. Est-ce un hasard ou
s'exprime-t-il dans ce couple une polarité
essentielle ? Nous allons esquisser une
comparaison de ces deux familles.
Comparons légumineuses et graminées
Du point de vue des racines, les
Papilionacées ont des racines plutôt pivo-
tantes assez épaisses, portant des nodosi-
tés, nodules formés par la plante en
réponse à la pénétration de bactéries du
sol (Rhizobium) capables de fixer l'azote
de l'air du sol. Les graminées, quant à
elles, ont plutôt tendance à avoir des
racines fasciculées fines et très nom-
breuses qui pénètrent intiment le sol sans
pivot (voir les images page 5). Et surtout
elles ne sont absolument pas capables de
se lier à des processus du sol au point de
les intégrer comme les nodosités. C'est
pourquoi l'agriculture bio utilise souvent
6BIODYNAMIS -N° 60 HIVER 2007
Le sainfoin de montagne (Onobrychis mon-
tana) : des fleurs qui rappellent la forme d’un
animal, papillon ou insecte

le mélange graminées - légumineuses
pour que ces dernières approvisionnent
les graminées en azote.
Les tiges et le port général des légumi-
neuses sont plutôt horizontaux, étendus
dans la largeur, voire retombant au sol si
les vrilles ne trouvent pas à s'accrocher
alors que les graminées donnent l'impres-
sion de se lever sur la pointe des pieds sur
leurs tiges minces et élancées. Les feuilles
renforcent cet aspect : d'un côté des
feuilles composées, rondes, larges, vert
bleuté et de l'autre des feuilles linéaires se
terminant en pointe coupante (par les
dents de silice des bords) devenant parfois
de fines aiguilles comme chez le nard
raide, graminée de montagne. On pourrait
dire que la légumineuse renferme ses
feuilles sur elle-même, ne s'insère pas
dans l'espace alors que la graminée affine
ses feuilles au point de presque les faire
disparaître dans l'espace… Le vert est
plutôt clair, lumineux et les feuilles jau-
nissent en prenant des couleurs orange,
jaune ou doré alors que les feuilles des
légumineuses noircissent en fanant.
Du point de vue des fleurs, on a du côté
des légumineuses des fleurs aux couleurs
chatoyantes, lumineuses allant du jaune
vif au violet le plus foncé créant un espace
intérieur dans leur carène presque fermé.
Ces fleurs zygomorphes (c’est-à-dire avec
une symétrie bilatérale formant une sorte
de copie d'insecte) et ouvertes dans l'es-
pace horizontal restent longtemps ouvertes
et ne fanent que lentement. Elles sont plus
liées aux insectes qu'aux rythmes du soleil
comme d'autres fleurs qui s'ouvrent et se
ferment au cours de la journée.
Chez les graminées, on trouve des fleurs
réduites aux organes de reproduction dont
la floraison très éphémère se passe à grande
échelle. Tout le champ de blé fleurit
comme s'il s'agissait d'un processus de la
terre en lien avec les éléments, air et
lumière, sans aucun lien avec les insectes.
On constatera aussi chez les légumi-
neuses une tendance à mêler feuilles et
fleurs sur les tiges. D'ailleurs les fleurs
apparaissent à l'aisselle des feuilles et
non au sommet de la tige - alors que chez
les graminées la fleur s'élève bien au-des-
sus de la sphère végétative (sauf chez les
variétés de céréale modernes artificielle-
ment raccourcies), ce qui éloigne la plante
de son "type".
Les fruits sont tout aussi différents : d'un côté
des fruits verts ayant des difficultés à maturer
dans lesquels on reconnaît souvent la forme de
la feuille (comme la gousse de petit pois). Il faut
toujours cuire ces graines en forme de rein,
forme animale refermée sur elle-même, pour
finir la maturation sinon le goût reste vert. Il est à
noter que le terme de légume était jadis réservé
aux fruits des seules légumineuses dont il dési-
gnait le fruit, la gousse.
De l'autre côté, on trouve des fruits secs
simples, des caryopses appelés plus cou-
ramment grains chez les céréales. Ces
fruits secs sont réduits au minimum, très
denses pour concentrer le maximum de
substance alimentaire mûrie par la
lumière et la chaleur du soleil
Une proximité avec l’animal
La légumineuse réunit une ensemble de
caractéristiques particulières : formation
de nodosités intériorisant des processus
du sol, tendance à la formation de vrille
montrant une tendance à prendre un carac-
tère animal tactile, une tendance des
plantes à être plutôt tournées vers la terre
et ses processus, basses, étalées, une
interpénétration des processus foliaire et
floral. Elle ne parvient pas à véritable-
ment élever sa tige pour former fleurs et
fruits au-dessus de la sphère végétative
dans un espace purement "cosmique".
N° 60 HIVER 2007 -BIODYNAMIS 7
 6
6
1
/
6
100%