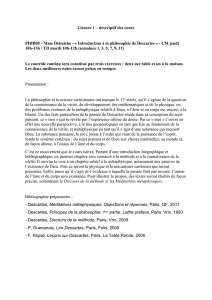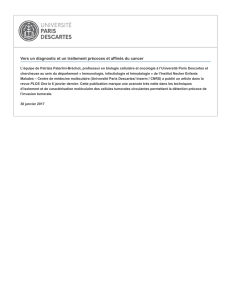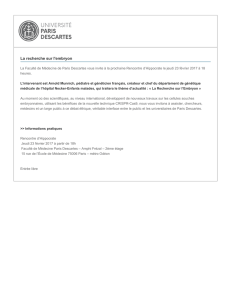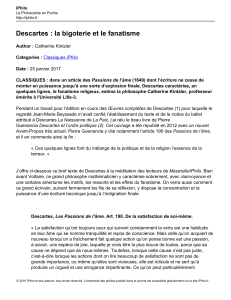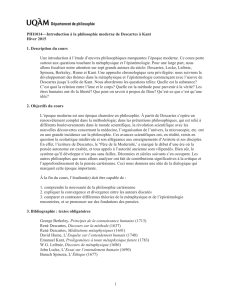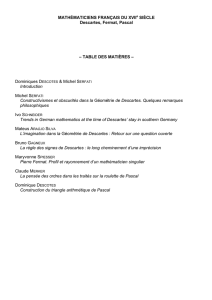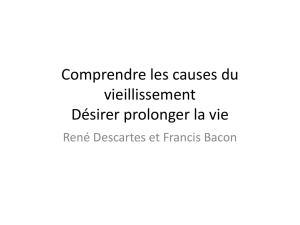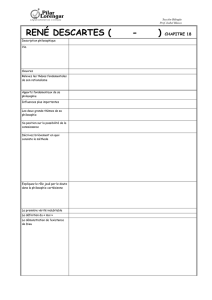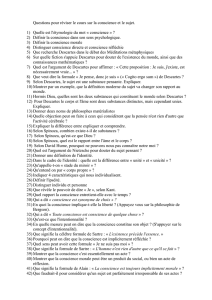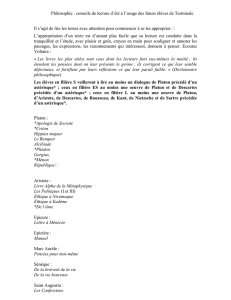sont agréables,6 et,

DESCARTES
ET
LE
THEATRE
Jean-Pierre
Dabin
Ce
titre
ne
doit
pas
être
entendu
au
sens
de
"Descartes
dramaturge":
il
ne
s'agit
pas
de
ce
qu'il
y
aurait
de
théâtral
dans
l'écriture
cartésienne,
soit
dans
le
style,
soit
dans
les
personnages
qu'il
fait
comparaître,1
par
exemple,
mais
plutôt
de
ce
que
le
théâtre
permet
à
Descartes
de
pen¬
ser.
De
plus,
nous
ne
prétendons
pas
ici
a
l'exhaustivité
dans
le
relevé
et
la
prise
en compte
des
réflexions
cartésiennes
sur
le
théâhtre:
nous
nous
intéresserons
essentiellement
à
l'ensemble
constituer
par
la
Correspondance
avec
Elisabeth
et
le
Traité
des
Passions
de
l'Ame,
alors
qu'il
existe
d'autres
textes
cartésiens
faisant
allusion
ou
référence
au
théâtre.2
Bien
plus,
dans
l'en¬
semble
que
nous
venons
de
définir,
nous
allons
isoler
un
élément,
commencer
par
l'étude
de
celui-ci
et
quasiment
nous
y
arrêter:
il
s'agit
de
la
première
lettre
a
Elisabeth,
ou
Descartes
décrit
et
utilise
l'expérience
du
spectateur
au
théâtre.3
Enfin,
nous
n'affirmons
pas
que
la
lec¬
ture,
que
nous
proposons
de
ce
texte
premier,
vaut
pour
tous
les
autres
textes
cartésiens
sur
le
théâtre:
il
se
pourrait
au
contraire
qu'il
soit
exceptionnel.
En
elfet,
cette
lettre
du
18
Mai
1645
permet
de
rapprocher
et
de
confronter
le
théâtre
et
la
métaphysique,
alors
que,
par
un
autre
ver¬
sant,
le
théâtre
conduit
Descartes
a
la
générosité,
dans
le
Traité
des
Passions.
Ce
second
versant,
qui
est
sans
doute
principal
pour
Descartes
lui-même,
nous
le
contournons,
pour
tenter
d'ex¬
plorer
l'autre,
même
moins
étendu
et
moins
ensoleillé.
Rappelons
rapidement
le
cadre
de
cette
Lettre
à
Elisabeth
du
18
Mai
1645
et
de
la
pre¬
mière
référence
au
théâtre
qui
y
trouve
place:
Elisabeth
a
été
longuement
malade,
voire
l'est
encore,
d'une
fièvre
lente.
Descartes,
qu'elle
a
promu,
dès
le
début
de
leur
correspondance,4
"meilleur
médecin
de
son
âme",
mais
qui
a
également
proposé
son
avis
à
l'occasion
d'un
mal
physique
de
la
Princesse,5
donne
à
nouveau
son
opinion:
"La
cause
la
plus
ordinaire
de
la
fiè¬
vre
lente
est
la
tristesse".
Le
mal
du
corps,
donc,
vient
de
l'âme
et
l'âme
d'Elisabeth
est
elle-
même
malade
des
malheurs
politiques
de
la
famille
Palatine.
Il
faut
qu'Elisabeth
"par
la
force
de
sa
vertu,
(rende
son)
âme
contente,
malgré
les
disgrâces
de
la
fortune". Ici,
pour
préciser
ce
projet
évidemment
paradoxal
et
aider
la
Princesse
a
le
réaliser.
Descartes
fait
intervenir
la
distinction
entre
"les
plus
grandes
Ames"
et
"celles
qui
sont
basses
et
vulgaires".
Ce
qui
caractérise
les
premières
et
les
rend
plus
grandes
que
le
commun
des
âmes,
si
l'on
peut
dire,
nous
l'appellerons
l'asymétrie
entre
le
bonheur
et
le
malheur:
les
Ames
basses,
dit
Descartes,
"ne
sont
heureuses
ou
malheureuses,
que
selon
que
les
choses
qui
leur
surviennent
sont
agréa¬
bles
ou
désagréables":
elles
coïincident
immédiatement
avec
leurs
passions,
auxquelles
"elles
se
laissent
aller",
passions
qui
ne
sont
elles-mêmes
que
l'effet
brut
des
événements
extérieurs,
en
tant
qu'ils
favorisent
ou
contrarient
leurs
désirs.
A
l'inverse,
les
grandes
âmes
retravaillent
leurs
passions:
elles
sont
heureuses,
lorsque
les
choses
qui
leur
surviennent
sont
agréables,6
et,
1
"Les
Fourberies
du
Malin
Génie"
et
autres
pieces.
2
J'en
mentionnerai
simplement
un,
qui
témoigne
d'un
intérêt
ancien:
les
premières
lignes
de
VAbrégé
de
Musique.
3
Lettre
du
18
Mai
1645.
4
16
Mai
1643.
5
Juiilet
1644.
6
Mais,
dit
Descartes,
tout
en
restant
toujours
maîtresses
de
cette
joie,
de
façon
à
n'en
être
point
"enivrées"
;
toutes
les
passions,
y
compris
les
gaies,
sont
bien
retravaillées.
391

surtout,
car
plus
extraordinaire,
"leur
raison
fait
que
leurs
afflictions
même
leur
servent
et
con¬
tribuent
à
la
parfaite
félicité
dont
elles
jouissent
dès
cette
vie".
Voilà
l'asymétrie,
chez
les
gran¬
des
âmes,
du
bonheur
et
du
malheur:
elles
se
rendent
toujours
heureuses,
directement
par
les
succès
de
la
fortune
—tout
en
évitant,
à
nouveau,
l'ivresse—,
indirectement
par
ses
revers.
C'est
dans
ce
cadre
qu'intervient,
quelques
lignes
plus
loin,
l'expérience
théâtrale,
comme
réalisation
exemplaire
de
ce
"contentement
de
l'âme
malgré
les
disgrâces
de
la
fortune".
Mais
quelques
lignes
plus
loin
seulement:
car
Descartes
donne
d'abord
une
explication
métaphysique
de
la
force
des
grandes
âmes:
"D'une part,
se
considérant
comme
immortelles
et
capables
de
rece¬
voir
de
très
grand
contentements,
puis,
d'autre
part,
considérant
qu'elles
sont
jointes
à
des
corps
mortels
et
fragiles,
qui
sont
sujets
a
beaucoup
d'infirmités,
et
qui
ne
peuvent
manquer
de
périr
dans
peu
d'années,
elles
font
bien
tout
ce
qui
est
en
leur
pouvoir
pour
se
rendre
la
fortune
favo¬
rable
en
cette
vie,
mais
néanmoins,
elles
l'estiment
si
peu,
au
regard
de
l'éternité,
qu'elles
n'en
considèrent
quasi
les
événements
que
comme
nous
faisons
ceux
des
comédies".
La
fonction
de
la
métaphysique
semble
donc
double:
d'une
part,
procurer
à
l'âme
grande
une
jouissance
par¬
ticulière,
image
dès
cette
vie
de
la
félicité
future,
après
la
mort,
à
contempler
Dieu.
Nous
pou¬
vons
penser
ici
aux
toutes
dernières
lignes
de
la
Troisième
Méditation:
"comme
la
foi
nous
apprend
que
la
souveraine
félicité
de
l'autre
vie
ne
consiste
que
dans
cette
contemplation
de
la
Majesté
divine,
ainsi
expérimenterons-nous
dès
maintenant,
qu'une
semblable
méditation,
quoique
incomparablement
moins
parfaite,
nous
fait
jouir
du
plus
grand
contentement
que
nous
soyons
capables
de
ressentir
en
cette
vie".
Dès
cette
vie,
donc,
cette
jouissance
métaphysique
est
la
plus
haute
de
toutes
et
les
grandes
âmes
la
connaissent.
D'autre
part,
dit
alors
la
lettre,
protégées
par
ce
contentement,
elles
ne
souffrent
pas
des
malheurs
de
la
fortune.
Or,
il
me
sem¬
ble
que
l'on peut
faire
à
cette
détermination
métaphysique
de
la
grandeur
d'hme
deux
objec¬
tions,
en ce
qu'elle
ne
remplit
pas
parfaitement
la
promesse
initiale
de
Descartes:
en
premier
lieu,
la
jouissance
métaphysique
permet
à
l'âme
d'éprouver
du
plaisir
malgré
les
revers
exté¬
rieurs,
mais
on
ne
peut
dire
alors
que
ceux-ci
"servent"
à
cette
félicité
ou
y
"contribuent".
En
second
lieu,
et
conséquence
de
la
première
objection,
la
grande
âme
ne
risque-t-elle
pas
de
devenir
insensible,
non
seulement
aux
événements
désagréâbables,
puisqu'elle
n'en
souffre
pas,
mais
aussi
aux
événements
agréables,
qu'elle
finirait
par
estimer
aussi
peu
que
les
mal¬
heurs,
leur
préférant
le
plaisir
de
l'âme
seule
à
contempler
Dieu?
L'importance
de
l'expérien¬
ce
théâtrale
apparaît
alors:
ce
serait
elle
qui
permettrait
de
comprendre
vraiment
comment
les
grandes
âmes
se
rendent
toujours
heureuses,
en
corrigeant
l'interprétation
métaphysique.
"Et
comme
les
histoires
tristes
et
lamentables,
que
nous
voyons
représenter
sur
un
théâtre,
nous
donnent
souvent
aussi
de
récréation
que
les
gaies,
bien
qu'elles
tirent
des
larmes
de
nos
yeux;
ainsi
ces
plus
grandes
âmes,
dont
je
parle,
ont
de
la
satisfaction,
en
elles-mêmes,
de
toutes
les
choses
qui
leur
arrivent,
même
les
plus
lâcheuses
et
insupportables."
Deux
types
de
pibces,
donc:
les
comédies,
ou
"histoires
gaies",
dont
les
personnages
sont
heureux,
au
dénouement
du
moins,
les
tragédies
ou
"histoires
tristes
et
lamentables",
ou
les
personnages
souffrent:
les
premières,
nous
le
savons,
s'achèvent
souvent
par
des
mariages,
les
secondes
par
la
mort.
Le
spectateur
de
comédies,
dit
Descartes,
est
heureux:
il
se
"récrée",
sans
doute
parce
qu'il
prend
plaisir
et
participe
au
bonheur
des
personnages.
Le
spectateur
de
tragédies,
symétriquement,
participe
à
la
souffrance
des
héros:
il
compatit
et
pleure.
Mais,
dans
le
même
temps
qu'il
com¬
patit
et
pleure,
il
prend
plaisir.
11
s'agit
ici
d'un
pur
constat
de
Descartes:
telle
est
l'expérience
que
nous
faisons
tous,
lorsque
nous
assistons
â
une
tragédie
au
théâtre.
C'est
dans
des
lettres
ultérieu¬
res
qu'Elisabeth
et
Descartes
s'interrogeront
sur
l'origine
de
ce
plaisir
tragique.
L'important
est
donc
ailleurs:
le
plaisir
du
spectateur
de
tragédie
naît
de
la
souffrance,
que
lui
inspirent
les
392

malheurs
des
personnages,
et
ce
modble
apparait
alors
comme
le
meilleur
pour
la
thèse
initia¬
le
de
Descartes:
les
grandes
âmes
sont
heureuses
des
malheurs
de
la
fortune
comme
de
ses
succès.
En
effet,
le
plaisir
tragique
répond
â
la
première
objection
que
l'on
pouvait
faire
à
l'ar¬
gument
métaphysique:
par
la
pensée
que
le
corps
et
l'âme
sont
distincts
et
que
celle-ci
est
im¬
mortelle et
appelée
à
contempler
Dieu,
contemplation
dont
elle
peut
jouir,
sous une
forme
imparfaite
dès
cette
vie,
on
peut
bien
éprouver
du
plaisir
intérieurement
malgré
la
souffrance
extérieure,
due,
elle,
â
l'union
de
l'âme
et
du
corps.
Mais
le
spectateur
de
tragédie
éprouve
du
plaisir
grâce
à
sa
compassion
pour
les
personnages:
or,
c'est
bien
cela
que
Descartes
affirmait
des
grandes
âmes:
meme
lorsque
les
événements
sont
défavorables
et
qu'elles
en
soulfrent,
elles
parviennent
à
être
heureuses
de
cela
même.
Le
plaisir
tragique
répond
également
à
la
seconde
objection
que
l'on
pouvait
faire
â
l'interprétation
métaphysique
de
la
grandeur
d'âme:
celui
qui,
pour
ne pas
souffrir
des
malheurs
de
la
vie,
se
retire
d'elle
pour
méditer
sur
Dieu
ou
contempler
sa
majesté,
celui-là
risque
de
devenir
insensible
à
la
vie
tout
entière,
non
seulement
à
ses
souffrances,
mais
aussi
à
ses
bonheurs,
parce
qu'il
se
serait
endurci
et
rendu
indifférent
aux
événements
de
cette
vie,
bons
ou
mauvais,
leur
préférant,
dès
maintenant,
les
bonheurs
de
l'âme
seule.
Au
contraire,
le
spectateur
de
théâtre
est
un
être
que
nous
dirions
hypersensible:7
il
prend
plaisir
aux
événements
heureux
des
comédies
et,
loin
d'être
indifférent
aux
malheurs
représentés
dans
la
tragédie,
y
participe
par
compassion. Et,
de
fait,
nous
savons
tous
que,
si
la
tragédie
est
mauvaise
ou
que
le
tragédien
ne
parvient
pas
â
nous
intéresser
aux
malheurs
de
son
personnage,
nous,
spectateurs,
nous
ne
nous
apitoierons
pas
et,
par
conséquent,
nous
ne
tire¬
rons
non
plus
aucun
contentement
du
spectacle.
L'intérêt
du
théâtre
pour
Descartes
serait
ainsi
qu'il
représente
une
expérience
de
l'entre-deux:
le
spectateur
doit
s'identifier
au
personnage,
sans
quoi
pas
de
compassion
ni
de
plaisir,
mais
cette
identification
n'y
est
jamais
totale;
il
se
trouve
qu'il
éprouve
un
certain
contentement,
en
même
temps
qu'il
souffre
pour
le
pauvre
Rodrigue.
S'il
n'y
avait
que
compassion
et
souffrance,
le
spectateur,
selon
Descartes,
n'irait
pas
au
théâtre.
De
la
même
façon,
les
gens
à
qui
les
films
d'horreur
font
seulement
peur,
par
exem¬
ple,
ne
les
regardent
pas:
vont
voir
ces
films
ceux,
qui
prennent
plaisir
à
leur
peur.
Etre
specta¬
teur,
selon
Descartes,
est
donc
toujours
simultanément
identification
et
distanciation;
or,
cette
expérience
conjointe
du
faire-un
avec
le
personnage,
sans
quoi,
encore
une
fois,
le
spectateur
s'ennuie,
et
de
l'être-distinct
—aucun
spectateur
ne
désire
seulement
compatir—
nous
semble
plaire
à
Descartes,
parce
qu'il
y
voit
un
modèle
exact
de
ce
que
devrait
être
la
bonne
relation
entre
l'âme
immortelle
et
le
corps
auquel
elle
est
jointe
pendant
cette
vie,
autrement
dit,
la
mé¬
thode
précise
à
suivre
pour
se
rendre
heureux
en
cette
vie.
Nous
faisons
référence
ici
à
la
Lettre
du
28
Juin
1643.
la
deuxième
grande
lettre
de
Descartes
à
Elisabeth:
"Ceux
qui
ne
philosophent
jamais,
et
qui
ne
se
servent
que
de
leurs
sens,
ne
doutent
point
que
l'âme
ne
meuve
le
corps,
et
que
le
corps
n'agisse
sur
l'âme;
mais
ils
con¬
sidèrent
l'un
et
l'autre
comme
une
seule
chose,
c'est-â-dire,
ils
conçoivent
leur
union;
car
conce¬
voir
l'union
qui
est
entre
deux
choses,
c'est
les
concevair
comme
une
seule.
Et
les
pensées
métaphysiques,
qui
exercent
l'entendement
pur,
servent
à
nous
rendre
la
notion
de
l'âme
familiè¬
re;
et l'étude
des
mathématiques,
qui
exerce
principalement
l'imagination
en
la
considération
des
figures
et
des
mouvements,
nous
accoutume
à
former
des
notions
du
corps
bien
distinctes;
et
enfin,
c'est
en
usant
seulement
de
la
vie
et
des
conversations
ordinaires,
et
en
s'abstenant
de
médi¬
ter
et
d'étudier
aux
choses
qui
exercent
l'imagination,
qu'on
apprend
â
concevoir
l'union
de
7
A
rapprocher
de
l'idée
cartésienne,
selon
laquelle
les
grandes
Ames
ont,
en
vérité,
des
passions
plus
fortes
qus
les
autres.
393

l'Ame
et
du
corps".
Comprendre
l'union
de
l'âme
et
du
corps
ne
fait
problème
que
pour
ceux
qui
ont
fait,
au
moins
une
fois
en
leur
vie,
de
la
métaphysique
et
compris
leur
réelle
distinction:
c'est
le
cas
d'Elisabeth
au
début
de
sa
correspondance
avec
Descartes.
Mais
cette
difficulté
est
riches¬
se,
car,
désormais,
on
peut
essayer
de
vivre
en
connaissance
de
cause,
si
j'ose
dire;
l'union
de
l'âme
et
du
corps
pourra
être
réellement,
c'est-A-dire
toujours,
heureuse,
pour
les
âmes
qui
se
savent
en
même
temps
distinctes,
et
pour
celles-là
seules;
et
ce
sont
elles
que
Descartes
dira
gran¬
des.
D'où
cette
réflexion,
le
28
Juin
1643,
sur
l'emploi
du
temps:
s'il
suffit
d'employer
fort
peu
d'heures,
par
an,
à
la
métaphysique,
entendons
â
la
métaphysique
pour
elle-même,
c'est
parce
qu'il
s'agit
maintenant
de
se
rappeler
les
conclusions
de
cette
métaphysique,
d'"emp!oyer"
les
vérités
qu'elle
a
permis
de
connaître
tout
le
reste
du
temps,
tout
le
temps
de
la
vie.
Pour
vivre
heu¬
reux,
il
faut
vivre,
et
non
faire
de
la
métaphysique;
mais
il
faut
vivre
du
point
de
vue
de
la
métaphysique.
Telle
serait
donc
l'originalité
et
l'importance
de
l'argument
théâtral,
en
sa
premiè¬
re
occurrence
entre
Descartes
et
Elisabeth:
corriger
le
discours
d'abord
métaphysique,
par
lequel
Descartes
propose
â
la
Princesse
un
moyen
d'être
heureuse,
quelles
que
soient
les
difficultés
exté¬
rieures.
Nous
proposerons
une
troisième
différence
entre
métaphysique
et
théâtre:
le
modèle
théâtral
de
la
grandeur
d'âme
semble
plus
universel
que
la
détermination
métaphysique
de
celle-
ci,
parce
qu'il
est
laie.
L'expérience
du
plaisir
tragique
est
partagée
par
tous,
et
l'on
pourrait
ima¬
giner
alors,
à
la
limite,
une
grande
âme
qui
soit
athée,
ce
qui
est
en
revanche
inconcevable
dans
la
première
caractérisation
cartésienne
du
bonheur
intérieur.
Le
sort
des
athées,
dira-t-on,
indiffè¬
re
sans
doute
Descartes8
et
ce
n'est
pas
pour
eux
qu'il
fait
référence
au
théâtre;
mais
ce
n'est
pas
si
simple
peut-être,
car,
si
Descartes
et
Elisabeth
partagent
la
même
foi
en
une
vie
future
de
féli¬
cité
parfaite
dans
la
contemplation
de
Dieu,
le
philosophe
est
catholique
et
la
Princesse
protes¬
tante,
différence
de
confession
qui
sera cause,
au
moins
une
fois
dans
leur
correspondance,
d'une
brouille
assez
sérieuse,
une
des
seules
et
peut-être
la
plus
nette
dans
les
lettres
que
nous
connais¬
sons.
En
effet,
le
30
Novembre
1645,
Elisabeth
écrit
à
Descartes
à
propos
de
l'abjuration
et
de
la
conversion
à
l'Église
Romaine
de
son
frère
Edouard:
"Cette
folie",
dit-elle,
"m'a
plus
troublé
la
santé
du
corps
et
la
tranquillité
de
l'Ame
que
tous
les
malheurs
qui
me
sont
encore
arrivés".
La
grandeur
d'âme
d'Élisabeth,
semble-t-il,
n'a
pasété
ici
suffisante.
Mais
surtout,
elle
ajoute
quelques
phrases,
évidemment
difficiles
a
lire
pour
Descartes:
"II
faut
queje
voie
une
personne,
que
j'aimais
avec
autant
de
tendresse
que
j'en
saurais
avoir,
abandonnée
au
mépris
du
monde
et
à
la
perte
de
son
âme
(selon
ma
croyance).
Si
vous
n'aviez
plus
de
charité
que
de
bigoterie,
ce
serait
une
impertinence
de
vous
entretenir
de
cette
matière
(...)".
Malgré
ces
précautions
tardives,
la
réponse
de
Descartes
se
fera
attendre
et
ne
manquera
pas
de
froideur:
"Je
ne
puis
nier
que
je
n'aie
été
surpris
d'apprendre
que
Votre
Altesse
ait
eu
de
la
fâcherie,
jusqu'au
en
être
incommo¬
dée
pour
sa
santé,
pour
une
chose
que
la
plus
grande
part
du
monde
trouvera
bonne
(...)".9
Or,
dans
cette
même
lettre,
ayant
rapidement
laissé
de
cété
ce
sujet
épineux,
Descartes
répond
à
Eli¬
sabeth
sur
une
question
qui
est
une
reprise
exacte,
sous une
forme
ditférente,
de
celle
des
gran¬
des
âmes:
avons-nous
bien
dans
la
vie,
comme vous
le
dites,
a
demandé
la
Princesse,10
plus
de
biens
que
de
maux?
Or,
on
verrait
mal
Descartes,
juste
après
l'bvidence,
simplement
refoulée,
de
leur
divergence
de
foi,
reprendre
alors
l'argumentation
métaphysique
de
la
Lettre
du
18
Mai
1645;
voici
le
début
de
sa
réponse:
"Ce
qui
m'a
fait
dire
qu'il
y
a
toujours
plus
de
biens
que
de
8
On
sait,
également,
que
les
athées
ne
sauraient
Otre
mathématiciens,
selon
lui;
c'est
pourquoi
nous
imagi¬
nons,
presque
comme
une
boutade,
une
grande
âme
athée.
9
janvier
IB46.
10
30
Novembre
1645.
394

maux
en
cette
vie,
c'est
le
peu
d'état
queje
crois
que nous
devons
faire
de
toutes
les
choses
qui
sont
hors
de
nous,
et
qui
ne
dépendent
point
de
notre
libre-
arbitre,
à
comparaison
de
celles
qui
en
dépendent,
lesquelles
nous
pouvons
toujours
rendre
bonnes,
lorsque
nous
en
savons
bien
user".
Pourtant,
la
métaphysique
n'est
pas
si
loin:
"faire
peu
d'état
des
choses
hors
de
nous"
nous
rap¬
pelle
le
peu
d'estime
pour
les
choses
de
fortune,
dans
la
Lette
du
18
Mai
1645;
et
le
libre-arbitre,
dont
le
bon usage
permet
de
jouir
toujours
du
bien,
ne
renvoie-t-il
pas
directement
à
la
distinction
de
l'Ame
et
du
corps'?
Il
faudrait
montrer
ici
que,
si
la
vertu
cartésienne
s'identifie
d'abord
à
la
résolution
de
suivre
le
bien
(représenté
par
l'entendement),
cette
résolution
constituant
précisé¬
ment
le
bon
usage
du
libre-arbitre,
celui-ci
ne
saurait
rester
purement
formel
et
doit
inclure
le
plus
possible
la
connaissance
du
vrai
bien:
nous
pensons
en
particulier
ici
à
la
Lettre
de
Descartes,
le
15
Septembre
1645,
ou,
toujours
sur
la
demande
d'Elisabeth,11
Descartes
énonce
les
vérités
qu'il
nous
est
utile
de
connaître:
or,
les
deux
premières
sont
à
nouveau
l'existence,
puissance
et
perfection
de
Dieu,
d'une
part,
la
distinction
de
l'Ame
et
du
corps,
d'autre
part.
Simplement,
il
nous
semble
qu'en
Janvier
1646,
bien
qu'Elisabeth
vienne
de
vivre
une
des
épreuves
les
plus
dif¬
ficiles
de
sa
vie
et
qu'il
soit
d'autant
plus
urgent
que
Descartes
l'aide
à
se
rendre
heureuse-en-
quelque-fagon-malgré-tout,
il
ne
saurait
arguer
de
la
foi
en
Dieu
et
en
l'immortalité
de
l'âme.
Car,
comme
l'a
révélé
l'incident
provoqué
par
la
conversion
d'Edouard,
leurs
fois
respectives
res¬
tent
sans
doute
irréductiblement
différentes.
Ainsi,
Descartes
se
réfbre
en
ces
circonstances
au
théâtre
seul;
voici
la
suite
de
la
Lettre
de
Janvier
1646:
"et
nous
pouvons
empêcher,
par
leur
moyen
(c'est-à-dire,
en
rendant
toujours
bonnes
les
choses
qui
dépendent
de
notre
libre-arbitre),
que
tous
les
maux
qui
viennent
d'ailleurs,
tant
grands
qu'ils
puissent
être,
n'entrent
plus
avant
en
notre
Ame
gue
la
tristesse
que
y
excitent
les
combdiens,
lorsqu'ils
représentent
devant
nous
quelques
actions
fort
funestes;
mais
j'avoue,
ajoute
Descartes,
qu'il
faut
être
fort
philosophe
pour
arriver
jusqu'au
ce
point".
La
philosophie
par
le
théâtre
est
peut-être
difficile,
mais
elle
est
au
moins
universelle,
parce
que
la'¡que.
Nous
reconnaissons,
en
vérité,
que
la
Lettre
du
18
Mai
1645,
la
premibre,
donc,
ou
apparaît
le
thème
du
théâtre,
est
aussi,
A
notre
connaissance
du
moins,
la
seule
ou
soient
directement
rapprochés
le
modèle
méthaphysique
et
le
modèle
théâtral
de
la
gran¬
deur
d'âme,
rapprochement
qui
nous
a
autorisé
à
les
confronter.
Dès
lors,
dans
les
lettres
que nous
venons
d'examiner,
l'échange,
de
Novembre
1645
a
Janvier
1646,
autour
de
la
conversion
du
frère
d'Elisabeth,
la
réfbrence
de
Descartes
à
l'expérience
théâtrale
seule,
à
l'exclusion
de
toute
exhortation
métaphysique,
peut
sembler
elle-même
peu
significative;
nous
croyons
cependant
que
le
contexte
religieux
dramatique
donne
ici
un
certain
piment
a
cette
séparation
des
deux
regis¬
tres.
En
revanche,
l'autonomie
générale
de
la
référence
au
théâtre
nous
semble
signaler
que
sa
fonction
ne
se
réduit
pas
à
celle
que nous
avons
isolée
ici,
à
savoir,
corriger
la
détermination
pure¬
ment
métaphysique
du
bonheur
véritable.
En
particulier,
il
s'y
joue
certainement
aussi,
et
sans
doute
plus
essentiellement
pour
Descartes
lui-même,
la
pensée
d'autrui
et
de
mon
attitude
face
aux
souffrances
d'autrui.
Il
est
très
significatif
que,
dans
le
Traité
des
Passions,
les
deux
princi¬
pales
occurrences
du
thbme
du
plaisir
tragique12
aient
pour
objet
la
faqon,
dont
la
grande
âme,
ou
maintenant
l'âme
généreuse,
doit
se
comporter au
regard
du
malheur
des
autres
hommes:
com¬
ment
peut-elle
y
participer,
compatir,
tout
en
éprouvant
à
cette
occasion
une
satisfaction
inté-
11
Août
1645;
Elisabeth
à
Descartes;
"j'espière
que vous
continuerez
a
m'enseigner
les
moyens
de
fortifier
l'entendement,
pour
juger
du
meilleur
en
toutes
les
actions
de
la
vie,
qui
me
semble
être
la
seule
difficulté,
puis¬
qu'il
est
impossible
de
ne
point
suivre
le
bon
chemin,
quand
il
est
connu".
12
Dans les
articles
147,
"Des
émotions intérieures
de
l'âme",
et
187,
"Comment
les
plus
génhreux
sont
tou¬
chés de
la
pitié".
395
 6
6
1
/
6
100%