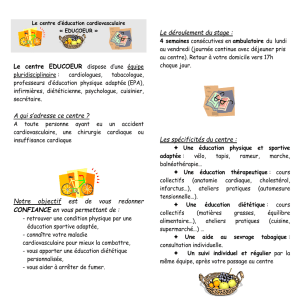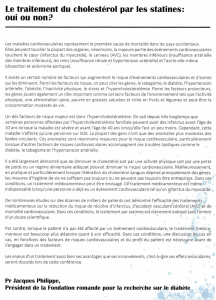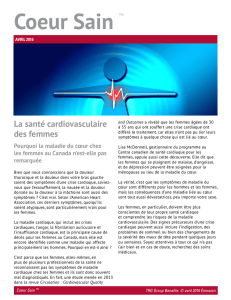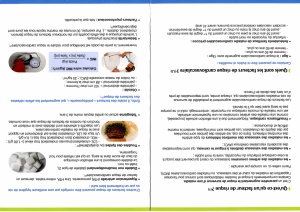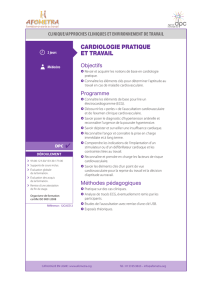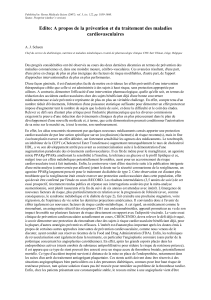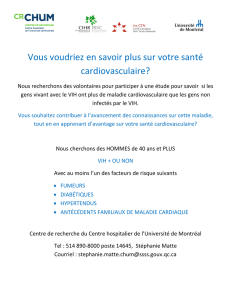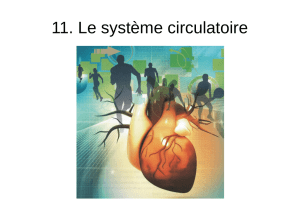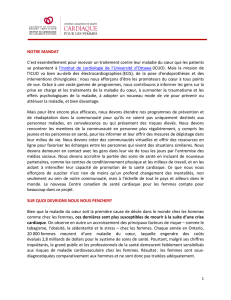Lire l`article complet

140
Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition (VII), n° 3, mai/juin 2003
Une démarche d’éducation thérapeutique
pour un meilleur contrôle de l’hypercholestérolémie
et du risque cardiovasculaire global
I. Durack-Bown*, P. Giral*, J.F. d’Ivernois**, R. Chadarevian***, A. Benkritly***, É. Bruckert*
L
a connaissance par la population des maladies
cardiovasculaires et des facteurs de risque associés
s’est améliorée dans les années 1980, aux États-Unis
comme en Europe (1-3). Depuis, de nombreuses études
ont montré que le contrôle intensif des facteurs de risque
diminue l’incidence des événements cardiovasculaires
(4, 5). Malgré toutes les preuves scientifiques en faveur,
notamment, du contrôle de l’hypercholestérolémie, et en
dépit des informations diffusées par les médias, l’intérêt
du public, depuis les années 1990, est peu marqué dans
le domaine de la prévention cardiovasculaire (2, 6). Les
conséquences s’observent déjà, y compris chez les patients
en prévention secondaire. En effet, en Europe, les résultats
des enquêtes EUROASPIRE I et II (7) montrent qu’en
cinq ans, la prévalence du tabagisme ou de l’hypertension
reste inchangée, alors que celle de l’obésité augmente.
Par ailleurs, plus d’un patient traité sur deux reste non
contrôlé pour son hypercholestérolémie (taux 5 mmol/l)
(7). Ces données sont similaires en France, où plus de la
moitié des patients hyperlipémiques traités, en prévention
secondaire, n’atteint pas les objectifs fixés par recom-
mandations internationales (7).
L’insuffisance de prescription optimale des médicaments
associée aux difficultés des patients à suivre un traite-
ment hygiéno-diététique et médicamenteux sur le long
terme contribue probablement à expliquer ces résultats.
Les difficultés d’adhésion aux traitements sont, en effet,
souvent mises en évidence dans les études cliniques (8, 9).
La connaissance des risques cardiovasculaires semble
donc insuffisante pour modifier les comportements de
santé (10, 11). De plus, la prise en compte des percep-
tions et des attitudes des patients à risque cardiovas-
culaire est indispensable pour développer des stratégies
préventives efficaces (12).
Le projet PÉGASE (Programme éducatif pour la gestion
améliorée des sujets à risque cardiovasculaire élevé) a été
conçu, au-delà de la simple information, pour aider le
patient à haut risque cardiovasculaire à mieux gérer au
quotidien les difficultés de son traitement. Ce programme
s’inscrit dans une démarche d’éducation thérapeutique,
selon les critères de qualité de l’OMS (tableau) (13).
Après analyse préalable, il intègre la prise en compte des
difficultés rencontrées par le corps médical et celles des
patients, dans un programme éducatif mis en place en
France dans six centres hospitaliers publics et privés.
Nécessité d’une analyse préalable
des besoins éducatifs
Les professionnels de santé s’interrogent de plus en
plus sur la valeur des messages éducatifs délivrés et leur
impact sur les patients à risque cardiovasculaire (14). Face
à cette question, une analyse préalable de la situation
s’imposait pour :
– identifier les perceptions et les attitudes des patients
quant au risque cardiovasculaire et aux facteurs de risque
associés, afin de mesurer les difficultés d’apprentissage
dans ce domaine ;
* Unité de prévention des maladies cardiovasculaires, hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, Paris.
** Laboratoire d’éducation santé (UPRES EA 3412), UFR SMBH, Bobigny,
université de Paris XIII.
*** Laboratoires AstraZeneca, Rueil-Malmaison.
Stratégie thérapeutique
Stratégie thérapeutique
Les critères de qualité de l’éducation thérapeutique
1. centrée sur le patient ;
2. prise en compte des stades d’adaptation
du patient à la maladie ;
3. axée sur les besoins objectifs et subjectifs
des patients ;
4. intégrée au traitement et aux soins ;
5. concerne le patient dans sa vie quotidienne ;
6. implique l’entourage ;
7. adaptée en permanence à l’évolution
de la maladie ;
8. organisée, structurée ;
9. proposée systématiquement à tous les patients ;
10. utilise des méthodes et des moyens variés
d’apprentissage ;
11. multiprofessionnelle et multidisciplinaire ;
12. nécessite un travail en réseau ;
13. réalisée par des professionnels formés ;
14. évaluée.
Tableau. Recommandations de l’OMS groupe Europe.

141
Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition (VII), n° 3, mai/juin 2003
Stratégie thérapeutique
Stratégie thérapeutique
– dégager les besoins éducatifs des patients et les hiérar-
chiser ;
– évaluer les difficultés rencontrées par les médecins pour
faire passer leur message éducatif.
Une première étude qualitative a été menée entre juin
et juillet 2000 auprès de 27 patients hypercholestérolé-
miques à haut risque cardiovasculaire (soit en prévention
primaire lorsqu’il existait une association avec un autre fac-
teur de risque comme le tabac, l’hypertension, le diabète,
ou l’obésité, soit en prévention secondaire) et auprès de
21 médecins libéraux. À partir de l’analyse du contenu
de chacune de ces interviews individuelles, un question-
naire quantitatif a été élaboré et adressé, entre octobre
et décembre 2000, à une population de 293 médecins
(200 généralistes, 48 endocrinologues et 45 cardiologues)
et de 969 patients.
Une trentaine de questions posées aux médecins portaient
sur leurs habitudes et leur rôle concernant la prise en
charge éducative de l’hypercholestérolémie d’une part,
sur l’importance à attribuer, selon eux, aux informations
données aux patients et sur leurs difficultés à faire passer
des messages éducatifs, d’autre part. Les auto-question-
naires des patients comportaient 52 questions fermées et
concernaient leur représentation et leur appréhension de
l’hypercholestérolémie et de son traitement, ainsi que leurs
besoins et attentes en termes d’information et de suivi.
Les résultats de ces enquêtes qualitatives et quantitatives,
présentés dans les paragraphes suivants, ont permis
d’élaborer les bases d’un programme éducatif adapté
aux patients à risque cardiovasculaire.
Perceptions et attitudes comparées
des patients et des médecins
Trois thématiques principales, issues des enquêtes préa-
lables, illustrent bien les différences de perception de
l’hypercholestérolémie entre les patients et les médecins.
Facteurs de risque et risque cardiovasculaire,
une notion floue
Environ 30 % des patients parlent du cholestérol en termes
de maladie : il s’agit “d’une maladie muette, bénigne”.
En revanche, les médecins ne sont pas d’accord avec
ce concept de maladie (figure) qu’ils n’utilisent que pour
9% d’entre eux. Ils préfèrent parler de facteur de risque
cardiovasculaire (88 %) plutôt que de maladie dont la
connotation est, pour eux, “péjorative”. Seuls les endo-
crinologues se distinguent de leurs confrères en parlant
plus volontiers à leurs patients de maladie à propos de
l’hypercholestérolémie. Cependant, la notion de facteur
de risque cardiovasculaire est encore plus évasive que
celle du cholestérol et plus loin de l’idée de maladie.
Parmi une liste de 9 maladies, les patients reconnaissent,
pour 85 % d’entre eux, l’infarctus comme conséquence
d’un excès de cholestérol. Moins fréquente est la connais-
sance de la relation entre hypercholestérolémie et accident
vasculaire cérébral (65%) ou artérite des membres infé-
rieurs (46 %). Les patients ne font pas le lien entre les
mauvaises habitudes alimentaires et les risques cardio-
vasculaires qu’ils encourent. Ils se soucient peu de leurs
mauvaises habitudes alimentaires. Ces dernières, du ressort
du comportement individuel, produisent beaucoup moins
d’inquiétude (7%) que les craintes liées à la vie en société:
la consommation d’aliments pollués ou transformés obtient
un score de 30 %, le risque nucléaire de 28 %.
Traitements : des difficultés au long cours
Une large majorité des patients perçoit pourtant l’alimen-
tation positivement : elle favoriserait la longévité (92 %),
diminuerait la consommation de médicaments (77 %).
Cependant, une personne sur six en prévention primaire et
une personne sur cinq en prévention secondaire affirment
n’avoir reçu aucun conseil alimentaire spécifique de la part
de son médecin par rapport à son excès de cholestérol.
Parmi les patients qui ont reçu des conseils diététiques,
la majorité estime que l’alimentation proposée est mono-
tone (52 %), mal adaptée à leur goût et difficile à suivre
(42 %).
Par ailleurs, à peine la moitié des médecins généralistes
(42 %) et des cardiologues (47 %) parlent des adaptations
possibles de l’alimentation en fonction des circonstances
alors que, pour 93 % des patients, il est utile d’apprendre
à adapter l’alimentation en toutes circonstances. Les
endocrinologues se distinguent cependant en évoquant
ces adaptations dans 83 % des cas.
Malgré l’apparente facilité de la prise d’un médicament,
peu contraignant par rapport au suivi du régime, certains
patients sont réticents à sa prise. Cinquante-neuf pour cent
se sentent gênés par le fait d’avoir trop de cholestérol et
de le traiter. Leur gêne se manifeste pour 59 % d’entre eux
par la prise régulière du médicament. Vient ensuite la
Figure. Comment les médecins parlent-ils du cholestérol? Quelle
perception les patients ont-ils du cholestérol?
Médecins
risque
1% 9%
88 % 62 %
30 %
5%
maladie anomalie sanguine
Patients

142
Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition (VII), n° 3, mai/juin 2003
Stratégie thérapeutique
Stratégie thérapeutique
gêne occasionnée par les repas pris à l’extérieur (45 %)
et lors des fêtes de famille (42 %). Quarante-huit pour
cent des patients contre 19 % des médecins pensent que
les effets secondaires sont très utiles à connaître, alors
que la durée du traitement passe au second plan, après
la connaissance des conséquences des risques cardiovas-
culaires et des facteurs de risque. Pour plus de la moitié
des médecins, la durée du traitement hypolipémiant
(58 %) – pierre angulaire de la prévention des maladies
cardiovasculaires – et les effets secondaires (54 %) sont
des notions difficiles à transmettre.
Langage médical complexe, source de confusion
Les patients trouvent claires à 97 % les explications données
par leur médecin sur le cholestérol et son traitement. Mais
pour 53 % d’entre eux, ces explications ne débouchent que
sur des conseils généraux. Parmi les messages “faciles”
ou “très faciles” à faire passer, l’ensemble des médecins
citent le lien entre excès de cholestérol et maladie cardio-
vasculaire (88 % généralistes, 87 % endocrinologues,
94 % cardiologues), ainsi que la différence entre bon et
mauvais cholestérol (64% généralistes, 84 % endocrino-
logues, 65 % cardiologues). Pourtant, les réponses à cette
dernière question montrent que, à l’évidence, les patients,
en prévention secondaire comme en prévention primaire,
ne connaissent pas vraiment la différence entre la signi-
fication du “bon” et du “mauvais” cholestérol.
Les besoins et les attentes des patients
Lors d’une consultation pour hypercholestérolémie, 68 %
des patients se plaignent du centrage de la consultation
sur l’analyse des résultats biologiques. Dans un cas sur
six, le patient n’ose pas poser de questions à son médecin
à propos de son excès de cholestérol, de l’alimentation ou
du médicament. Parmi ces patients, 45% donnent comme
motif à cette attitude leur crainte de ne pas comprendre
les explications et 38 % le désir de ne pas déranger le
médecin. Dans près de la moitié des cas en prévention
secondaire et dans un tiers des cas en prévention pri-
maire, les patients cherchent des informations en dehors
de la consultation médicale et avant tout auprès de la
presse écrite.
Les médecins disposent pourtant de documents pédago-
giques écrits ou audiovisuels mais les utilisent peu, en
général, lors de leur consultation (84 % des médecins ne
remettent aucun document d’information à leur patient
suite à la consultation).
Cependant, une majorité d’entre eux pense qu’il serait
utile de développer des outils pédagogiques pertinents
autour de certains thèmes, comme la notion du risque
cardiovasculaire (88 %), les facteurs de risque associés
(94 %) et la diététique (96 %).
Comme chez les médecins, c’est le côté pragmatique qui
est plébiscité : ils sont 80 % à vouloir un guide sur la lec-
ture des étiquettes alimentaires (97 % pour les médecins)
et 73 % à souhaiter un guide sur les chiffres du cholestérol
et les conséquences de l’hypercholestérolémie (85 % pour
les médecins).
La prise en compte des difficultés
des médecins
Un tiers des médecins souhaitent, au-delà de la mise à
disposition d’outils pédagogiques, recevoir une formation
aux techniques pédagogiques (généralistes 34 %, endo-
crinologues 29 %, cardiologues 24%) et 87 % d’entre eux
une formation aux techniques de motivation du patient.
En effet, bien que jugeant leur rôle comme central dans
la prévention cardiovasculaire, les médecins se sentent
moins compétents pour favoriser l’adhésion des patients
à leur traitement au long cours (15). En toute lucidité, les
médecins constatent que l’observance de leurs patients
pour les traitements hypolipémiants n’est pas satisfaisante.
La mauvaise observance, estimée dans notre enquête à
environ 29 % de leurs patients, rejoint celle constatée par
les patients eux-mêmes et celle observée dans la littéra-
ture (8).
PÉGASE :
un programme d’éducation thérapeutique
L’ensemble des résultats des études qualitatives et quanti-
tatives préalables a permis de concevoir le programme
éducatif PÉGASE.
Ce programme a pour objectif de permettre aux patients
de mieux comprendre la maladie cardiovasculaire, son
évolution dans le temps et de préciser la notion de facteurs
de risque. Au-delà d’une formation spécifique à la pré-
vention des maladies cardiovasculaires, ce programme
pragmatique et adapté au style de vie de chacun permet
au patient d’initier son propre projet de santé et lui
apporte l’aide nécessaire pour qu’il puisse agir person-
nellement sur les facteurs qui le concernent.
Dispensé par des éducateurs formés dans six centres
hospitaliers en France, il comporte quatre séances édu-
catives collectives (de 5 à 8 patients), deux séances indi-
viduelles et un suivi assuré par le médecin de ville. Il est
axé sur le développement, par le patient, d’un projet de
changement dans le domaine de la santé. Un changement
de comportement est, en effet, un long processus dyna-
mique qui respecte toujours plusieurs étapes (15) :la
pré-intention (la personne n’envisage pas de changer de

143
Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition (VII), n° 3, mai/juin 2003
Stratégie thérapeutique
Stratégie thérapeutique
comportement), l’intention, la préparation, l’action, le
maintien et la résolution. Pour accompagner une personne
dans son désir de changement, il faut, d’une part, tenir
compte du stade où elle se trouve et, d’autre part, élaborer
des modes d’intervention éducative adaptés à chacune de
ces étapes.
La dynamique générale du programme PÉGASE com-
porte trois phases principales : une phase de préparation
(phase de prise de conscience de l’ensemble des facteurs
de risque autour d’outils pédagogiques variés, comme le
photolangage), une phase d’action (acquisition des compé-
tences, nutritionnelles par exemple, avec des résolutions
de problème, un travail de communication en lien avec
la mise en place de son projet personnel de changement),
et une phase de maintien (renforcement de toutes les
compétences acquises, évaluation régulière du projet par
le patient en collaboration avec son médecin de ville).
Une évaluation scientifique
Le programme PÉGASE s’inscrit dans le cadre d’une
démarche scientifique. Il s’agit d’une étude randomisée
en ouvert, pour une durée de un an, ayant débuté en
janvier 2002 et incluant deux groupes de 300 patients
chacun. Il a pour objectif de comparer deux types de
prise en charge : une prise en charge habituelle versus
une prise en charge “interventionnelle”. Les critères
d’évaluation du programme prennent en compte le score
de risque cardiovasculaire global (d’après l’étude de
Framingham), mais aussi des changements de compor-
tement sur le plan diététique, médicamenteux, l’activité
physique, la consommation de tabac à travers plusieurs
auto-questionnaires, etc.
En outre, pour le bras “interventionnel”, la mise en place
et la concrétisation d’un projet thérapeutique propre au
patient sont spécifiquement évaluées. Les résultats sont
évalués à 6 mois, puis, à nouveau, à 12 mois, afin d’établir
si les effets se maintiennent dans le temps.
Conclusion
Les difficultés des patients à suivre un traitement au long
cours sont manifestes, bien que souvent sous-évaluées par
les médecins. La prise en charge thérapeutique du risque
cardiovasculaire, et plus particulièrement de l’hyper-
cholestérolémie, en est une bonne illustration. Malgré
l’établissement de recommandations internationales, les
enquêtes épidémiologiques ont mis en évidence un faible
niveau d’atteinte des objectifs thérapeutiques chez bon
nombre de patients à haut risque cardiovasculaire.
L’analyse des difficultés rencontrées par les médecins et
les patients dans ce domaine de prévention est révélatrice.
En effet, au-delà d’une divergence de perception de
l’hypercholestérolémie et de la notion de risque cardio-
vasculaire entre médecins et patients, elle montre l’impor-
tance de la prise en compte à la fois des besoins d’appren-
tissage des patients et des difficultés des médecins à faire
passer leur message éducatif.
Fondé sur la concrétisation d’un projet thérapeutique
personnel, le programme PÉGASE vise à répondre au plus
près aux besoins et aux attentes des patients et, à terme,
à permettre une meilleure prévention cardiovasculaire.
Cependant, comme pour toute nouvelle démarche théra-
peutique, il est indispensable d’évaluer rigoureusement
l’efficacité des stratégies développées sur des critères de
changement de comportement de santé et, à terme, de
réduction de facteurs de risque cardiovasculaire.
Remerciements. Le projet PÉGASE a été parrainé par le
laboratoire AstraZeneca et conçu par Édusanté avec le
partenariat du CFES.
Références
1.
Glanz K. Patient and public education for cholesterol reduction : a review
of strategies and issues. Pat Educ Couns 1988 ; 12 : 235-57.
2.
Gans KM, Assmann SF, Sallar A, Lasater TM. Knowledge of cardiovascu-
lar disease prevention : an analysis from two New England communities. Prev
Med 1999 ; 29 : 229-37.
3.
Danielsson B, Aberg H. The public view on cardiovascular risk factors and
changes in lifestyle. Scand J Prim Health Care 1995 ; 13 : 74-80.
4.
Scandinavian simvastatin survival study group. Randomized trial of choles-
terol lowering in 4444 patients with coronary heart disease. Lancet 1994 ;
344 : 1383-9.
5.
Sherperd J, Cobbe SM, Ford I et al. Prevention of coronary heart disease with
pravastatin in men with hypercholesterolemia. N Eng J Med 1995 ; 333 : 1301-7.
6.
Danielsson B, Aberg H, Strender LE. Evaluation of changes in public inter-
est on lipids and others cardiovascular risk factors between 1990 and 1995.
Scand J Prim Health Care 2000 ; 18 : 183-7.
7.
Clinical reality of coronary prevention guidelines : a comparison of
EUROASPIRE I and II in nine countries. Lancet 2001; 357 : 995-1001.
8.
Fick MH et al. Helsinki heart study : primary-prevention trial with gemfibrozil
in middle-age men with dyslipidemia. Safety of treatment, changes in risk factors,
and incidence in coronary heart disease. N Engl J Med 1987 : 317 : 1237-45.
9.
House WC, Penleton L, Parker L. Patients’ versus physicians’ attributions
of reasons for diabetic patients’noncompliance with diet. Diabetes Care 1986 ;
9:434.
10.
Avis NE, McKinlay JB, Smith KW. Is cardiovascular risk factor knowledge
sufficient to influence behavior ? Am J Prev 1990 ; 6 : 137-44.
11.
Bruckert É, Thomas D, Emmerich J et al. Influence d’une campagne d’in-
formation sur les facteurs de risque cardiovasculaire, Épernon ville d’étude,
résultats à 5 ans. Press Med 1999 ; 28 : 517-22.
12.
Troein M, Rastam L, Selander S. Health beliefs and heart disease risk
among middle-aged Swedich men. Results from screening in an urban primary
care district. Scand J Prim Health 1997 ; 15 : 198-202.
13.
Therapeutic patient education, continuing education programmes for
healthcare providers in the field of prevention of chronic diseases. Report of a
WHO working group (critères OMS 1998).
14.
Wiles R, Kinmonth AL. Patients’understanding of heart attack : implications
for prevention of recurrence. Patient Educ Couns 2001 ; 44 : 217-29.
15.
Proschaska J, Di Clemente C. Stages and processes of self-change in smoking:
toward an intergrative model of change. J Consult Clin Psychol 1983; 5: 390-5.
1
/
4
100%